J’ai lu, puis relu ce livre de Carl  Bergeron tellement la palette de sujets est riche, et la réflexion assez provocante pour avoir suscité des réactions extrêmes. Il a été qualifié de chef-d’œuvre par des inconditionnels de l’auteur et à l’autre bout descendu en flammes, comme dans la revue Liberté où une critique assassine (exécutée avec un pistolet en plastique) a traité Bergeron de « Narcisse à chapeau », mais sans dire l’ombre d’un mot sur son idée maîtresse : la fameuse « Épreuve » que doivent surmonter les Québécois pour finir par maîtriser leur langue avec aisance.
Bergeron tellement la palette de sujets est riche, et la réflexion assez provocante pour avoir suscité des réactions extrêmes. Il a été qualifié de chef-d’œuvre par des inconditionnels de l’auteur et à l’autre bout descendu en flammes, comme dans la revue Liberté où une critique assassine (exécutée avec un pistolet en plastique) a traité Bergeron de « Narcisse à chapeau », mais sans dire l’ombre d’un mot sur son idée maîtresse : la fameuse « Épreuve » que doivent surmonter les Québécois pour finir par maîtriser leur langue avec aisance.
Il faut en prendre et en laisser, car le livre contient du bon et du moins bon. Mais le bon est vraiment bon.
*
Voir le monde avec un chapeau – un faux journal qui suit le calendrier du 1er janvier au 31 décembre mais se permet de changer d’année d’une entrée à l’autre – est une sorte de voyage abracadabrant dans la ville. Bergeron prend son élan sur tout ce qu’il aperçoit dans les rues de Montréal, relate des rencontres, brosse des portraits crus des gens qu’il croise, en cours de route parle drague, religion, enseignement et commente l’influence de l’hiver sur nos idées et nos vies. À côté de réflexions sur l’amitié ou la littérature, de confessions intimes sur son état de santé ou ses relations avec ses parents, il apostrophe « les zozos mal habillés et mal rasés » du milieu intellectuel ou dénonce la tyrannie du bien qui règne dans les médias, toujours occupés à « mesurer le degré de conformité des acteurs ». Il confronte les féministes qu’il accuse d’ignorer l’histoire du Québec et les humoristes dont presque tous les sketches roulent sur la difficulté de parler des Québécois.
Le nerf du livre est là : l’immense effort que les Québécois doivent faire pour s’exprimer avec fluidité dans le domaine intellectuel. « Ce qui ailleurs s’apprend comme un charme devient une épreuve de tous les instants », tâche à laquelle renoncent la majorité des locuteurs qui « tremblent dans leur langue » et restent pris avec la honte que leur infligent leurs difficultés linguistiques. Bref, le français ne s’est pas encore remis de la Conquête britannique de 1760. Bergeron a vu cette honte jusque dans le regard angoissé du cinéaste Pierre Falardeau en train d’écouter Bernard Pivot le citer sur son plateau. Il l’a entendue chez son propre père le jour où il l’a invité à sa collation des grades : « Qu’est-ce que tu veux que j’aille faire là, moé ? ». Ce moé : « le cri d’un mammifère blessé dans la forêt ».
Chacun selon lui doit faire face à son « héritage de pauvreté » s’il veut mettre un terme à la honte. Reliant cette Épreuve à la situation nationale du Québec, il appelle de ses vœux une réflexion sur ce qu’il appelle des réalités de fond, comme l’humiliation historique ou le refus des hiérarchies qui expliquerait des choses telles que la familiarité universelle et le tutoiement généralisé. Dans ce contexte, maîtriser le français est perçu comme un acte de subversion. La solution personnelle de Bergeron a été de jouer la carte de l’honneur individuel contre le tout-puissant déterminisme de l’Histoire en adoptant le style de vie d’un dandy.
Son tableau de la société est donc assez sombre. Ce qui n’est pas étonnant de la part d’un dandy, mais l’est de la part d’un un nationaliste.
*
Il faut absolument dire un mot sur l’une des grandes qualités du livre : le style de Bergeron, qui a beaucoup été vanté et avec raison. Un petit échantillon des réflexions fines ou lapidaires dont il est émaillé en donne une idée :
« En sortant du salon, dans la rue fourmillante de piétons, agressé par les klaxons et le bruit de de la ville, je me sens ivre des visages anonymes qui surgissent de tous côtés. »
Après plusieurs journées de pluie, « les rues sont désertées ; une lune embrumée éclaire faiblement la ville. Le quartier s’enfonce plus qu’il ne s’endort, se résigne plus qu’il ne s’abandonne. L’ambiance d’une ville d’Europe à la veille d’une invasion allemande ».
Observant un marathon : « Le long de ma rue, la procession docile des coureurs coule comme un robinet d’eau tiède qu’une main négligente aurait oublié de fermer. »
Très larochefoulcaldien ici et là : « On habille de nos fantasmes la femme qu’on veut déshabiller, on salit de sa mauvaise foi les rivaux qu’on veut écraser. »
« L’écriture et la méditation restent un luxe, tout le temps, dans toutes les classes sociales. On n’est jamais tranquille. »
« L’omniprésence des “arts de l’écran” à notre époque me fatigue. » (Le cinéma passe un mauvais quart d’heure dans le livre, ce qui étonne quand on sait que Bergeron est l’auteur d’un essai fouillé sur la filmographie de Denys Arcand, Un cynique chez les lyriques.)
Plusieurs autres passages magistraux, notamment le récit de son contact avec une vieille bossue en train de fouiller dans les vidanges (entrée du 1er novembre) et son face-à-face avec un gang de rue jamaïcain un soir près d’un parc dans l’ouest de la ville (juillet 2005).
*
Cela dit, l’écriture est inégale. L’écrivain cède trop souvent la plume à une espèce de sociologue qui verse dans une incroyable lourdeur académique (« Toute histoire qui se calcule en siècles entraîne une codification des affects dans la culture »). Heureusement, Bergeron met la littérature tout en haut et c’est d’ailleurs pourquoi il peut déplorer qu’à l’université les profs convainquent vite les nouveaux étudiants de préférer « aux mots qui font les vocations les concepts qui font les carrières ». Mais les deux styles marchent mal ensemble.
Sa langue peut aussi être affectée (« la ponction de l’origine sur la chair de l’âme ») ou au contraire tomber dans les généralisations faciles (« On est tous le ringard de quelqu’un d’autre », « Ma génération doit continuer à travailler »). Bergeron cultive une étrange manière d’évoquer une chose au lieu de nous plonger dedans (« Je leur raconte une anecdote intimiste », mais on se saura jamais laquelle ; « Je lui parle de l’écrivain que je suis en train de lire », mais son identité est gardée secrète). C’est comme s’il se détournait soudain de ses lecteurs, les tenant à l’écart de ce qui se passe tout en leur laissant entendre que ce qui se passe est important. Voir le monde avec un chapeau n’est pas un journal intime à la Léautaud où l’auteur déballe tout, un tri sévère est opéré.
*
J’avoue m’être demandé par bouts si le livre n’aurait pas dû s’intituler La honte et le mépris, tellement certains passages peuvent laisser perplexes. La honte, c’est le constat franc et impitoyable sur la condition linguistique des Québécois. Le mépris surgit de diverses manières. Observant un groupe d’ados dans le métro : « leur destin, on le sait, est de se fondre dans la masse ». Les employés qui déferlent des bureaux en fin d’après-midi sont un petit peuple d’affairés qui fait « rouler l’économie avec bêtise et compétence ». L’allure sévère d’une marathonienne l’irrite au plus haut point.
De la misogynie affleure ici et là. Il tape sur quelques hommes mais décoche bien plus souvent ses pointes contre les femmes. Quand une belle fille entre dans un petit café où il est le seul client, Bergeron, en professionnel de la drague, se met à la dévisager. Comme elle l’ignore, accaparée par son iPhone, il en conclut qu’elle est une « déséquilibrée », un « monstre » qui s’exhibe sans rien regarder autour d’elle. Pas une seconde il ne lui vient à l’esprit que coincée dans le champ visuel du dragueur, son téléphone est peut-être une bouée de sauvetage. À la bibliothèque, il est accueilli par « deux mégères aux gros seins ». Une fille sort son téléphone pour photographier le verglas, aussitôt il doute de la qualité de sa « vie intérieure ».
J’ai souvent eu l’impression qu’au lieu de regarder vraiment les gens, il se contentait d’identifier à vue de nez la catégorie à laquelle ils appartiennent, comme s’il n’avait aucune notion de la souffrance ou des contradictions des autres : voici des jeunes, voici une quadragénaire, voici des boomers – ce ne sont pas des êtres en chair et en os, mais des représentants. Même pour les femmes avec qui il couche : la Noire qui l’amène chez elle n’a aucun trait de caractère particulier, mais d’admirables « fesses rebondies tout en nerfs et en muscles », typiques des Noires. Une famille de trois générations attend la fin d’un orage sous un porche : voilà toutes les familles multigénérationnelles offertes à sa vue sur un plateau d’argent. Ce n’est pas l’écrivain qui écrit ces pages-là, mais le sociologue.
D’autres remarques peuvent hérisser, mais là on est sur le terrain des opinions et Bergeron les assume complètement :
Les carrés rouges. Ils ont eu beau politiser une masse de jeunes, Bergeron leur reproche d’avoir mené une simple bataille comptable et accuse le printemps érable de n’avoir produit aucun « livre majeur ». Mais c’était il y a quatre ans ! Qu’a produit Octobre 70 ? (Peut-être La constellation du Lynx de Louis Hamelin quarante ans après, mais œuvre sans doute populiste et mineure à ses yeux.) Sur Mai 68, même si les témoignages ont abondé, on attend toujours l’œuvre majeure.
La relation au père. Dans une lettre accusatrice à son père il lui demande sans aucun espoir un peu d’argent. La lettre est injuste parce que jamais son père ne pourrait rivaliser avec sa rhétorique. Nul doute qu’il a opéré par là une séparation nécessaire – mais à coups de commentaires cruels : « Il est dans l’ordre des choses que tu t’effaces et que je te succède ; si j’ai à mon tour un fils, il me succédera », argument de mauvaise foi puisque, trois pages plus tôt, il vient de rejeter pour la vie tout projet d’avoir des enfants. Pire, il lui souhaite « de vivre en pleine santé jusqu’à quatre-vingts ans et, pourquoi pas, jusqu’à quatre-vingt-cinq. » Et pourquoi pas jusqu’à 90 ? Dans ces pages-là, le livre m’est tombé des mains. S’agirait-il de maladresses d’expression de sa part ?
La littérature québécoise. À part la poésie de Gaston Miron, elle le laisse sur sa faim. Je ne comprends pas comment on peut en venir à détester, c’est son mot, Réjean Ducharme et Michel Tremblay, alors qu’ils ont écrit, avec justement une grande aisance, des œuvres comme Le nez qui voque et Thérèse et Pierrette à l’école des Saints-Anges. Comme sur d’autres questions, il nous fait part de son sentiment sans en dire plus.
*
On voit qu’il y a énormément de matière dans Voir le monde avec un chapeau. Alors comment expliquer qu’un livre aussi peu banal n’ait pas fait de vagues ? On dirait que Bergeron a tout fait pour allumer des incendies – le nationalisme, le féminisme, la drague, la médiocrité culturelle, la langue, des sujets chauds. Or après quelques réactions extrêmes, admiration béate ou rejet spontané, plus rien ! Il est vrai qu’en général on esquive (ou on craint ?) les débats au Québec, mais tout cela reste déconcertant.
L’ambivalence de Bergeron y est peut-être pour quelque chose. Parce que malgré le tranchant de ses idées, il laisse une image indécise. De prime abord, son dandysme n’a rien de farfelu : celui ou celle qui surmontera « l’Épreuve » se distinguera ostensiblement des autres, et de là au dandysme il n’y a que quelques pas – à situation grave, solution radicale. Sauf que la mécanique n’est pas fluide, car il a beau jouer sur les deux tableaux on ne peut s’empêcher de se demander en le lisant ce qui prime chez lui, entre sa singularité et la nation. Les dandys n’ont pas l’habitude de se promener avec un programme politique. Quand Bergeron écrit : « Je ne serai jamais un apatride », c’est ce déchirement en lui qu’il exprime.
J’ai fini par douter qu’il soit vraiment un dandy. L’Histoire occupe une telle place dans sa conscience qu’on pourrait toujours l’étiqueter comme « dandy patriotique », mais n’est-ce pas un oxymoron ? Le dandysme ne consiste pas simplement à être dans le club des gens bien mis, sinon cette posture qu’il a adoptée ne voudrait plus dire grand-chose : il doit y avoir une excentricité par rapport au commun des mortels. Baudelaire disait que le dandy manifeste de la froideur, qu’il est au-dessus des émotions courantes du monde ordinaire, il est celui qui ne chemine pas avec ses contemporains. « Vous figurez-vous un Dandy parlant au peuple, excepté pour le bafouer ? » écrivait-il dans Mon cœur mis à nu. Je ne dis pas que Bergeron s’est payé de mots en se proclamant dandy, mais le dandysme, c’est beaucoup demander au sentiment patriotique.
À la rigueur on pourrait le considérer comme un dandy anxieux. L’élément personnel, son roman familial, l’émotion retenue, l’indifférence de la mère, les refus butés du père, tout cela amplifié par ses nombreuses détestations, bref cette tension omniprésente dans son livre, jusqu’aux dernières lignes où il implore ses parents de comprendre ce qu’il a fait – trahit une angoisse qui l’empêche d’arborer la légèreté provocante du vrai dandy. Il rejette la façon de vivre des autres mais sans parvenir à se débarrasser de la colère qu’éveille en lui la honte qui pèse sur la collectivité.
C’est un livre teinté de pessimisme, reflet d’une situation qu’il juge sérieuse. Bergeron est loin d’être le premier à écrire un ouvrage inquiet sur le destin du Québec. Je me souviens du défaitiste Un Québec si lointain, histoire d’un désamour, d’un Richard Dubois heureux de s’exiler d’une société à « l’imaginaire national en panne ». André Major s’est réfugié dans un individualisme tranquille. Jean Papineau dans les Dialogues en ruine se disait démoralisé par le Québec, ne voyant plus le bout du tunnel. Avec Bergeron l’horizon reste embrouillé, comme sur la couverture de son livre, mais il n’y a pas d’amertume ou de découragement chez lui, au contraire il garde espoir. Il aurait pu mettre en exergue de son livre le proverbe haïtien : touttan tèt pa koupe, li espere pote chapo – tant que la tête n’est pas coupée, elle a l’espoir de porter un chapeau. C’est-à-dire qu’il ne faut pas désespérer. Mais le créole n’aurait sûrement pas fait son affaire.
♠
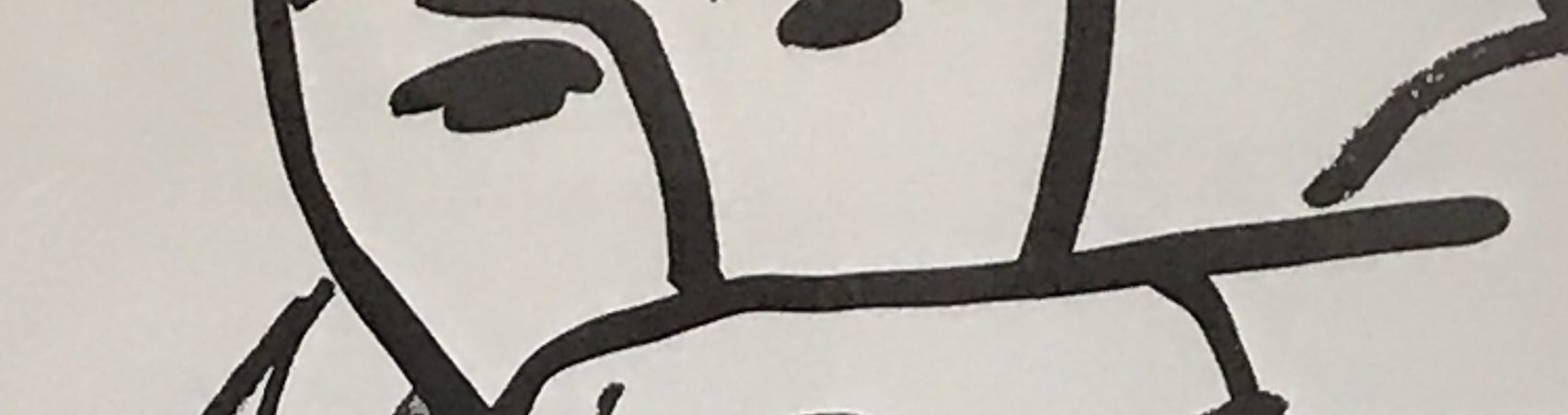
Salut Jacques,
J’ai commencé ce livre à cause de ce billet (oui, à cause).
Je te ferai part de mes impressions quand je l’aurai terminé, mais je peux déjà te dire que je serai beaucoup moins tendre que toi 🙂
J’aimeJ’aime
Merci de ta délicatesse. Un homme averti en vaut deux. Remarque que le livre a été généralement détesté. À part quelques grosses huiles dans les médias, je ne connais qu’une seule et unique personne qui a aimé.
J’aimeJ’aime
Remarque que tout n’est pas mauvais, loin de là. Mais avec quel entrain Carl Bergeron alterne le chaud et le froid, les remarques débiles teintées de mépris et les magnifiques analyses propices à la réflexion, comme si son cerveau partait en vacances un jour sur deux…
J’aimeJ’aime