Lecture de deux écrivains fascinés par des peintres de leur propre culture : d’abord Étienne Beaulieu sur Ozias Leduc et Paul-Émile Borduas, et plus tard Karl Ove Knausgaard sur Edvard Munch.

À la suite de déboires amoureux et professionnels, Étienne Beaulieu entreprend une quête de sens à travers l’œuvre de deux grands peintres québécois, Ozias Leduc (1864-1955) – de loin son préféré – et Paul-Émile Borduas (1905-1960). Une séparation difficile, un épisode d’amour fou, son abandon de la vie universitaire l’ont sorti de sa quiétude et plongé dans la tourmente de la postmodernité. Tout son effort porte sur le triangle identitaire qu’il dessine entre sa vie et celle des deux artistes, nés dans le même village et ayant été l’un l’élève de l’autre. Leduc le fait rêver, alors que ses infortunes le rapprochent malgré lui de Borduas.
Chez le premier il aime la lenteur, la solidité paysanne, l’homme qui fait corps avec son patelin – par contraste avec l’exilé qui, à coups de ruptures brutales, a tourné le dos à la religion, lancé le manifeste Refus global (1948), quitté famille et enfants (« Semez vos enfants au coin d’un bois », disait André Breton), fait éclater le figuratif. Le premier a vécu une vie sereine, marié à sa cousine, dérangé par aucun enfant ; le chef de file des Automatistes a connu divorce, maîtresses, adversaires, paternité troublée, expulsion des institutions. D’un côté, le feu tranquille du foyer domestique, celui qui s’est éteint pour Beaulieu après dix-sept années de vie conjugale. En face, les grands fracas, la contestation, les aventures folles, notre époque, bref Borduas.
En principe, Beaulieu ne cherche pas à décréter lequel est le plus grand et affirme qu’il ne « prend parti pour aucun de ces deux hommes ». Mais le reste du livre donne l’impression du contraire. Sa visée est d’ordre moral : les prendre à témoin de ce que nous sommes devenus, en s’appuyant sur son expérience personnelle, et pour y arriver il essaie de démontrer que les deux peintres sont en parfaite opposition et se complètent. Sauf qu’en cours de route, il prononce une série de jugements pour le moins discutables.
Son vocabulaire est révélateur. Il parle toujours de Leduc sur un ton hagiographique : voilà un homme sage, droit, solide, enchanteur, doté des forces vives de la création, d’une puissance onirique qui élève l’esprit humain vers le meilleur de lui-même, c’est un seigneur aristocratique, un duc, dit Beaulieu qui se régale de son nom, tout comme le nom de Correlieu, l’atelier de Leduc, doit flatter son oreille. Pour Borduas on passe à un registre péjoratif : étrange, désorienté, nostalgique, meurtri, indiscipliné, destructeur, défiguration, opacité, absence de sens, panique, effondrement symbolique, sa maison est un blockhaus, il travaille sur la surface plane des grandes villes, où règnent les hiérarchies sous forme de gratte-ciel et de réputations. Approfondissement d’être chez Leduc, aplatissement d’être chez Borduas.
*
L’attachement de Beaulieu à Leduc est sincère : « Chaque fois que je m’assois pour lire ou pour réfléchir, pour prendre un pas de recul sur la vie courante, je sens la justesse d’une vibration que je ne retrouve que dans les toiles d’Ozias Leduc. » Dès qu’il se tourne vers Borduas, il a presque une réaction de rejet. À un moment, c’est tout juste s’il ne ramène pas le parcours de Borduas à une « carrière d’artiste ».
Il est plus sévère que Manon Barbeau elle-même, fille abandonnée de deux Automatistes et réalisatrice des Enfants de Refus global. Dans une entrevue de 2015, sans nier ses blessures profondes, elle refusait de condamner l’exil de Borduas ou de ses propres parents, malgré le destin de son frère schizophrène, dont elle ne veut pas attribuer le malheur entièrement à la décision de ses parents de les abandonner en bas âge. Inutile de regretter ce qui en 1948 a semblé incontournable à ces grands artistes, disait-elle, « il n’y a pas de révolution sans un certain radicalisme ».
Or Beaulieu n’est pas de cet avis, et son jugement est sans appel :
« Le réel devoir d’un artiste n’est pas de faire fructifier ses dons personnels, comme le croient les narcissiques, mais de les accorder à l’amour de ses proches. Il n’y a pas d’autre but existentiel à l’art, sinon c’est une fumisterie pour soi seul. »
Il n’envisage pas une seconde que Borduas et les autres quittant enfants et pays aient pu être emportés hors de tout contrôle par le feu de leur œuvre. C’est régler de façon expéditive la question complexe des pulsions créatrices, et répartir les artistes entre les bons et les méchants. Beaulieu ne sous-estime pas l’ampleur de 1948 – du moins l’ampleur sociale, pour la révolution picturale ce n’est pas clair – et plaide pour la persistance du mythe dans notre imaginaire collectif, mais je ne sais pas s’il mesure bien le geste des Automatistes. J’en ai douté quand il prétend, à propos de lui-même, qu’« il aurait été facile de tout quitter » en parlant de ses enfants, pour se consacrer à son œuvre comme l’a fait Borduas. Facile vraiment de quitter ses enfants aujourd’hui ? Sans 48 ni révolution nulle part ?
Il s’enflamme tellement sur ce point qu’il finit sûrement par dépasser sa pensée lorsqu’il écrit : « Tout artiste n’ayant mis au monde que son œuvre a échoué lamentablement. » Peut-on sérieusement coller à tous les Automatistes l’étiquette « échec lamentable » ? Or le plus singulier est que ce n’est pas à Borduas qu’il peut adresser un reproche aussi grave, mais bien à Ozias Leduc qui n’a jamais eu d’enfants…
Beaulieu se rend bien compte qu’il vient d’énoncer une contradiction. Mais le coup a été porté, le portrait de Borduas encore plus noirci, et au lieu de reculer et corriger il se met à échafauder une fort curieuse théorie : les deux peintres formeraient par complémentarité « une vie complète à eux deux », un couple père-fils fusionné par une filiation de remplacement pour celle que Borduas n’a pas vécue avec sa progéniture. C’est le fil conducteur de La pomme et l’étoile : Borduas ne se serait jamais dépêtré de son premier maître, c’est « en suivant Leduc jusqu’au bout que Borduas arrive à lui-même », « en peignant ce que Leduc avait laissé latent dans ses toiles ». Bref, tout l’œuvre de Borduas ne serait qu’un halo abstrait autour de celui de Leduc. Même quand il décrit sa trajectoire comme une forme d’« enracinement dans le mouvement », c’est encore une façon de le regarder à travers Leduc. Oublie-t-il les mots connus de Borduas : « … la peinture physique, la matière, la pâte. C’est là mon sol natal, c’est ma terre. Sans elle, je suis déraciné » ?
*
Voilà donc Borduas dépeint comme une sorte d’Énée portant sur ses épaules le professeur de ses vingt ans jusqu’à son dernier souffle. C’est comme si Étienne Beaulieu avait trouvé un écho à son désarroi chez Borduas et l’avait ensuite étendu à tout ce qu’il a fait. À la fin, Borduas a l’air d’un accident dans l’histoire de la peinture. C’est une faiblesse majeure de La pomme et l’étoile : l’image ne colle tout simplement pas à l’un des artistes québécois qui a été parmi les plus inventifs et les plus influents. C’est normal que Borduas ait subi l’influence d’un peintre accompli avec lequel il a travaillé dès l’adolescence et dont il a toujours gardé un tendre souvenir, vantant plus tard la « vertigineuse délicatesse de tons qui est le miroir de son âme ». Mais Borduas a aussi été influencé par Cézanne, Renoir, Rouault, Braque, les cubistes, Picasso, Pollock, Kline, de nombreux autres, et même la calligraphie orientale, sans parler des longues influences derrière les paysages et les natures mortes de Leduc, dont certaines doivent remonter aux anciens peintres hollandais.
Beaulieu a beau nous prévenir qu’il s’intéresse aux mythes que sont Leduc et Borduas dans notre imaginaire, qu’il n’est pas en train de faire un travail d’historien, les oppositions symétriques qu’il multiplie au fil des pages entre les deux peintres – presque toujours au désavantage de Borduas qui lui sert de repoussoir pour élever Leduc au sommet – sont très fragiles. Deux exemples :
Verticalité de Leduc vs horizontalité de Borduas. Les nuages et les falaises de Leduc pointent en effet vers le ciel, ses Trois pommes trop rondes pour être juteuses exercent un attrait spirituel à la fois par leur trinité et leur perfection. Borduas est-il pour autant prisonnier de l’horizontalité ? Beaulieu cite cette merveilleuse lettre à Claude Gauvreau où Borduas, dont la plume était aussi habile que son pinceau, écrit : « Un temple grec s’ouvre sur la plaine et prend possession de l’horizon. Plaine et horizon deviennent joyeux. » Cette joie embrasse l’univers entier, comme le montre la phrase qui suit immédiatement : « La cathédrale de Chartres s’isole de la terre qui semble pénible. » C’est l’élan cosmique déjà présent dans les gouaches de 1942 et qui culminera dans L’étoile noire vers la fin des années 50. Borduas n’a rien opposé à la verticalité de Leduc : il est allé ailleurs. Ce n’est pas l’envie qui manque d’inverser la symétrie : la pomme n’est-elle pas la preuve par excellence que Leduc est prisonnier de l’attraction du sol ? l’étoile n’est-elle pas l’image même de l’inaccessible qui nous fait lever les yeux vers le ciel ? Dans un sens ou l’autre, l’opposition que décrit Beaulieu reste malaisée parce que Les trois pommes sont un petit tableau à peine plus grand qu’une feuille 8 ½ x 11 que Leduc a peint alors qu’il n’avait pas encore vingt-cinq ans, et L’étoile noire un grand tableau de 1,6 m x 1,3 m peint par Borduas quelques années avant sa mort.


Souplesse de Leduc vs raideur de Borduas. Encore là, on pourrait renverser les termes. La souplesse n’est-elle pas la signature même de l’auteur de Refus global qui a tant varié les styles ? La raideur n’est-elle pas typique des personnages de Leduc, toujours figés dans une pose hiératique ou un mouvement de tension, comme l’écrit Laurier Lacroix dans sa monographie ? En fait, Beaulieu parle de la souplesse de Leduc dans ses rapports avec les gens, parce que cet homme conformiste s’entendait bien avec tout le monde. Mais c’est trop généreux de sa part de soutenir qu’il était conformiste « avec un petit sourire en coin » – parce que ce petit sourire en coin, on ne le voit nulle part dans son œuvre. Tout comme c’est fort injuste de qualifier de déjà « surannée » à l’époque la révolte anticonformiste menée par Borduas contre le pouvoir religieux et institutionnel, puis écrasée par le gouvernement, les institutions et les journaux.
Conclure comme il le fait avec une autre opposition binaire : Intelligence de Leduc vs intempestivité de Borduas, m’a laissé pantois. Il joue encore sur l’ambiguïté des mots (intelligence mentale vs sociale). Le portrait que brosse Anaïs Barbeau-Lavalette dans son roman La femme qui fuit, d’un homme au « regard triste des gens trop intelligents », ou Marcelle Ferron dans le film de Monique Crouillère, d’« un homme très, très, très intelligent », est plus convaincant. Ceux qui regarderont ce passionnant documentaire comprendront aussi que les dernières années de Borduas ont été gâchées non par un défaut de son caractère, mais par sa mauvaise santé et le hasard des décisions prises par des galeristes parisiens. C’est connu, il n’a pas été chanceux à Paris (« J’ai voulu des amitiés françaises. Je ne les ai pas trouvées », a-t-il confié à Jean-Éthier Blais). Une opposition plus juste serait : Débrouillardise de Leduc vs malchance de Borduas. Mais elle gâcherait le tableau que veut brosser Beaulieu.
*
Le livre est intéressant quand Beaulieu cesse enfin d’étendre Borduas sur un lit de Procuste taillé pour Leduc et de toujours voir chez l’un l’inverse de l’autre de façon simpliste. Quand il reconnaît à Borduas son apparition exceptionnelle dans l’histoire du Québec, sa création constante de nouvelles formes ou qu’il analyse des toiles comme Synthèse d’un paysage de Saint-Hilaire. Quand, laissant Borduas tranquille, il décrit l’« attention au proche » présente chez Leduc, à ce qui « se donne avec toute la simplicité du monde » ou qu’il analyse Érato. Quand il raconte sa propre vie à travers la leur : comment, lorsque jeune il vivait en France, il était attiré par les musées des petites villes et la Vieille France bien plus que par le tapage parisien. Sans oublier ces pages où il dénonce lui-même « l’esprit de clocher des personnages académiques ». Sans surprise, tant il est vrai qu’on ne peut échapper à 1948, ces pointes sont lancées dans un esprit très Refus global. Beaulieu fera d’ailleurs la paix avec le « sauvage », le « mystique moderne » qu’a été Borduas, dans les dernières pages de son livre. Et c’est mieux ainsi parce qu’il serait difficile de vivre dans un autre monde que celui dans lequel on vit.
*
Si l’on veut apprécier une différence profonde entre les deux artistes, on n’a qu’à observer le traitement de la lumière dans leurs toiles. Celle tamisée des Leduc, cernée d’une ombre épaisse, toujours un peu mystérieuse, même quand elle irradie des trois pommes ou du corps d’Érato, dégage un charme inouï. Mais les magnifiques noir et blanc de Borduas, gorgés de lumière, nous montrent complètement autre chose. Les experts, Borduas lui-même ont toujours parlé de « taches » à propos de ces tableaux, mais quand on est devant l’œuvre dans un musée, on a l’impression que la toile a été recouverte d’une épaisse couche de lumière qui à certains endroits a été déchirée pour faire surgir l’implacable noir derrière (« C’est de la lumière peinte » aurait dit Borduas à un journaliste). Je ne vois pas comment on pourrait forger un lien de filiation entre la lumière discrète de l’un et celle éblouissante de l’autre. Cette netteté a été un trait de tous les Automatistes. Il suffit de faire un pas dans une salle où sont exposées leurs œuvres pour avoir les yeux éclaboussés par les éclats de couleur des Ferron, le mouvement qui traverse les Barbeau, la « couleur-lumière » des Fernand Leduc, le crépitement presque audible des Riopelle.

Je soupçonne Beaulieu de ne pas être grand amateur d’abstraction en peinture. Il est clair que Borduas lui a donné des clefs pour reprendre pied, mais on ne sent jamais chez lui d’émerveillement devant ses toiles. Il observe devant Viol aux confins de la matière « les puissances déchainées de la matière, ce viol immémorial commis à toute heure depuis les confins des temps, dans la nuit des choses », mais sur un ton conceptuel, dépourvu d’émotion. Il rappelle que les Automatistes ont accompagné l’arrivée de la modernité au Québec, reconnaît le « bolide historique » qu’a été Borduas, mais comme à contrecœur. Nulle part on ne le sent se laisser envahir par la force brute de ses toiles, par leur beauté, leur fantaisie, leur audace, leur merveilleux, leur singularité, leur éclat. Il y a chez Borduas une solidité de l’acte créateur à laquelle il reste insensible. Dès le début, il voit dans L’étoile noire de la « matière dépourvue de toute signification », sous prétexte qu’on peut la comprendre différemment d’un instant à l’autre. Ailleurs il décrit les abstractions de Borduas comme des « débris » de strates figuratives. N’est-ce pas encore une contradiction que de chercher le sens figuratif qui se cacherait dans ses œuvres, comme si le sens d’une toile abstraite devait être une figure ?
Si un peintre de la trempe de Borduas sort du figuratif, il faut lui faire confiance. Devant une abstraction, notre premier réflexe est celui d’un amateur de rébus qui va déchiffrer le figuratif soi-disant caché derrière. Mais c’est comme chercher à neutraliser la toile, à la réduire à une fonction de représentation, à la rapetisser à la dimension d’un dessin inoffensif qu’on a déjà dans la tête : bref, c’est rester coincé en soi-même au lieu de chercher à pénétrer l’âme de celui ou celle qui l’a faite. Le sens d’une toile abstraite peut aussi bien être un flot d’émotions personnelles que l’infini vertigineux de l’univers. L’abstraction est une façon différente de traiter la matière picturale, de créer, d’inventer, de s’exprimer, de voir le monde. C’était la grande affaire des Automatistes, qui à partir des années 40 et jusqu’à la fin de leur vie n’ont fait que du non-figuratif, contrairement aux surréalistes, Dali ou Max Ernst par exemple, au point de refuser de participer à d’importantes expositions internationales des surréalistes (Jean-Philippe Warren rappelle dans son ouvrage sur Borduas qu’André Breton fut longtemps hostile à l’art non figuratif). Beaulieu est dans l’erreur quand il affirme qu’en peinture l’automatisme était « en retard » sur le surréalisme, même si c’est dans celui-ci qu’il a puisé son ardeur, de même qu’en littérature Claude Gauvreau n’a été en retard sur personne. Anaïs Barbeau-Lavalette cite cette mise au point de Gauvreau dans son roman :
L’automatisme n’a jamais eu aucun point de départ figuratif. Son monde est le monde intérieur. Une projection vers l’extérieur du monde intérieur. Le surréalisme repose sur une figuration du monde intérieur. L’automatisme sur une non-figuration du monde intérieur.
*
Une autre chose m’a intrigué. Beaulieu parle de la tension retenue chez les personnages de Leduc comme est retenue la lumière voilée de ses paysages. Car il n’y a pas que calme et douceur champêtre chez lui, on perçoit toujours une certaine rigidité comme on l’a vu. Il est possible que le fond sombre de ses tableaux, cette lourdeur omniprésente ait été le reflet de la noirceur qui régnait dans la société d’alors. Mais elle me fait penser à la fameuse anamorphose que Jacques Lacan a analysée dans Les Ambasssadeurs d’Holbein, manifestation de l’inconscient qui vient rabattre sur la toile la pulsion de mort, sous la forme d’un crâne déformé (comme dans le style ´Memento mori´). Si l’inconscient est cette créature qui « ne peut survivre que quelques instants en dehors de son milieu, sombre et discret », comme le définit Beaulieu, comment peut-il changer de définition quand il se tourne vers les Automatistes et proclamer qu’ils étalaient leur inconscient sur la toile ? Même s’ils le prétendaient eux-mêmes, nous ne sommes pas obligés de les croire. D’autant plus que Borduas n’a guère suivi les consignes d’André Breton et qu’il retravaillait ses œuvres. Si la créature en question ne peut survivre à l’air libre qu’un instant, ce n’est sûrement pas elle qu’on voit à pleine toile, comme dans une vitrine, chez les Automatistes.
*
Même l’écrivain Jacques Ferron, qui n’a d’abord vu dans Refus global qu’« un grand brouhaha », a reconnu dans ses Historiettes qu’en passant au non-figuratif Borduas a montré que « la peinture devance la société ». Marcelle Ferron et Mme Françoise Sullivan, signataires du manifeste, diront toutes deux plus tard que l’un des grands acquis de 1948 a été la liberté. Mais chaque fois que Beaulieu entend le mot « liberté », il réagit mal, il entend « dérives de la liberté ». Il y a beaucoup de nostalgie chez lui : à travers Borduas c’est à nous, ses contemporains, horizontaux, peu souples, intempestifs, qu’il trouve mille défauts. La pomme et l’étoile donne la fausse impression qu’à notre époque tout est à notre portée sur une étagère, que Leduc et Borduas sont également nos contemporains, qu’on peut se promener de l’un à l’autre et faire un choix. C’est une illusion. Qu’on le veuille ou non, notre monde est borduasien, et l’essayiste le souligne lui-même par cette réflexion qu’aujourd’hui « si l’on veut durer, il faut accepter de pousser un peu tout de travers ». C’est pourquoi Beaulieu n’a pas le choix à la fin que de trouver un terrain d’entente avec Borduas, parce qu’au fond il est bien conscient que les retours à Leduc ne pourront être que des visites occasionnelles, comme celles que l’on faisait dans le temps où on allait voir la parenté à la campagne, sans jamais rester trop longtemps.
*
Note sur la langue. La facture linguistique du livre est déroutante. Les Trois essais sur l’insignifiance suivis de Lettre à la France de Pierre Vadeboncœur sont rebaptisés Trois lettres à la France. La toile Neige dorée de Leduc devient Neiges dorées. On voit Spreichgesang au lieu de Sprechgesang. Il y a des tournures de brouillon (« Au moment d’écrire ces lignes, il est très étrange d’écrire ces mots »), des accords douteux (« une raison clichée »), des coquilles (« c’est n’est déjà plus aimer »), des raccourcis abusifs (« sa correspondance amoureuse avec Rachel Laforest, demeurée secrète, à l’exception notable de Pierre Vadeboncœur »), des phrases tellement diluées qu’on est obligé de les relire (« C’est avec Olivier Maurault que Leduc trouve le financement pour le voyage de Borduas pour aller étudier l’art sacré auprès du même Maurice Denis à Paris »). Ces bavures dépassent de loin la moyenne habituelle. Il est étonnant que le livre ait été publié tel quel.

En complément
À écouter : l’entrevue de Manon Barbeau en 2015 avec la revue Voir et celle émouvante, plus personnelle avec Radio-Canada en 2018.
À écouter : François-Marc Gagnon (1935-2019) parlant de L’étoile noire.
À consulter : les monographies de Laurier Lacroix sur Ozias Leduc et de François-Marc Gagnon sur Paul-Émile Borduas.
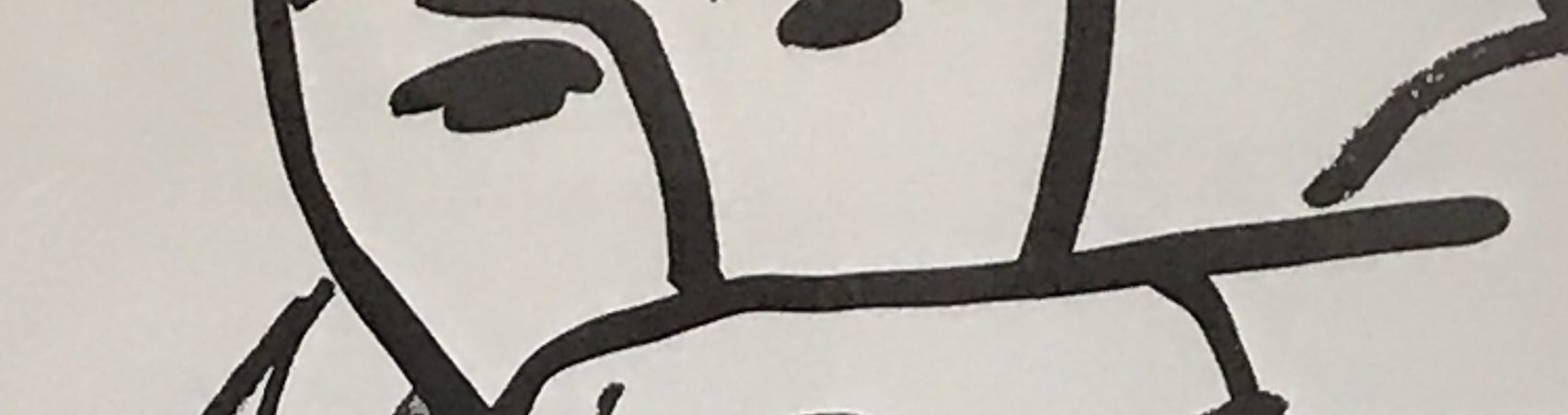
Je copie-colle ici le commentaire de Jean-Paul Coupal sur ma page Facebook :
« Je n’ai pu ajouter mon commentaire à votre article. Je vous le transmet ici.
J’ai grandement apprécié votre critique. N’ayant pas lu le livre de Beaulieu, je me bornerai à commenter la perception que vous m’en donnée. Je pense que Beaulieu a procédé de la pire façon pour aborder une étude comparative. Marquer une opposition type/antitype n’est pas la meilleure façon de faire car l’opposition va surtout s’articuler sur des aspects moraux plutôt qu’esthétiques. Vouloir qualifier des peintres en fonction d’oppositions morales, c’est juger des individus et chercher confirmation de ces jugements par la production artistique, c’est déplacé et non conclusif. D’un autre côté, dans une opposition Leduc/Borduas, au point de vue esthétique, on en vient, même si ce n’est pas là notre objet, à opposer un avant et un après et supposer une conception du « progrès » en art. Conception rejetée aujourd’hui par pratiquement tous les critiques d’art.
Pour éviter un tel glissement normatif, peut-être faut-il une connaissance de la technique de la peinture qui manque à M. Beaulieu? En tout cas, vous, vous la possédez bien et votre article confirme ce que j’ai toujours pensé de ce que doit être un art de la critique. Nous conduire à dépasser une oeuvre, un style ou une forme, à aller au-delà de l’appréciation que nous pouvons en avoir.. Ce n’est pas tant que vous êtes sévère à l’égard de M. Beaulieu, plutôt que vous exposez vous-mêmes votre propre analyse comparative à travers deux oeuvres qui éclaire votre propos, échappant aux banalités en exposant, méthodiquement, votre critique. Je pense qu’il vaudrait mieux creuser le thème historique du saut qualitatif de l’expression formelle entre l’art traditionnel et l’art contemporain dans le développement de la peinture au Québec. Juger sur une comparaison oppositionnelle nous apprend peu de choses. Mais à la limite Leduc/Borduas s’est produit un soubresaut historique, une faille où se dessine nettement une séparation dont on devrait s’attarder à suivre la transition. Cette transition entre le réalisme et l’abstraction dont on voit la progression à travers les oeuvres cubistes et surréalistes. La modernisation industrielle et urbaine du Québec a sans doute engendré une rupture plus radicale chez nos artistes que dans l’Europe d’après la Grande Guerre, Ce saut, rattrapé ici après la Seconde Guerre mondiale, aurait exigé une rapidité dans le développement formel qui en serait toute l’originalité. »
J’aimeJ’aime
J’aime bien la dernière phrase de ton texte même si je ne prononcerai pas sur les talents respectifs de Leduc et Borduas. Mais je ne ressens vraiment rien devant une toile abstraite ce n’est la faute de personne. Merci pour ce texte .
J’aimeJ’aime
L’excipit d’un texte, c’est comme la dernière image qu’on garde d’une personne en la quittant.
J’aimeJ’aime
J’ai commencé la lecture de La pomme et l’étoile il y a quelques jours, comme toi j’ai relevé certaines maladresses et quelques fois les mêmes phrases qui me dérangeaient, cependant je reste saisi par la finesse et la richesse de ton analyse, sa justesse aussi, qui me renvoie à l’importance des points de vue différents à porter sur une oeuvre quand on veut en analyser la portée. Je me demande si je n’aurais pas dû en terminer la lecture avant de te lire…
J’aimeAimé par 1 personne
Jean-Marc, J’ai abordé le livre d’Étienne Beaulieu sans préjugé, bien au contraire, j’avais bien aimé L’âme littéraire, un peu moins Splendeur au bois Beckett, le buzz autour de La pomme annonçait un livre hors du commun. Puis j’ai déchanté. Je ne veux pas en remettre, mais on m’a dit qu’il y a des fautes dans tous les livres, alors que là ça me semblait déborder. J’ai donné quelques exemples, il y en a d’autres. Deux idées maîtresses du livre m’ont paru peu convaincantes :
⁃ sur le plan moral, la condamnation sévère de la vie des Automatistes est dure pour la descendance Riopelle, Barbeau, etc. Je me serais attendu à plus de compassion. Ces choses-là dans la vie ne sont pas tranchées nettes.
⁃ sur le plan esthétique, la filiation Leduc-Borduas n’a rien d’évident. Un à un, les arguments avancés peuvent être démontés.
Tu soulignes l’importance des points de vue : Beaulieu lui-même a consacré un chapitre entier d’un de ses livres aux vertus de la polémique, sans laquelle on est dans la mort intellectuelle. Or le livre a croulé sous les éloges. Où est l’esprit critique ? On résume l’ouvrage, on le vante, on dit Leduc, on dit Borduas, et c’est fini. Il y a tout de même des choses pour le moins discutables dans le livre. Tout cela soit dit sans préjugé pour tout ce à travers quoi Beaulieu est peut-être passé dans sa vie pour en arriver à cet essai. Merci encore pour ton commentaire.
J’aimeJ’aime