Un siècle et demi après sa parution, j’ai lu la fameuse nouvelle d’Herman Melville, Bartleby, the Scrivener (Bartleby, le scribe). L’auteur de Moby Dick est un géant dans l’histoire de la littérature. Camus le plaçait au-dessus de Kafka parce qu’il voyait chez lui une part de lumière absente chez le second. Mais cette clarté lui venait, selon Borges, de la « curieuse lumière ultérieure » que Kafka projetait sur lui. Une chose est certaine, il ne fait pas très clair dans Bartleby, encore que tout dépende de la lecture qu’on en fait.
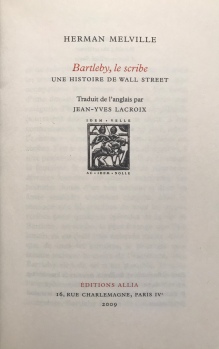
Embauché comme copiste dans un cabinet d’avocat de Wall Street, Bartleby se montre vaillant au début, mais un jour où l’avocat lui demande de comparer un document avec ses collègues, il répond : I would prefer not to. Par la suite, peu importe ce qu’on lui demande, cet homme calme donne toujours la même réponse. Il n’accepte ni ne refuse, mais dit préférer ne pas le faire. Bientôt il ne fera plus rien, se contentant de regarder le mur aveugle en face du bureau, et s’enfermera dans le silence. Un matin, l’avocat se rend compte que Bartleby a dormi à l’étude, qu’il n’a nulle part où aller et n’a pas l’intention de partir. Il lui propose divers accommodements, il pourrait venir rester chez lui ? Non, il préférerait ne pas. Il répond toujours avec douceur, c’est un homme paisible, pâle, mélancolique, sans colère, à peine ironique. Mais voilà, il ne fait pas ce qu’on lui demande et devient fort dérangeant. Tout cela finira mal. (La version originale est en accès libre.)
*
La nouvelle de Melville est d’autant plus forte, disait l’écrivaine Elizabeth Hardwick dans un article de 1981, qu’elle commence en comédie – avec les copistes Turkey et Nippers (Dindon et Lagrinche, Pincettes, Pince-nez, Pinces Coupantes selon les traductions), les deux affligés de vilaines manies – et finit en tragédie.
Je souligne la douceur de Bartleby parce qu’à l’automne 2011, entre le printemps arabe et le printemps érable, les manifestants d’Occupy Wall Street l’ont rappelé à la mémoire de tous en l’érigeant en saint patron de la désobéissance civile. Une chroniqueuse de la revue New Republic, voyant dans la nouvelle de Melville « a devastating critique of Wall Street », rendait hommage à Bartleby : « His solitary resistance holds up the mirror to an inner rot afflicting capitalism that has metastasized into the financial thuggery that caused the 2008 crash. » C’était beaucoup sur les épaules du pauvre copiste. Il est vrai que la parution de Bartleby a suivi de quelques années l’essai de Thoreau sur la désobéissance civile. Mais il faut rappeler que si Wall Street abritait déjà la bourse de New York à l’époque, elle n’était pas ce qu’elle est aujourd’hui, si bien que Melville, qui a grandi à Manhattan, a surtout été intéressé selon plusieurs par l’idée du « mur » qui s’érige peu à peu autour du copiste. Si on avait invité Bartleby à se rallier à un mouvement de révolte, sans doute aurait-il répondu : I would prefer not to. L’homme ne revendique rien, n’exprime aucune impatience. Dans une veine semblable, les éditeurs français du livre ont beau prétendre qu’il sème « un vent de folie », Gilles Deleuze affirmer que son attitude « affole tout le monde », Daniel Pennac dire qu’il « rend cinglé son entourage », en vérité on reste assez tranquille autour de lui, ses collègues empruntent sa façon de parler, son patron est compatissant à son égard, le gardien de prison le traite avec bienveillance. Maurice Blanchot – entre autres commentateurs, parce que Bartleby a fait couler presque autant d’encre que La métamorphose – voyait davantage dans ses refus une façon de se résigner tranquillement à l’inaction.
Héros de la désobéissance civile n’est que l’un des nombreux avatars qu’a incarnés Bartleby au fil du temps. On l’a dépeint en figure du Christ, prophète d’Hiroshima, artiste de la faim, homosexuel inavoué, psychotique inaccessible, créateur face au milieu des affaires, ancêtre des sans-abri hostiles à toute aide, père de tous les squatters, écrivain américain voulant s’affranchir de l’influence anglaise, écrivain qui renonce à écrire, médecin d’une Amérique malade qui diagnostique dans la tâche absurde de copiste le processus d’aliénation par le travail propre aux sociétés industrielles et, attachez vos ceintures, Abraham sacrificateur (Jacques Derrida), musulman dans un camp d’extermination (Georgio Agamben) et féministe (je n’invente rien, c’est l’avis de Martine Delvaux). Bartleby, l’homme à tout faire. Jamais une éponge n’aura été pressée avec autant de vigueur.
*
Dans Les filles en série, Martine Delvaux voit une résistance à la Bartleby dans ces danseuses qui bougent en harmonie sur la même musique, tout en résistant au mouvement général qui les pousse à devenir de simples copies, parce que selon elle les filles n’acceptent ni ne refusent le rôle auquel on les contraint. Elle imagine Bartleby en fille qui s’intègre à une série, sans avoir le choix, mais sans accepter une identité truquée. Sauf qu’on cherchera longtemps la série dans laquelle pourrait bien s’insérer Bartleby. Il est un solitaire absolu, un singleton, tandis que si les danseuses restent peut-être solitaires chacune dans leur coin, leur solitude est en quelque sorte opérationnelle : elles fonctionnent. Bartleby a épousé une solitude qui coupe tous les ponts et mène à sa propre destruction. Il n’y a vraiment aucun rapport entre les deux.
Dans une conférence de 2014 (devenue introuvable) sur La mauvaise féministe, Delvaux invoque à nouveau Bartleby, pour expliquer que si elle s’abstient de prendre position sur tous les sujets qui touchent la situation des femmes (la question du voile par exemple), c’est pour n’écarter aucune femme de la lutte féministe. C’est peut-être une position juste. Sauf que cette fois Delvaux explique que Bartleby est l’employé obéissant qui fait ce qu’on lui demande (c’est moi qui souligne) :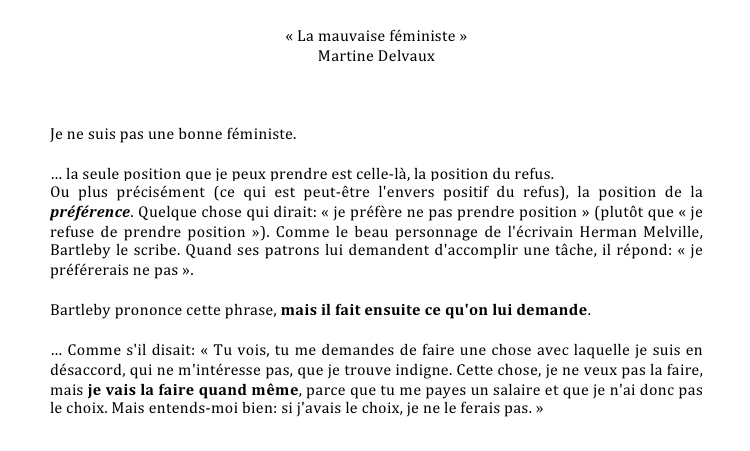
La bourde est monumentale : Bartleby ne fait rien de ce qu’on lui demande. Delvaux refuse de choisir parce qu’elle veut avoir A et non-A, tandis que Bartleby refuse de choisir parce qu’aucun des deux ne l’intéresse. Étendu sur le sol de la prison, face au mur, se laissant mourir de faim, il tourne littéralement le dos à tout. Bartleby ne préfère rien, sa préférence est négative. Il n’est pas en train de mourir comme l’âne de Buridan, faute d’avoir pu choisir entre l’eau et l’avoine, car contrairement aux filles en série qui « ne sont pas sans désir », il ne désire absolument rien.
*
Gilles Deleuze a publié en 1989 un « Bartleby, ou la formule » qui est resté une référence majeure et a fixé pour beaucoup l’interprétation de l’œuvre. À ma connaissance, ceux qui ont écrit dans la foulée de cet influent texte n’ont jamais remis en question l’emploi du mot « formule » pour désigner la réponse que donne constamment Bartleby. Il y a de la rhétorique dans ce terme, des suppositions, un côté mille et une nuits. Formule évoque une formule magique (Deleuze parlera de « formule cabalistique », « alchimique »), un code, un abracadabra ouvrant la porte à un autre monde. Or, dans la bouche de Bartleby, I would prefer not to est une simple réponse à une demande. Si au fil des jours il la répète une dizaine de fois comme une ritournelle, il lui arrive de ne pas faire l’ellipse : I prefer to give no answer. I would prefer to be left alone. I would prefer not to make any change. Et quand l’avocat à la fin lui demande : « How would a bar-tender’s business suit you? There is no trying of the eyesight in that », il répond tout autrement : « I would not like it at all; though, as I said before, I am not particular. »
C’est un premier point d’interrogation. Deleuze entreprend ensuite de démontrer que I would prefer not to n’appartient pas à l’anglais courant. Il admet que l’expression est « grammaticalement correcte », puis emprunte différents détours pour démontrer que d’une certaine façon elle est « agrammaticale ». Il finit par y voir une « anomalie ». Sa démonstration est pour le moins tortueuse. Si étrangère à l’usage courant cette expression, dit-il, qu’elle est « ravageuse, dévastatrice, et ne laisse rien subsister derrière elle », que « Melville invente une langue étrangère qui court sous l’anglais ». Il note le maniérisme, la terminaison abrupte, et conclut à la « bizarrerie ». Il dit sentir « la sourde présence de la forme insolite » même quand Bartleby ne l’emploie pas, et qu’à chaque occurrence « on a l’impression que la folie croît ». Toutes ces hyperboles sont excessives :
1 – Bartleby aurait normalement dit, selon Deleuze, I would (ou I had) rather not. Or les dictionnaires définissent I would rather par les mots « I would prefer », et I would rather not par « I would prefer not to ». Il n’y a donc pas d’écart par rapport à la norme. Si l’avocat est étonné d’entendre le mot prefer, c’est qu’il y a un écart par rapport à l’usage courant, ce qui est une tout autre affaire. Et cet écart est faible puisque les autres copistes de l’étude lui empruntent le mot machinalement.
2 – Deleuze compare la réponse de Bartleby à des phrases déboitées, telles les étranges tournures du poète E.H. Cummings (« He danced his did »), les procédés de Raymond Roussel ou des tours comiques du genre « J’en ai un de pas assez ». Or Bartleby ne défait pas du tout la langue anglaise, sinon il le ferait à tout propos. Au contraire, il s’exprime toujours de façon correcte. Sa réplique est une ellipse ordinaire, tout comme on dirait dans la langue de tous les jours I’d like to ou I wouldn’t like to.
3 – Ce que Bartleby évite de dire, ce n’est pas I would rather not, comme le soutient Deleuze, mais I will not, comme le montre cet échange où l’avocat lui demande d’aller au bureau de poste :
“I would prefer not to.”
“You will not?”
“I prefer not.”
C’est Melville qui souligne. Bartleby ne dira pas non plus comme monsieur et madame Tout-le-Monde I’m not fussy, mais I am not particular. Ce n’est pas qu’il cherche à épater la galerie, seulement il est trop singulier pour parler dans la langue de tous les jours. Sa manière est un peu précieuse, avec un accent de dérision, mais sans plus – ce qui convient à ce personnage soigné mais livide, à son attitude, sa raideur, son épaisse solitude.
La grammaire n’est pas en jeu. L’explication qu’avait déjà donnée Hardwick en 1981 est bien plus intéressante : la tournure colle à l’étrange personnage sans être elle-même étrange. Démonstration par l’absurde, imaginons un instant que Bartleby s’exprime dans une langue familière :
« One might for a moment sink into the abyss and imagine that instead of prefer not he had said, “I don’t want to” or “I don’t feel like it.” No, it is unthinkable, a vulgarization, adding truculence, idleness, foolishness, adding indeed “character” and altering a sublimity of definition. »
Faites parler Bartleby comme tout le monde, et le personnage s’écroule. La récente traduction (« Le Livre de Poche », 2019) qui rend I would prefer not to par J´aimerais mieux pas, sous prétexte de faire parler Bartleby comme un copiste ordinaire, est presque une erreur sur le personnage.
*
On a répété jusqu’à plus soif que Bartleby n’accepte ni ne refuse, qu’il ne dit ni oui ni non, qu’il s’abrite dans une zone indéterminée où Melville le tient jusqu’au bout. Or si en paroles c’est vrai qu’il n’accepte ni ne refuse, dans les faits il refuse. Il n’est pas torturé comme Kafka par les choix à faire, au contraire il est d’une limpidité désarmante : Je préfère ne pas le faire, et comprenez-moi bien, je ne le ferai pas. Son patron peut bien songer à le mettre en demeure (quoiqu’il s’en sente incapable, l’atmosphère est trop tendue entre les deux hommes) : Bartleby, de deux choses l’une, ou vous faites ce travail ou vous ne le faites pas. Mais il sait que l’autre ne discute pas dans ces termes-là, qu’il lui répondrait inlassablement : I would prefer not to do it. Cette réponse ferme et polie est sa façon à lui de refuser, comme s’en rend bien compte l’avocat : « it was generally understood that he would prefer not to—in other words, that he would refuse pointblank ». Il n’est pas dans un entre-deux. Sa réponse désarçonne son interlocuteur, tue dans l’œuf toute tentative de le ramener chez le commun des mortels. Il décide d’arrêter d’écrire du jour au lendemain sans que personne, même avec la plus grande amabilité du monde, parvienne à lui faire changer d’idée. Deleuze a-t-il raison d’affirmer qu’il exprime « un néant de volonté » ?
Blanchot, premier commentateur français de l’œuvre, parlait spontanément de « refus » dans L’écriture du désastre, interprétant la réponse de Bartleby comme une abnégation, un abandon du moi, un « délaissement de l’identité ». Dans un article de la revue Europe paru en 2002, Michel Imbert a parlé d’un non nonchalant, d’une préférence pour le « non-être », comme si la mort exerçait déjà « un droit de saisie » sur lui. À travers cet homme simple qui affirme sereinement le droit d’être désespéré, Melville a créé un personnage presque aussi hors norme que Gregor Samsa métamorphosé.
*
D’ailleurs, comme le souligne Deleuze, Bartleby est un « original » au sens où l’entend Melville dans les pages de son roman L’escroc à la confiance : un personnage unique qui, à la manière d’Hamlet ou de Don Quichotte, jette sur son entourage une étrange lumière où tout s’éveille, comme celle « qui accompagne, dans la Genèse, le commencement des choses ». Mais pour retrouver aussi en lui les figures de l’ange, de la créature d’innocence, du psychotique, de l’exclus de la raison, face à l’avocat qui serait un prophète ou un témoin, Deleuze doit sortir de l’œuvre et explorer toute la palette des personnages melvilliens, du capitaine Achab à Billy Budd. À lui seul, Bartleby ne lui fournit pas les clés qu’il cherche. Mais il sait où il s’en va. Quand il dit percevoir une « langue étrangère » à travers I would prefer not to, langue qu’il finit par appeler « le Déterritorialisé » – parce que les personnages de Melville s’enfuient, prennent la mer comme Achab, comme tous ces personnages qui prennent la route dans les romans américains – on a compris que son entreprise était d’amener Bartleby sur ses propres terres si on peut dire, celles de L’Anti-Œdipe (« je ne suis pas des vôtres, je suis le dehors et le déterritorialisé ») et des mille plateaux, là où le copiste en cessant de copier rompt avec la verticalité du pouvoir et, partant, abolit la fonction paternelle. C’est énorme. Le filon est certes intéressant : l’humanité sauvée par des rapports fraternels purs et simples, où chacun est frère de l’autre, et les femmes, j’imagine, sœurs des uns et des autres… Mais on commence à se sentir loin de Bartleby.
La fin du récit tourne bel et bien autour de l’idée de sacrifice ou de perdition : si Bartleby lui-même ne peut être sauvé, écrivait Hardwick, au moins l’avocat, ébranlé par son copiste, perdu pendant quelques jours, errant dans son cabriolet, sauve peut-être son âme grâce à ce frisson de « mélancolie fraternelle » que lui donne Bartleby. C’est un moment d’épiphanie pour lui, d’ouverture inattendue à l’Autre, incarné dans ce petit homme mince, sec et discret. Mais cet homme ne marche plus avec les autres, ne tend la main vers personne, se tient à l’écart, animé par un « candide nihilisme » selon le mot de Borges. Loin d’être anxieux, il embrasse un vide tranquille comme une journée de printemps qui ne sert plus à rien. Son intériorité est devenue légère, grosse, disait Hardwick, comme « une boite ne contenant qu’une paire de boutons de manchettes ». À la fin, après quelques jours d’errance, mû par un mécanisme de défense, l’avocat retombera sur ses pattes, triste, quelques morceaux en moins, avec une pensée pour cette pauvre humanité, « Ah ! Bartleby ! Ah ! l’humanité ! »

*
Les commentateurs américains ont longtemps vu dans la nouvelle de Melville le désir de créer, sous l’influence des penseurs de son époque, un personnage qui se dégage de tout déterminisme afin d’exercer son libre arbitre, quitte à en mourir. D’autres y ont plutôt vu l’histoire d’un amour impossible ; encore aujourd’hui un critique britannique parle des « queerer possibilities of the story », thèse confortée par certaines conversations entre l’avocat et son copiste, quand par exemple Bartleby lui dit : « I would prefer not to quit you ». Il reste que deux grandes lignes d’interprétation ont prévalu sur toutes les autres : soit Bartleby en opposant politique, soit Bartleby en écrivain arrivé à la limite de la littérature.
Deleuze a fait une lecture largement politique. Il écoute la petite phrase de Bartleby comme un autre celle d’une sonate qui lui ouvre tout un monde. Mais pour entendre à travers elle l’annonce de la société future, égalitaire dont aurait rêvé Melville, il écarte du revers de la main, dès la première ligne de son texte, la lecture littéraire, c’est-à-dire l’idée de voir dans Bartleby « une métaphore de l’écrivain », le symbole de celui qui cesse d’écrire. Les lectures de Bartleby en homme politique – résistant messianique et révolutionnaire, précurseur des grands combats anticapitalistes – ont l’inconvénient de s’éjecter de l’œuvre à mi-parcours, d’oublier la deuxième moitié de l’histoire (je ne suis pas le premier à le remarquer), que Bartleby a choisi de mourir, d’aller droit vers un silence définitif. On voit dans Bartleby une énigme à résoudre, et on la résout, mais en oubliant l’histoire qui nous est racontée.
L’avantage décisif de l’interprétation littéraire est de rester fidèle au personnage de Melville. Interprétation banale, plus sobre que les fracassantes lectures politiques, mais plus en accord avec la sobriété et le silence du copiste lui-même, et avec le désarroi de l’avocat, le léger déséquilibre qu’il ressent. Car le fait majeur du récit est la décision prise un jour par Bartleby de ne plus rien faire, autrement dit, puisqu’il est copiste, de ne plus écrire. « Quand je lui demandai pourquoi il n’écrivait pas, raconte l’avocat, il me répondit qu’il avait décidé de ne plus écrire (he had decided upon doing no more writing). »
C’est à partir de cette constatation évidente qu’Enrique Vila-Matas a écrit Bartleby et compagnie en 2000, un petit livre où il expose une galerie d’écrivains qui ont mis fin à leur art à un moment de leur vie où on se serait attendu qu’ils produisent encore longtemps. Un cas extrême est celui du prolifique Robert Walser qui s’est muré dans le silence pendant les vingt-trois dernières années de sa vie. Et il y a eu Rimbaud, Salinger, Juan Rulfo, d’autres. Figure aussi dans sa liste le peintre Marcel Duchamp qui a renoncé jeune à toute forme d’art après avoir produit des œuvres éblouissantes, et on pourrait y ajouter des compositeurs comme Ives ou Sibelius qui se sont tus bien avant de mourir.
Bartleby et compagnie nous emmène dans une sorte de promenade devant les tableaux d’une exposition, puisque ces écrivains ont connu des destins très différents. Mais le narrateur qui nous guide gambade entre écrivains réels et imaginaires, il met aussi dans sa liste des « auteurs sans livres », inclut un hétéronyme de Pessoa (le baron de Teive), évoque par la bande Flaubert ou Mallarmé pour des œuvres inabouties (le « Livre »), Tolstoï pour sa fuite finale, trois vies pourtant remplies à ras bord de littérature. Il va sans dire que la visite est fort divertissante. Mais le nom « bartleby » devient sous sa plume, plus qu’un nom commun, un mot passe-partout pour faire entrer dans le club toutes sortes d’écrivains qui ont mal tourné, ont abandonné des œuvres ou ne se sont pas pointés du tout – dont souvent on ne sait même pas s’ils ont connu la plénitude de la création. Si Vila-Matas a tant multiplié les bartlebys comme un collectionneur, c’est parce qu’au fond il n’aime pas tellement Bartleby. 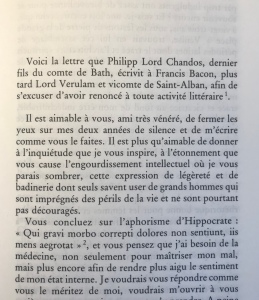 Relisant le plus célèbre plaidoyer sur le renoncement à l’écriture, la Lettre de Lord Chandos, où Hofmannsthal explique que la faiblesse des mots face à l’infini des choses rend ridicule la prétention d’écrire, il reste au contraire vertueusement persuadé qu’il vaut toujours mieux proposer un regard neuf sur la réalité que de se taire. Inversement, quand il louange le mutisme d’un Oscar Wilde dans les deux dernières années de sa vie, qu’il aurait vécues selon lui dans « un bonheur immense », heureux de ne plus écrire (rien à voir avec Bartleby vraiment), il m’a semblé tordre un peu la réalité : Wilde n’a-t-il pas fini ses jours dans la déchéance, se décrivant lui-même comme une « épave à bout de nerfs » ?
Relisant le plus célèbre plaidoyer sur le renoncement à l’écriture, la Lettre de Lord Chandos, où Hofmannsthal explique que la faiblesse des mots face à l’infini des choses rend ridicule la prétention d’écrire, il reste au contraire vertueusement persuadé qu’il vaut toujours mieux proposer un regard neuf sur la réalité que de se taire. Inversement, quand il louange le mutisme d’un Oscar Wilde dans les deux dernières années de sa vie, qu’il aurait vécues selon lui dans « un bonheur immense », heureux de ne plus écrire (rien à voir avec Bartleby vraiment), il m’a semblé tordre un peu la réalité : Wilde n’a-t-il pas fini ses jours dans la déchéance, se décrivant lui-même comme une « épave à bout de nerfs » ?
Vila-Matas a inscrit quelques femmes à son catalogue. Leurs portraits ne sont pas très convaincants. Il examine de près le destin de quatre écrivaines, mais elles n’ont jamais existé. Il signale le cas de María de la O Lejárraga, qui a écrit en grande partie les œuvres de son mari, le « dramaturge féministe » Gregorio Martínez Sierra, puis s’attarde à celui de Marianne Jung, auteure de quelques poèmes attribués à Goethe, mais qui a écrit une seule fois dans sa vie : il est difficile de regarder l’une et l’autre comme des bartlebys. Il doit sûrement y en avoir dans la littérature mondiale. Il faut dire que le livre accorde une très grande place au monde hispanophone et lusophone. Patrick Tillard, dans une longue étude malheureusement un peu verbeuse, range Colette Peignot au nombre des bartlebys. Peignot a vécu une vie « négative », c’est le moins qu’on puisse dire, où elle a cherché à « échapper au langage » surtout par l’érotisme, mais si elle n’a rien publié de son vivant, elle a en fait beaucoup écrit.
Melville lui-même a publié Bartleby à l’aube d’une période de trente ans où, devenu inspecteur des douanes, il n’écrira plus que quelques poèmes, puis Billy Budd avant de mourir. Ce roman posthume est la preuve qu’il était resté en possession de tous ses moyens. D’ailleurs certains considèrent aujourd’hui son long silence comme une pure légende, à moins de voir dans la poésie un genre facile et inférieur. « L’auteur de “Bartleby le scribe” ne s’est jamais tu », écrit Philippe Jaworski dans sa préface au Melville de la Pléiade, IV. On est donc en droit d’affirmer que, passant du roman à la poésie, avec un détour par la nouvelle, Melville n’a pas été vraiment un bartleby. La même chose vaut pour Hofmannsthal qui, après la Lettre de Lord Chandos, a écrit moins de poèmes mais beaucoup d’autres textes. Il est cependant facile de comprendre que rien n’a pu empêcher l’un et l’autre – Melville à 34 ans après des échecs de publication, Hofmannsthal à 28 ans en crise existentielle – d’avoir été prêts à faire leurs adieux à la littérature, puis, heureusement, d’avoir continué dans une autre direction. Il en existe des écrivains qui ont repris la plume après de longues périodes d’inactivité, mais ce n’est pas ce qui s’est passé avec eux. Vila-Matas mentionne Thomas de Quincey qui s’est libéré du « syndrome de Bartleby » après une cure de silence de vingt ans, l’américain Henry Roth, trente ans de silence avec une œuvre à chaque bout, et le péruvien Emilio Adolfo Westphalen, quarante-cinq ans d’inactivité littéraire entre deux recueils de poésie. Marcel Duchamp a réalisé en secret une œuvre inattendue à la fin de sa vie. On peut bien sûr pour s’amuser les voir comme des bartlebys qui ont ressuscité.
*
L’idée de fond, qui reste fascinante, est celle de l’écrivain qui crée à merveille et qui un jour arrête la machine. Dans un petit roman où il invente un bartleby plus ou moins sûr de lui, Philippe Delerm suggère que des écrivains auraient renoncé à la création parce qu’elle leur a semblé « dérisoire, inférieure en tout cas à l’intensité de la vie réelle », comme si le passage de la première à la seconde était une montée en intensité. C’est une vision des choses fort charitable. Des écrivains ont sûrement renoncé à écrire pour goûter à la douceur de l’inactivité ou au calme d’une vie contemplative, ou pour ne rien faire du tout, l’activité suprême selon Oscar Wilde, – mais on conçoit mal qu’un Rimbaud se détourne de la littérature pour aller chercher les sensations plus fortes de la fête.
Arrêter d’écrire pour faire autre chose n’a rien à voir avec la nouvelle de Melville. Comme dans la lecture politique, c’est abandonner Bartleby à une fourche dans le chemin. Le copiste de Wall Street arrête pour ne plus rien faire. Si on opte pour une lecture littéraire de l’œuvre, il faut bien voir que Bartleby met fin à son travail d’écriture en même temps qu’il renonce à la vie en général. Les deux sont emportés dans le même désenchantement, le même souffle destructeur. Même si Bartleby est visiblement aspiré par le néant, Melville n’est pas en train de faire un éloge du suicide, mais à moins de faire passer un rouleau compresseur sur son récit, on doit admettre qu’il raconte l’histoire d’un personnage chez lequel vivre et écrire sont inséparables.
Le dénominateur commun des bartlebys à qui le titre revient de plein droit est d’avoir laissé leur seul silence en guise d’explication : on ne sait jamais si celui ou celle qui a arrêté d’écrire, qui semble désormais paralysé, a agi par soif de libération, par suicide littéraire ou par impuissance créatrice. Cette façon de lire la nouvelle de Melville a le mérite de préserver à Bartleby son caractère énigmatique. Dans un passage engageant de son texte, Deleuze lui-même écrit que l’acte fondateur du roman américain a été le même que celui du roman russe, soit d’« emporter le roman loin de la voie des raisons », de créer des personnages qui « gardent jusqu’au bout leur mystère et défient logique et psychologie ». Ce qui compte, c’est que le roman « saisisse l’intimité de la vie et de la mort ». Le romancier est un témoin, explique-t-il, il n’a pas « le regard du psychologue ». Il est cocasse que ce rappel de l’emprise de la psychologie sur la littérature aujourd’hui, ce rappel que les plus grandes œuvres ne sont pas des réponses à une question, vienne d’un si vieux texte qui ne fait même pas cent pages.
♠
Quelques notes. C’est dans une lettre de 1951 parue pour la première fois en 1998 que Camus vante Melville au détriment de Kafka. La lettre est facilement accessible via le site JSTOR. Les commentaires de Borges, qui datent de 1944, apparaissent dans son Livre de préfaces. L’emploi du mot « musulman » par Agamben pour désigner Bartleby vient du jargon des camps d’extermination, où on appelait ainsi le prisonnier qui était dans un tel état de délabrement physique qu’il était considéré comme ni mort ni vivant. Origine inconnue, mais Primo Levi l’employait.
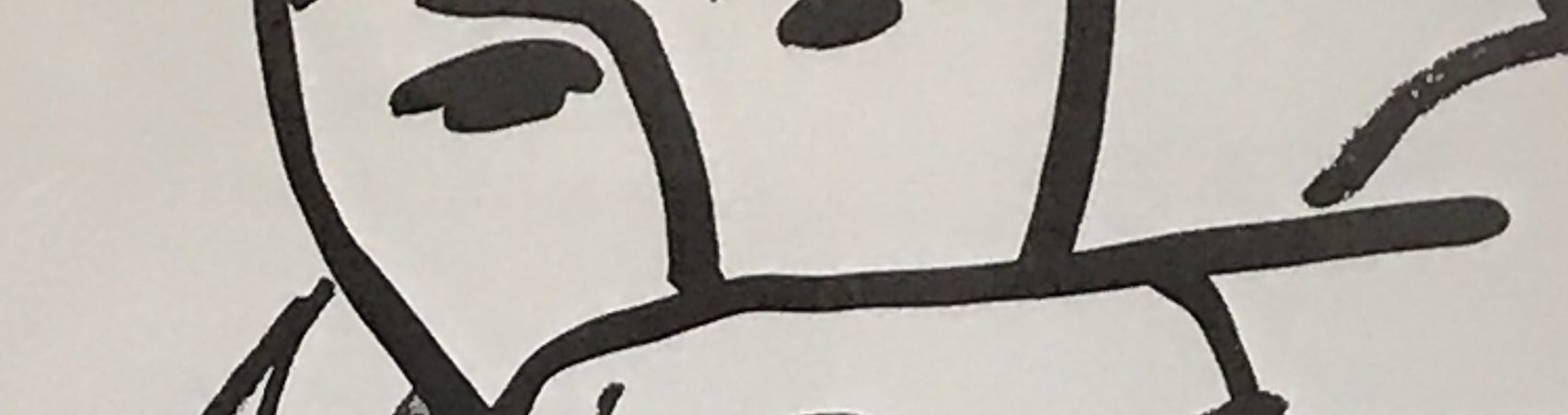
3 choses :
1) Comme je n’ai pas lu le récit de Melville, je comprends difficilement qu’on puisse dire que Bartleby écrit. N’accomplit-il pas en réalité un « simple » travail de copiste ? À moins qu’on s’exprime ainsi en vertu d’une sorte de métonymie, de glissement permettant de passer du travail du copiste à celui de l’écrivain. Le travail du copiste représentant symboliquement le travail de la « création littéraire ».
2) Le silence de l’écrivain. Il se pourrait que cesser d’écrire consiste en une sorte de victoire et non une défaite. Ce contre quoi l’on s’acharnait, ce contre quoi on luttait (monstres de toutes sortes, réels ou imaginaires) n’est pas forcément vaincu par qui cesse d’écrire (du reste, cesser d’écrire n’est pas cesser de vivre). Une force intérieure nouvellement conquise peut permettre à l’écrivain de s’inscrire désormais dans le silence. Ce silence peut résulter d’un choix plus que d’une perte de moyens. Dans sa chambre, dans son cabinet de travail, celui qui écrivait peut maintenant accomplir en se taisant le tour de force auquel référait Pascal, lorsqu’il disait que peu d’hommes sont capables de demeurer assis dans une chambre sur une chaise de paille.
3) Votre étude me fait découvrir un récit dont je n’avais que vaguement entendu parler (par Pennac, je crois, à la télé : lors d’un récent passage à La Grande Librairie). La synthèse (des propos des uns et des autres) et votre propre analyse sont fort stimulantes. Il y a là beaucoup d’idées. Je peux m’en nourrir. Malheureusement je ne pourrai pas lire cette œuvre de Melville, faute de maîtriser suffisamment la langue anglaise. Alors, lire en traduction ? I would prefer not to! Je sais, il faut passer par ce passage, une porte étroite, mais ce que vous relatez au sujet de la fortune de la fameuse réplique, tous ces aléas et curiosités une fois traduite, montre encore une fois à quel point les traductions, un mal pour un bien, déforment presque autant que les miroirs de notre enfance au parc Belmont.
J’aimeAimé par 1 personne
Trois réponses :
1)
La distinction entre copier et écrire a souvent été au cœur des discussions sur Bartleby. On a soutenu que Melville voulait que les écrivains américains cessent de copier les anglais, ou voulait nous dire que toute la littérature n’était que copie (quand on pense à tous les livres qui se ressemblent…), et j‘ en passe. On y a même vu un débat sur les droits d’auteur (nombreux articles là-dessus aux USA et même en France, Derrida par exemple). D’ailleurs beaucoup de juristes américains se sont penchés sur ce texte. Mais de toutes les interprétations que j’ai vues, la plus convaincante m’a paru, à moi, être celle de « la lecture littéraire ». À noter aussi que Melville n’a pas été le seul écrivain autour de 1850 aux USA à raconter une histoire de copistes. C’était dans l’air.
2)
J’évoque cette lecture du silence que vous faites quand je parle d’Oscar Wilde. Je ne l’écarte pas complètement non plus dans la « lecture littéraire » que je fais, où contre beaucoup d’analyses je cherche à préserver le mystère qu’il y a dans la nouvelle. Mais j’imagine difficilement que c’est ce que Melville aurait voulu dire. Ça ne cadrerait pas avec tout ce qu’il a écrit et tout ce qu’il a vécu, encore moins avec l’histoire qu’on a devant les yeux. C’est le problème de beaucoup des interprétations qu’on a faites de cette œuvre, voir ma liste au début de l’article : on prend son élan sur Bartleby et on s’en va sur une autre planète. Vila-Matas fait la même chose à plusieurs endroits de son livre. Le voyage est sûrement intéressant, mais j’ai essayé de rester avec Melville.
Comparaison un peu farfelue : c’est comme la Dame au petit chien de Tchekhov. On ne sait pas ce qui va arriver à Gurov et Anna, la nouvelle a une fin ouverte, mais les gens qui l’adaptent au cinéma le savent eux. De toutes les interprétations que j’ai vues, celle que je défends me semble être la plus plausible et la plus fidèle à Melville.
Je ne me suis pas servi de son œuvre pour exposer mes idées — ce que je reproche à Deleuze ou à Martine Delvaux d’avoir fait. C’est de la critique littéraire, ce n’est pas voici-ma-vision-du-monde-à-moi.
3)
Je suis retourné vérifier l’anglais en grande partie à cause des interprétations faramineuses que j’ai lues en français (c’est le cirque, vraiment). J’ai parcouru aussi diverses traductions. Regardez les photos dans mon article, elles recommandent celle de Jean-Yves Lacroix, qu’a aimée aussi je crois notre ami Jean-Marc Lefebvre. Et il y a celle de Pierre Leyris et de Philippe Jaworski. Je n’ai pas voulu discuté des traductions dans mon article. Voici un exemple qui explique : On a parlé deux fois de Bartleby dans l’émission qui fait du vacarme l’après-midi au Québec. Et chaque fois toute la discussion a porté sur la traduction française de IWPNT. C’est ridicule. Ces gens-là ne se rendent pas compte qu’après cinq minutes ils ne parlent plus du tout de Melville. C’est encore un tremplin pour partir dans toutes sortes de directions. J’ai essayé de faire comme Thomas Bernhard et d’aller « dans l’autre direction » — celle qui nous ramène à Melville. De ramener l’analyse au destin du personnage plutôt que de bloquer sur une petite phrase.
J’aimeAimé par 1 personne
Ce que Melville dit dans ce texte ( Bartleby ), ce pourrait être ceci: « Écoutez. Je sais ce qu’est un livre. Je sais même ce qu’est un grand livre. Je pense même que ce livre, que ce grand livre je l’ai écrit. Mais qu’y ai-je trouvé, moi qui l’ai écrit ? Rien de plus que ma vie, mais toute ma vie. Rien de plus que cette fureur de connaissance, de toute la connaissance. Mais ce n’est pas à la fureur que j’aspire: c’est à ce qui est au-delà de la fureur. Et à cela je n’y suis pas parvenu. J’ai eu beau écrire Mardi, Moby Dick et Pierre, de même que tout ce qui n’est pas venu d’eux, de tout ce qui est mort dans l’espace de ces livres; j’ai eu beau me colletailler désespérément avec tous les mots, je ne suis pas arrivé à me rendre pacifique, je ne suis pas arrivé à résoudre le problème des contraires qu’il y a en moi. Et maintenant que je possède mon métier et que je pourrais montrer au monde quel ingénieux fabricant de livres je peux être, je m’y refuse. Là n’est pas ma vérité. Je ne suis pas un homme de lettres. Je suis un homme, Je ne suis pas un homme de lettres. Je suis un homme tourmenté, qui cherche de la paix, qui la désire, qui l’appelle, qui la supplie et qui l’invoque. Ce qui, à dire vrai, ne peut que me rendre étranger à toute histoire, aux ficelles que toute histoire exige. Ce que je dois écrire, ce que j’ai toujours voulu écrire, ce n’est pas une romance. Ce que je dois inventer, ce que j’ai toujours voulu inventer, ce n’est pas une histoire qui fasse le bonheur des lecteurs, mais moi. Je me suis questionné et j’ai poussé mon questionnement à l’extrême limite, et c’est de cela qu’est venu Bartlléby – cette musique, cette lancinante musique, ce simple et presque dérisoire I would prefer not to. Car tout le reste de ma vie , je pourrais faire comme si. Comme si je pouvais rester éternellement l’homme qui a vécu chez les cannibales. Comme si je pouvais fabriquer sans relâche les contes de bonnefemme de Fenimore Cooper. Par Bartléby, je dis non à ce genre de langage. Maintenant, dépouillé de tout, il me faudra en chercher un autre. Maintenant, il me faudra me recréer absolument. »
Monsieur Melville 3. L’après Moby Dick ou la souveraine poésie, de Victor-Lévy Beaulieu, p: 61
J’aimeJ’aime
Malheureusement, pendant ces semaines-là, je n’ai pu mettre la main sur le livre de VLB. Merci de le rappeler.
J’aimeJ’aime
Suite : Je tends à voir cette période comme une passe dans la vie de Melville, soit dit en amateur. Donc je me retrouve un peu dans le texte de VLB. Je ne connais pas évidemment le reste de son livre, mais les ardents melvilliens ne voient pas tous de grandes œuvres dans les romans qui ont suivi Moby Dick. Qui sait si une sorte d’écœurement n’avait pas saisi Melville bien avant Bartleby. En tout cas, il a excellé dans le « conte » (Bartleby en est un, « a tale »). Puis est revenu en force dans le roman. C’est mon impression, pas un verdict d’expert. Il semble par ailleurs y avoir des points communs entre Billy Budd et Moby Dick.
J’aimeJ’aime
J’ai lu votre texte deux fois, une première en admirateur et en aventurier, j’allais d’une découverte à l’autre, j’apprenais, j’étais ébloui, tous ces liens et références que je ne connaissais pas, bref j’allais dans le texte avec de grands yeux et quand j’en suis sorti, mon impression fut que j’avais lu quelque chose d’important, mais quoi ? qui plus est, je n’ai plus beaucoup de mémoire immédiate; au matin suivant, je l’ai donc relu, plus calmement et j’ai, je crois, mieux vu, du moins dans cette partie qui me touche davantage et que vous avez formulée avec l’interrogation suivante: – Bartléby en écrivain arrivé à la limite de la littérature ? Le hasard a voulu qu’en même temps que votre texte je sois en train de lire Marthe Robert qui se pose les mêmes questions. Je n’ai aucun talent pour l’essai, je ne m’y risquerai pas; mais toute réflexion sur l’écriture , sur le sens qu’il y a ( ou qu’il n’y a pas ) à se pencher sur une feuille et tracer des signes me passionne, j’ai passé ma vie à faire ça et comme je suis rendu au soir tard, je ne puis que me dire que ces milliers de signes je les ai tracés pour rien, si ce n’est finalement que pour mon propre bonheur; mieux encore, écrire tous les jours pour en arriver à mieux goûter ou mieux ressentir la beauté qu’il y a dans certaines écritures, oui; ou avec encore plus de franchise, ceci: en arriver parfois à écrire une page qu’on trouve belle, qu’on trouve émouvante et qui supporte des relectures, être à nouveau ému, puis se dire: à quoi bon ? à quoi ça sert ? sur ce point précis, je retourne à Marthe Robert et la cite: » Demander à quoi ça sert, en l’occurrence, c’est déjà fournir la réponse, et à quoi ça sert en effet si l’on ne comprend pas qu’0scar Wilde ait pu dire sans crainte de se ridiculiser que la mort de Rubempré dans Splendeurs et misères des courtisanes est le plus grand chagrin de sa vie? Si l’on ne tient pas la première phrase de Bouvard et Pécuchet pour un événement plus considérable que bien des faits arrivés ? Si on ne se passionne pas pour des créatures de papier au point de se croire intéressé à leurs affaires, à leurs amours et à leurs haines de papier ? La littérature, ça ne sert et n’a jamais servi à rien, là est justement son secret, qu’il ne lui est pas permis de violer.» Est-ce que je m’éloigne de Bartléby ? Je dis tout simplement ce que votre texte a provoqué en moi.
J’aimeJ’aime
L’essai peut prendre toutes sortes de formes comme le montre ce texte… où notre livide Bartleby, retourné comme un doigt de gant en quelque sorte, devient le symbole même de la passion de l’écriture.
J’aimeJ’aime
Merci pour ces analyses fort intéressantes et documentées. Je vous propose celle d’Olivier Rey dans son « Testament de Melville », que vous n’avez pas citée. https://lesamisdebartleby.wordpress.com/2020/02/10/olivier-rey-a-propos-de-bartleby/
J’aimeAimé par 1 personne
Bonjour,
J’ai lu avec grand intérêt votre commentaire que je trouve très juste à bien des égards et notamment parce qu’il respecte une distance critique ramenant le propos de la nouvelle à quelque chose de nettement moins projectif, moins fantaisiste que certains grands noms qui ont commenté ce texte, tel Deleuze, Dérida etc.
Vous avez beaucoup discuté et avec raison les difficultés de traduction de la formule « I would prefer not to ».
J’aurais aimé connaitre votre point de vue sur la traduction de scrivener en scribe, ce qui n’est pas franchement un métier dans les années 1850, le choix du sous-titre « une histoire de wall street », la traduction de « avoué » dont on comprend bien qu’il est un homme important, un homme de loi, mets au fond, est-il notaire, avocat, magistrat?
J’aimeJ’aime
Je suis bien d’accord avec vous sur l’étrangeté du mot scribe dans cette histoire. Le type est visiblement un simple copiste comme ses excentriques collègues. Mais ça reste embêtant pour les traducteurs parce que, dans le texte de Melville, qui emploie les deux mots, « scrivener » revient bien plus souvent que « copyist ». Le fait aussi que Melville lui-même présente d’abord Bartleby par la périphrase « law copyist », comme si « scrivener » tout nu aurait risqué d’intriguer son lecteur des années 1850, est révélateur de la particularité de ce mot, qui n’est d’ailleurs plus en usage en anglais, je crois. Les traducteurs, comme Jaworski dans sa solide traduction (Pléiade), alternent entre les deux mots en suivant Melville. Un autre traducteur (Livre de poche Classique) pour éviter le mot scribe a gauchement mis d’affilée deux périphrases (« copistes d’actes juridiques, ou commis aux écritures »), puis ailleurs a par exemple rendu « scrivener » par « gratte-papier », ce qui change complément le niveau de langue. C’est toujours risqué de s’éloigner de l’original dans le cas d’un classique. Mieux vaut un pis-aller qu’une excentricité, à moins bien sûr d’être un génie.
Pour ce qui est du narrateur, le même Jaworski est d’avis que sa profession d’homme de loi (« lawyer ») correspondrait aujourd’hui à diverses tâches d’avocat, d’avoué et de notaire.
« Une histoire de Wall Street » traduit littéralement l’anglais. Je ne déteste pas, il se dégage un parfum d’époque dans cette façon directe d’évoquer Wall Street.
Je suis bien content de vous voir douter comme moi de l’analyse de Deleuze. Je n’y ai jamais cru une seconde, c’est comme ça.
Il va sans dire que vos commentaires me font très plaisir. Mes textes sont toujours heureux de recevoir de temps en temps des visiteurs comme vous.
J’aimeJ’aime