Envoûté par Dernier jour à Budapest, le roman de Sándor Márai, je suis allé me promener dans ses œuvres, difficiles à faire traverser l’Atlantique à cause de la pandémie, mais heureusement disponibles dans des librairies de Montréal. Puis sautant entre les générations d’écrivains hongrois, j’ai reculé jusqu’à Gyula Krúdy (1878-1933) que Márai décrivait dans son Journal comme le plus grand écrivain hongrois de la première moitié du 20e siècle – et revisité Imre Kertész, entre lequel et Márai les points de friction ne pouvaient manquer.
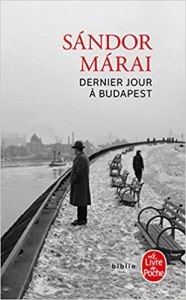
1. Dernier jour à Budapest
Márai se met dans la peau de son maître, un Gyula Krúdy vieillissant, qu’il fait déambuler pendant une journée entière dans les rues, les cafés et les thermes de la ville, incarné dans la figure de son alter ego, l’antihéros de plusieurs de ses romans, Sindbad le marin, solitaire comme son singulier pays et sa langue aux origines mystérieuses. Le titre du livre veut d’ailleurs dire en hongrois : « Sindbad rentre chez lui ». Cette journée-là, le vieux marin revoit les lieux qu’il a mille fois fréquentés tout au long de sa vie, pense à l’hiver d’autrefois « qui avait sombré dans le temps pour ne plus demeurer qu’une saison de soucis », et revit cette Hongrie d’avant la guerre où régnaient les goûts anciens de la vie et de l’esprit, à laquelle il peut maintenant s’abandonner, l’âme en paix comme un sage oriental, dit son admirateur. J’ai rarement lu un texte aussi amoureux de sa patrie. Le livre regorge de nostalgie et de sensualité.
C’est la patrie qui vit « dans les mots des poètes et des écrivains, dans les œuvres des savants, elle vivait dans le travail, les croyances, le mode de vie des Hongrois anonymes, ainsi que dans le souvenir des hauts faits des aïeux, elle vivait dans la lumière des paysages de Transylvanie, du Hortobágy, du Balaton et des Tatras ». C’était l’époque où les écrivains bavardaient nonchalamment de leurs problèmes d’argent et de leurs amours, des jeunes boulangères auxquelles ils faisaient la cour, tout en jugeant au passage de la pureté stylistique du discours que venait de prononcer un ministre. Sindbad déjeunant en silence célèbre ce monde perdu où on « nouait encore une serviette à son cou et, fourchette et couteau à la main, se penchait sur le pot-au-feu, le regard grave et des éclairs plein les yeux, prêt à transpercer de part en part tous ceux qui oseraient répéter un cliché tenace consistant à affirmer qu’il était impossible de se procurer de la viande de bœuf savoureuse ailleurs qu’à Vienne ».
Pauvre à la fin de sa vie, incapable de payer son électricité, forcé de publier à compte d’auteur, la centaine de livres qu’il avait écrits ignorés par le public, rangé dans la catégorie des « écrivains pour écrivains », Krúdy était épuisé. « La vie l’avait contraint à se battre toute son existence avec la lettre et avec son âme, avec le démon et d’autres ennemis plus dangereux encore que ceux que saint Georges, le tueur de dragon, aurait pu affronter : les circonstances indignes, l’ignorance, la vulgarité, la fausse littérature, la sourde cruauté ». Cet homme intéressé ni par l’étranger ni par le changement avait fini par se taire, conscient que « tous ses écrits n’ont même pas déplacé un grain de sable dans son pays ».
Dernier jour à Budapest est comme un témoin que 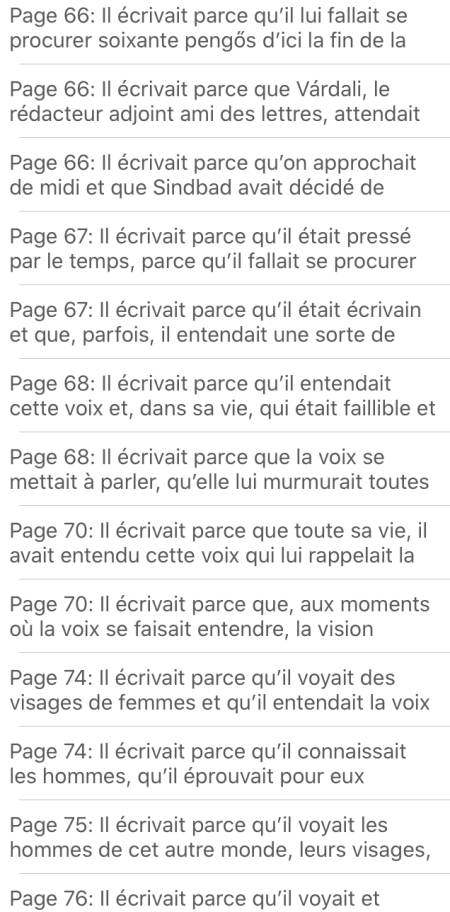 Márai prend des mains de Krúdy, et le passage le plus fort du livre est d’ailleurs cette incroyable anaphore – comme une musique digne d’un Thomas Bernhard qui se serait soudain pris de compassion pour son pays – où Márai aligne sur des dizaines de pages les raisons pour lesquelles Krúdy a écrit, célébrer le bonheur des saisons, la vie provinciale, l’anxiété de gagner sa vie, coucher sur le papier le goût du pain de seigle, déchiffrer le mystère des vies modestes, de cette maison heureuse où il ne reviendrait jamais « autrement que dans son attelage imaginaire de souvenirs et de rêves ». Son génie, écrira-t-il trente ans plus tard dans ses Mémoires de Hongrie où il lui consacre un chapitre entier, lui venait de son « acuité extraordinaire » qui lui permettait d’entretenir avec tout ce qu’il observait, visage ou coin de rue, un rapport étroit d’intimité.
Márai prend des mains de Krúdy, et le passage le plus fort du livre est d’ailleurs cette incroyable anaphore – comme une musique digne d’un Thomas Bernhard qui se serait soudain pris de compassion pour son pays – où Márai aligne sur des dizaines de pages les raisons pour lesquelles Krúdy a écrit, célébrer le bonheur des saisons, la vie provinciale, l’anxiété de gagner sa vie, coucher sur le papier le goût du pain de seigle, déchiffrer le mystère des vies modestes, de cette maison heureuse où il ne reviendrait jamais « autrement que dans son attelage imaginaire de souvenirs et de rêves ». Son génie, écrira-t-il trente ans plus tard dans ses Mémoires de Hongrie où il lui consacre un chapitre entier, lui venait de son « acuité extraordinaire » qui lui permettait d’entretenir avec tout ce qu’il observait, visage ou coin de rue, un rapport étroit d’intimité.
Cet hommage est aussi une façon pour Márai de parler à travers Krúdy de ses propres origines bourgeoises auxquelles il avait juré fidélité, épris qu’il était de démocratie libérale puis de social-démocratie, de curiosité intellectuelle, de tolérance : « Une seule tâche m’attend, écrira-t-il dans le Journal : un travail de qualité. » Il sera néanmoins crucifié sur la place publique comme une nullité par le tout-puissant Georg Lukács, qui avait compris que Márai pouvait tourner en dérision autant la gauche que la droite, comme lorsqu’il constatait que la police secrète des communistes était formée d’anciens agents de la Gestapo. Poussé à l’exil en 1948 par les nouveaux maîtres d’un pays où l’on interdisait non seulement de parler, mais pire de se taire, il les a vus envoyer tous ses livres à l’étranger pour en débarrasser la Hongrie. Il n’existait plus, et contrairement à son idole dès le milieu de sa vie.
Écrit en 1940, le livre a été republié en allemand en 1979, ce qui correspondait à l’âge de Márai dans le siècle, exilé à ce moment-là en Italie mais sur le point de retourner pour de bon aux États-Unis, où dans les années qui suivront il verra mourir sa femme, puis leur fils adoptif, avant de se suicider. Le roman n’est paru en français qu’il y a trois ans.

2. Journal : les années hongroises, 1943-1948
Márai s’est défait de son propre attelage de rêves pendant la guerre. Il n’était plus possible de rêver sous le joug des nazis et des Croix fléchées qui embarquaient les juifs dans des trains par centaines de milliers, avec la complicité de la population. Quelques années seulement après avoir publié son célèbre roman Les braises, il songe à délaisser la fiction pour se consacrer dorénavant à son journal intime et méditer sur son temps, tout en écrivant à la course un court roman largement documentaire, Libération.
Ce n’est pas la motivation qui lui manquait. Ce volume est composé d’extraits des cinq volumes de l’édition hongroise (le journal entier en fait dix-huit). Certains considèrent son Journal comme sa grande œuvre. Il y a vingt ans, J. M. Coetzee voyait en Márai un grand chroniqueur des années quarante mais un romancier « mineur et démodé » – jugement dur et exagéré, formulé sur la foi des quelques œuvres qui étaient alors disponibles en anglais, y compris de mauvaises traductions. Ses romans ne sont pas exempts de défauts, mais rappelons qu’entre 1930 et 1948 Márai a écrit plus de vingt-cinq livres, et que jamais il n’a eu de véritable présence dans le monde anglo-saxon.
Il parle régimes politiques aussi bien que poésie et vie domestique, armé de sa solitude sacrée, prêt à tout perdre déjà en 43, avant même l’invasion allemande. Le gros de ses notes commente la guerre, le plus souvent depuis la maison de campagne où il s’est installé discrètement avec sa femme et sa belle-famille juives. En ville il assiste à des actes terribles de délation. Il voit les Hongrois piller les appartements des juifs, meubles, bibelots, vêtements, tout ce qui a été abandonné.
Il se nourrit goulûment de littérature française, dans le texte, voyant dans notre langue « une des plus grandes merveilles du monde ». Pour lui, la littérature n’est pas un « service essentiel » pour reprendre notre jargon de pandémie, mais un « service divin accessible ». Il exprime son admiration pour Gide (l’essayiste), Jules Renard, Green, Stendhal, Proust, Anatole France, classe Morand parmi les écrivains « moyens », trouve Montaigne bavard tout en le citant utilement, ne donne pas cher d’Aragon, et lit avec passion Goethe, Érasme, Rilke, Virginia Woolf, Dante, et ses contemporains hongrois. Il continue de se droguer de travail et de lecture quand les combats font rage en 1944, avec quelques-uns des cinq mille livres qu’il a gardés de la bibliothèque de son appartement à Budapest, qu’un obus aérien anéantira en grande partie. Quand vient le temps de l’exil vers l’Italie, il emporte avec lui le Voyage en Italie de Goethe, les Chroniques italiennes de Stendhal, L’Odyssée et Marc-Aurèle.
À l’occasion Márai est léger dans son Journal, mais d’une légèreté jamais dénuée de sérieux. En 1946, le Conseil des artistes créé par les nouveaux maîtres du pays décide de récompenser les écrivains :
« J’apprends que la nation a fait cadeau pour cet hiver d’un lapin (non écorché) à chaque écrivain hongrois. Ce don me touche. La nation m’a tout volé, m’a craché dessus et souvent botté le cul. Et voilà qu’à présent elle m’offre un lapin crevé. C’est un début. »
Quelques jours plus tard…
« Je suis allé chercher mon lapin et l’ai rapporté à la maison. C’est le premier résultat tangible d’un quart de siècle de travail d’écrivain. La nation n’est pas tout à fait ingrate. »
« Mon âme et la langue hongroise me tiennent à cœur, écrit-il en 1943 ; quelques livres, quelques contrées, quelques poèmes, en hongrois. Le reste m’importe peu, le reste est sans espoir. » Le mot « patrie » revient encore sans cesse sous sa plume, mais au fil de ces années il a pris un autre sens. Il écrira dans sa préface à Dernier jour à Budapest que les peuples s’installent sur des territoires que « les poètes et les écrivains transforment plus tard en patrie ». En 1945, malgré le regard bienveillant qu’en homme de gauche il porte naïvement sur les Russes au début, il voit bien qu’« il n’est point de patrie sans liberté intellectuelle ». Mais à coups de nazis et de Soviétiques, le mot finit par lui donner la nausée. À son arrivée en Italie, il découvre qu’en terre d’exil « soudain le monde entier devient intime et familier ». Pour le reste de sa vie, il se réfugiera de son propre aveu dans sa seule véritable patrie : la langue hongroise – qu’il appellera même un jour « le sens de ma vie ». C’est pourquoi une fois exilé, il ne l’a jamais abandonnée, contrairement à Milan Kundera par exemple.
3. Les braises
Écrit en 1942, le roman s’intitule Les bougies se consument jusqu’au bout en hongrois. « Braises » en effet n’est pas le mot idéal, parce que c’est un livre très sombre, où la mort occupe plus de place que la vie, et le froid que la chaleur. Deux amis de jeunesse se revoient en huis clos après quarante et un ans pour régler un compte, une trahison commise au milieu d’un triangle amoureux qui a gâché trois vies. Pendant toute une nuit, les deux septuagénaires conversent face à face dans le noir, immobiles, pour mettre les choses au clair. Le livre a beau introduire un élément absent du Dernier jour : le suspense, et Márai cacher dans sa manche quelques cartes, il n’y aura ni véritable rebondissement, parce qu’on a vite tout deviné, ni éclaircissement final. C’est sans doute pourquoi, malgré l’artifice romanesque et le ton souvent trop littéraire de la conversation, le roman laisse une impression profonde.
Tableau psychologique de trois destins, le livre peut sembler lourd par moments, mais il explore à fond aussi bien la fidélité que le désir de tuer. Le constat sur l’amitié y est terrible. Quand l’un assène à l’autre que « dans la société humaine, des intérêts communs créent parfois des relations qui ressemblent à celles de l’amitié » et que « durant un moment, ils ont l’impression que leurs confidences sont une preuve d’amitié. Naturellement, tout cela n’est pas la vérité », un froid glacial s’insinue entre les pages jusqu’à la fin. Le plus frappant est que la relation entre les deux amis est campée de façon très conventionnelle : un riche, un pauvre, l’un authentique militaire, l’autre musicien au caractère méditatif, et que la longue conversation ne s’interrompt jamais, alors que les trois ont eu la vie la plus malheureuse et la plus austère qui soit. Malgré cette fluidité, la tension entre les deux hommes persistera jusqu’à leur séparation à l’aube.
Comme tout Márai, Les braises est empreint de nostalgie. Ici tout se passe dans le château de l’un des deux amis au crépuscule de la monarchie austro-hongroise – période que Márai ne regrette en rien ; il en fait un procès impitoyable dans ses Mémoires, rappelant comment tous ces riches refusaient de payer leurs impôts et versaient des salaires de misère. Toujours craintifs de la littérature, les communistes ont bien sûr fait disparaître cette œuvre avec tout le reste.
4. Libération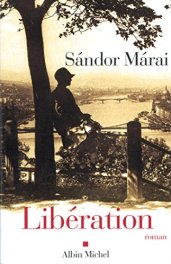
Márai a écrit Libération à chaud, en six semaines, pendant le siège de Budapest, donc tout en rédigeant son journal. D’ailleurs, par bouts, son commentaire sur la guerre qui fait rage dans les rues est si factuel qu’on dirait qu’il a oublié qu’il est en train d’écrire un roman.
C’est encore un huis clos, cette fois la masse grouillante d’une centaine de personnes de toutes conditions – femme riche, petites gens, commerçant, tailleur, pompier – terrées dans une cave pendant vingt-quatre jours. L’endroit est nauséabond, la tension, la peur, la haine s’installent, les uns se retournent contre les autres, on se vole, des disputes éclatent dans le coin où on cuisine, des nouveaux arrivent, l’attente pourrait devenir invivable. Une infirmière de vingt-trois ans, épuisée par la guerre, par son anxiété au sujet de son père, résistant recherché par les nazis hongrois et qui est caché, en fait emmuré dans la cave d’un autre immeuble, protège dans le noir un vieux professeur juif aux jambes paralysées, étendu sur un matelas sale près d’elle.
Des Croix fléchées, ivres de meurtre, pénètrent dans la cave accompagnées d’un délateur. Ils viennent chercher in extremis un juif – denturologue, précise la narration – pour le traîner dans un couloir et le tuer. Puis des soldats allemands en déroute viennent forcer les assiégés à se faufiler vers un immeuble voisin pour s’enfuir. Préférant attendre l’arrivée de l’Armée rouge, l’infirmière refuse de les suivre. Voilà qu’elle se retrouve soudain face à face avec un jeune soldat russe qui vient de s’infiltrer dans la cave, surpris de la voir. D’abord peu méfiante, après tout les assiégeants soviétiques viennent libérer le pays de la terreur nazie, la jeune femme devient de plus en plus nerveuse. Dans le long passage où culmine le roman elle essaie de parler avec le Russe, qui se contente de la regarder, obnubilé, bredouillant quelques mots russes incompréhensibles. Elle se rend bien compte que son attitude n’est pas normale et finit par deviner ce qui se va se passer. Au fil des phrases Márai fait monter la tension, on entend presque vibrer la voix paniquée de l’infirmière, elle se démène, frappe, s’entendra hurler et vomira pendant qu’il la violera. Sortie peu après de la cave, libérée, elle bute dans la rue sur le cadavre du soldat tué peut-être par une balle perdue.
C’est un livre bancal, comme Márai l’avouera lui-même après coup, puisqu’on n’a aucune idée de ce qui est arrivé au père de l’infirmière, dont le sort occupait tout le début du roman et vers lequel elle marche maintenant dans la rue d’un pas mal assuré. Mais le roman a sûrement aidé Márai à traverser les pires mois du siège, quand les gens se ruaient vers les caves à chaque alerte aérienne. On se demande naturellement si ces gens qui couraient se cacher, si les gens en général apprennent quelque chose dans les situations extrêmes d’attente et d’angoisse. Márai ne le croyait sans doute pas, lui qui rappelle quelques fois dans le Journal le fameux mot de Napoléon au sujet des Bourbons : Ils n’ont rien oublié, ni rien appris. Il a voulu créer, sous la figure de l’infirmière, un être exceptionnel.
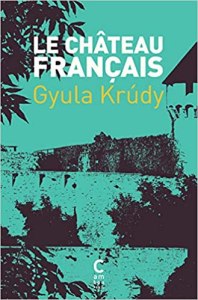
5. Gyula Krúdy, Le Château français
C’est l’un des 90 romans que Krúdy a écrits. On y apprend dès les premières pages pourquoi Sindbad s’appelle le marin. C’est un homme « légèrement grisonnant au visage jeune » qui voyage sur son « voilier imaginaire », d’une jolie ville de province de la Haute-Hongrie à une autre, gîte dans les auberges, s’attarde auprès d’hommes et de femmes qui lui plaisent, connaît « jusqu’aux traces des lapins et des renards dans les champs enneigés ». Il n’a qu’un « grade », explique l’auteur sourire en coin : celui d’écrivain.
Il y a une petite intrigue, mais l’intérêt vient des coups d’œil vifs (« Ils prirent congé en se hâtant, comme des étrangers qui craindraient que l’autre veuille s’accrocher ») et du flot d’images qui roule (« Sindbad regardait la rivière – où les amas de glace se profilaient comme les morts sur un champ de bataille »), comme si la ville entière avec ses rues tortueuses, ses pâtisseries, ses ponts, ses bistrots cachés, ses grands et petits habitants, s’était transportée intacte dans l’imagination de Krúdy. Il nous montre un serveur qui disparaît dans une cave les bras chargés de dames-jeannes, un directeur de théâtre qui a tout sacrifié pour Shakespeare, une vieille dame qui trouve que les hommes ont « toujours été égoïstes, insensibles, cupides », un amoureux qui peut enfin embrasser l’objet de son désir « dans le cou, près des oreilles », une vendeuse dont la tête toute droite donne l’impression qu’elle « venait tout juste d’être déçue par son premier amour et avait décidé de rompre définitivement avec le sexe masculin », un aristocrate sournois qui comme Swann fréquente le Jockey Club, mais à Vienne.
Márai parlait d’intimité à propos de l’œil de Krúdy, on pourrait parler de fusion entre son âme et tout ce qu’il a perçu dans ce monde où il a vécu. Il y a une touche de romantisme, c’est un livre rêveur, avec un bal masqué, de charmantes rencontres, la vie dans les coulisses d’un théâtre, il va sans dire qu’on est à cent mille lieux de Kertész ou de Krasznahorkai, mais l’ironie, voire le sarcasme, n’est jamais loin. Krúdy a beau parfois s’interrompre pour s’adresser au lecteur, évoquer Dickens ou Onéguine, il est impossible de voir un « écrivain pour écrivains » derrière ce récit qui sillonne rapidement entre comédie et sensualité, entre jeux de séduction, scènes de mœurs et duels.
Le revirement à la fin est digne des meilleurs conteurs de la littérature. Par la magie de quelques phrases les portraits de deux personnages sont retournés comme des doigts de gant, quand Sindbad se dessille soudain les yeux devant une femme que Krúdy nous a fait détester tout le long et qu’il voit que « des petites étincelles couraient en tous sens dans les prunelles de la dame, comme si on se pressait avec une lanterne dans la rue enneigée un soir d’hiver ».
Quand Sindbad des années plus tard pense « à ces soirées tièdes de mars, aux vielles maisons violettes, aux lueurs des petites lampes au flanc de la montagne… », les lecteurs de Dernier jour à Budapest auront l’impression d’être en train de lire du Márai, tellement il s’était bien mis dans la peau de Krúdy. C’est à se demander si même en 1942 en situant, un peu étrangement, l’action des Braises dans les dernières années de la monarchie austro-hongroise, Márai n’avait pas voulu à nouveau se rapprocher de son maître.
6. Márai et Kertész
Imre Kertész a beaucoup lu Márai. Citant en 2003 des Pages inédites du Journal, il se met étonnamment à l’accuser de « platitudes » et de « sottises » dans ces « rebuts de son œuvre ». Qu’a-t-il bien pu lire qui lui ait inspiré de tels commentaires, puisque l’édition française d’aujourd’hui comporte parfois de la légèreté, mais de platitudes et de sottises jamais ? Pire encore, il décèle un antisémitisme « abject » dans des remarques de Márai au sujet des « Tziganes levantins » qui auraient nui à la carrière américaine de Béla Bartók (un autre qui s’est exilé, lui pour fuir les fascistes). Pour Kertész, ce sont les Hongrois chrétiens – la « majorité hongroise » dirait-on aujourd’hui – qui ont hué Bartók.
Mais comment adresser de tels reproches à un Márai qui a exposé sans pitié tous les travers de ses compatriotes au point de renoncer à son pays ? Pendant la guerre il a vu toute la société hongroise – « les Juifs, les chrétiens, les amis et les ennemis » – prise dans la même « bouillie brûlante ». Au cœur du siège il a écrit : « Mon Dieu, donne de la force aux Juifs, aide-les à supporter les persécutions, les tortures et les vexations. Donne-leur des forces face à la vie et à la mort. » Le mot « abject » s’agissant de Márai est tellement injuste, et si déconcertant, qu’il faut sans doute l’attribuer à une saute d’humeur de Kertész. Oublie-t-il le courage qu’il a eu quand, dans les années soixante-dix, les Hongrois l’ayant prié de venir visiter le pays et d’y autoriser la publication de ses livres, il avait mis deux conditions : que prenne fin l’occupation soviétique, que soient tenues des élections libres ?
Kertész a d’autres comptes à régler. Vingt ans plus tôt dans le Journal de galère, il niait que le départ de Márai eût été celui « d’un grand esprit de la nation – même si, subjectivement, c’était un grand esprit de la nation –, comme par exemple celui de Thomas Mann : le départ de ce dernier a jeté une ombre sur sa nation tout entière ». Quand il ajoute que « la fuite de Márai n’a pas été son destin », que « son destin n’en a jamais été un », c’est beaucoup d’acharnement sémantique.
Márai voyant l’avenir du pays se profiler a mis des mois à se décider entre partir ou rester, entre dire non ou se taire, vite convaincu qu’on ne le laisserait jamais se taire. Dans les Mémoires de Hongrie, il rappelle avec Goethe que « l’homme doit accomplir son propre destin, pas celui que lui imposent les événements, l’Histoire ou les statistiques, mais son destin à lui, unique et individuel ». En Hongrie, il n’aurait plus été « qu’un numéro sur une liste ». Il est donc parti, dit-il, avec la seule chose qui lui appartenait exclusivement : son « moi ».
Peut-être au fond Kertész lui reproche-t-il, à tort ou à raison, de n’avoir représenté personne, sinon en témoin de la désintégration de sa classe sociale et de tout son pays. Heureusement, il reconnait aussitôt : « Ce ne sont là que des tergiversations qui signifient que la grandeur de Márai est ailleurs : dans son indépendance individuelle plutôt que dans son rôle de grand exilé, bien que, de ce point de vue, son exemple moral brille comme un diamant. » Indépendance individuelle : c’est la grande affaire de Márai. Elle revient sans cesse sous sa plume, notamment lorsqu’il confronte les nombreux écrivains qui ont plié devant la dictature.
Tout ça n’est en effet que tergiversations, car Kertész ne lui a pas ménagé son admiration. Ceux et celles qui ont lu Être sans destin doivent se demander si, en 1944, pendant que Márai écrivait son journal à Budapest, Kertész, alors petit garçon de quatorze ans, avec son étoile jaune cousue sur son manteau, n’est pas par hasard passé dans le champ de vision de l’auteur des Braises. On ressent un vertige à songer que les deux ont peut-être été en présence l’un de l’autre sans le savoir dans cette situation invraisemblable. Sans surprise, cette pensée est venue à Kertész, qui l’élève à une hauteur que lui permettent ses grands moyens :
« Márai arrive en ville par le train de banlieue venant de Leányfalu : “Le train passe à côté de la briqueterie de Budakalász. Sept mille juifs des environs de Budapest y attendent d’être déportés, entre les séchoirs à briques. Des soldats armés de mitraillettes se tiennent sur le talus.” Je ne sais pas pourquoi je ressens rétrospectivement une sorte de joie intense et émue à l’idée d’avoir été vu par Sándor Márai. Il avait quarante-quatre ans, moi, quatorze. Il a vu l’enfant à étoile jaune que j’étais parmi les séchoirs à briques ; et il savait ce que cet enfant ignorait, il savait que cet enfant serait bientôt déporté à Auschwitz. Il a écrit tout cela dans son Journal – que peut faire d’autre un écrivain ? (Et ce Journal est accessoirement l’empreinte intellectuelle la plus pure, la plus exhaustive et la plus importante de l’époque.) Que signifie tout cela ? C’est difficile à déchiffrer, comme une constellation singulière. Pourtant, j’y devine une valeur profonde, indépendante de nous deux, qui se propage lentement, pareille à des ondes radio à peine perceptibles, mais néanmoins existantes et impérissables, qui se propagent dans l’éther malgré le vacarme général. »

♠
Source des citations
Les braises, trad. Marcelle et Georges Régnier, Albin Michel, « Le Livre de Poche », 1995.
Mémoires de Hongrie, trad. Georges Kassai et Zéno Bianu, Albin Michel, 2004.
Libération, trad. Catherine Fay, Albin Michel, 2007.
Dernier jour à Budapest, trad. Catherine Fay, Albin Michel, « Le Livre de Poche », 2017.
Journal : les années hongroises, 1943-1948, trad. Catherine Fay, Albin Michel, 2019.
J. M. Coetzee, « Dupe of History », The New York Review of Books, 20-12-2001.
Gyula Krúdy, Le Château français, trad. François Giraud, Éditions Cambourakis, 2019.
Imre Kertész, Journal de galère, trad. Natalia Zaremba-Huzsvai et Charles Zaremba, Actes Sud, 2010.
L’ultime auberge, trad. Natalia Zaremba-Huzsvai et Charles Zaremba, Actes Sud, 2015.
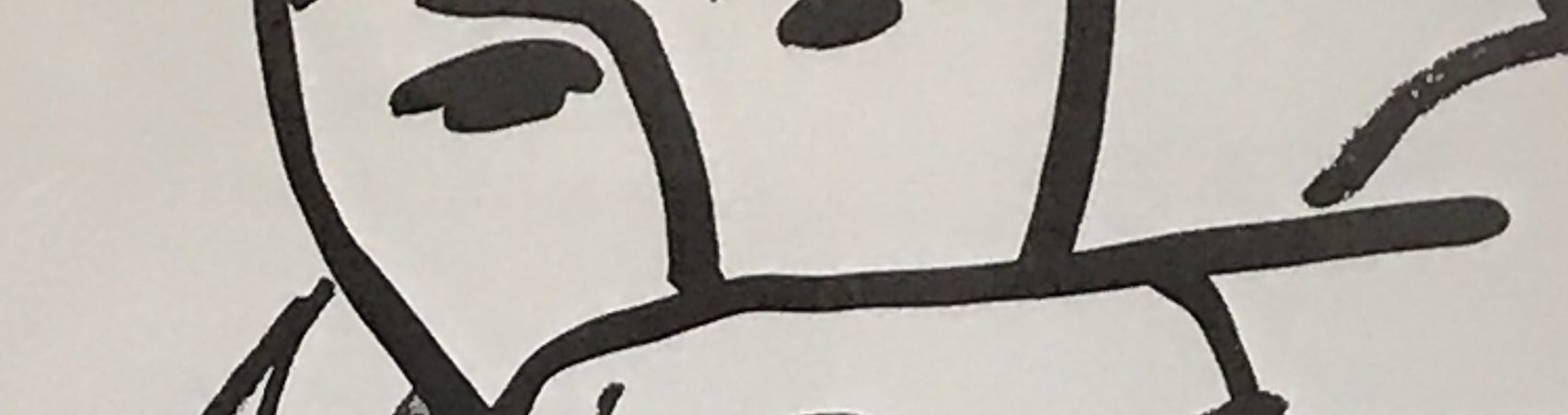
Quel recensement riche, avec des remarques, un fil de lecture qui donnent envie d’aller lire aussi. Captivant.
J’aimeAimé par 1 personne
Merci 😊!
J’aimeJ’aime
« Que peut faire d’autre un écrivain ? » Belle question. J’aimerais lire Dernier jour à Budapest. Voyager avec ce livre et sortir d’ici. Notre patrie est belle (relativement) et on y écrit des ouvrages que j’aime (parfois vraiment beaucoup) ; mais aller voir ailleurs, je ne le fais pas assez souvent. La conception que se fait Márai de la patrie a quelque chose de beau, de vrai. Enfin, le monde est vaste et rempli d’œuvres dignes d’être lues (« dignes » n’est pas le bon mot). Merci.
J’aimeAimé par 1 personne
Superbe comme toujours. Merci Jacques !
J’aimeAimé par 1 personne
Je viens de terminer la lecture De Dernier jour à Budapest. Merci d’en avoir parlé. C’est effectivement une découverte exceptionnelle. Pour lecteur averti!
J’aimeJ’aime
Très intéressante chronique, qui me donne envie de découvrir Dernier jour à Budapest.
J’aimeAimé par 1 personne
Merci An. Oui, je crois que vous aimeriez Dernier jour à Budapest. En fait, c’est un régal.
J’aimeJ’aime