Fin de combat est le sixième et dernier tome du long roman de Knausgaard, Mon combat. Les quatre mille cinq cents pages (en français) de l’œuvre ont été écrites à un train d’enfer, de l’hiver 2008 à l’automne 2011. Quarante ans de la vie de l’auteur y passent dans le désordre. Malgré l’étiquette d’écriture automatique que lui a parfois valu un récit peu soucieux de style, bien qu’écrit correctement, où la routine du quotidien alterne avec les vagues d’émotions et les réflexions sur l’art et la littérature, l’œuvre est finement structurée. Finesse qui atteint un sommet dans Un homme amoureux, habile emboitement de flashbacks, jusqu’à cinq ou six niveaux, ponctués d’autres brefs retours en arrière, mais d’où l’on revient chaque fois au moment précis où le récit avait été interrompu. Cette construction en boucles peut dérouter à la lecture, comme lorsque Knausgaard sert le champagne à ses amis lors d’un réveillon chez lui, et le plat principal deux cents pages plus loin.
Dans La mort d’un père (tome 1), après quelques pages sur son enfance et un retour sur son adolescence dans les années 80, Knausgaard décrivait la déchéance de son père, homme sévère et si exécrable qu’il en faisait pitié, et sa mort tragique en 1998. La partie la plus forte du livre réunissait le trio tendu des deux fils et de leur grand-mère alcoolique, en train de devenir sénile dans sa maison, où flottait une odeur d’excréments au-dessus de bouteilles vides éparpillées partout. Le compte rendu minutieux du nettoyage de la maison, qui récrée l’atmosphère par moments poignante qui y règne, est devenu pour beaucoup le symbole par excellence du style de Knausgaard.
En 2002, à la mi-trentaine, il divorce et quitte la ville norvégienne de Bergen, où il vivait depuis quatorze ans, pour s’installer en Suède. Là il tombe amoureux fou de l’écrivaine Linda Boström. Voilà l’histoire d’Un homme amoureux (tome 2) : coup de foudre, deuxième mariage, puis sa vie intense de père se débattant comme un forcené pour écrire, avec leurs trois bambins et les corvées domestiques. De la mort on est passé au romantisme amoureux, bientôt suivi par les disputes conjugales et le désenchantement de la vie quotidienne. Mais l’infatigable essayiste qu’est Knausgaard ne lâche pas le morceau : la mort reste l’objet de ses réflexions pendant qu’il promène ses enfants en poussette dans les rues, tout en lisant Hölderlin et Dostoïevski.
Jeune homme (tome 3) expose la tyrannie que son père exerçait sur lui jusqu’à ses treize ans. En montrant l’alternance de joies et de terreurs typique de l’enfance, le récit met en vie un jeune garçon comme peu d’écrivains l’ont fait. Tout est rappelé cette fois de façon linéaire – les jeux, l’école, les vacances, les copains, les bandes dessinées, l’intimidation, les flirts, les revues porno, le foot, la musique – mais sur le fond sombre du traitement que lui réservait son père à la maison. Ce volume est peut-être le meilleur de la série, parce qu’un homme de quarante ans y examine l’enfant qu’il a été ; on ne peut que penser au célèbre vers de Wordsworth, « l’enfant est le père de l’adulte ».
Dans Aux confins du monde (tome 4), un Knausgaard fraîchement diplômé du collège, 18 ans, part enseigner dans un village de pêcheurs du cercle arctique, avec l’objectif de s’isoler pour écrire. Encore puceau après tous ses fiascos, il n’avait pas prévu que ses élèves, à peine plus jeunes que lui, allaient être d’une beauté à l’angoisser. Mais la même histoire se répète toujours : quand une fille du coin répond à ses avances, une caresse ou son sein dénudé déclenche à tout coup la honteuse éjaculation précoce. Au centre du roman, un long flashback revient sur ses dernières années du secondaire, le divorce de ses parents, les beuveries et les amours adolescentes. À la fin de son affectation, il ira enfin perdre sa virginité selon les règles de l’art sous une tente au cours d’un festival rock au Danemark.
Comme il pleut sur la ville (tome 5), huit cents pages écrites en huit semaines (« parce que je m’en foutais vraiment »), le retrouve l’année suivante à Bergen, le plus jeune participant à une Académie d’écriture. Humilié par les commentaires dévastateurs de la classe sur ses textes, il sèche les rencontres et sombre dans la boisson. Suivent les années 90 jusqu’à 2002. Un Karl Ove un peu plus sage, parfois fort antipathique, mène sa vie d’étudiant en littérature et en histoire de l’art, travaille l’été dans des hôpitaux psychiatriques, puis à temps plein dans un poste de radio. Il joue de la batterie dans des groupes, fait de la critique littéraire, a une petite amie et des aventures d’un soir, et boit comme un trou, habité par la rage d’écrire mais convaincu d’être nul. Il finit par se marier et mener à bien son premier roman en 1998, l’année où meurt son père, ce qui nous ramène en boucle au tome 1. Puis il gâche son mariage par infidélité.





*
Et on arrive à Fin de combat, où il narre en 2011 les événements survenus dans sa vie en 2009, secoué par les réactions violentes à La mort d’un père, sur le point de paraître en Norvège, dont celle de son oncle furieux qui menace de le poursuivre pour en empêcher la publication, secoué aussi par les conséquences que la parution d’Un homme amoureux entraîne ensuite pour la santé mentale de sa femme. Devenu une célébrité en l’espace de deux ans, Knausgaard se cache maintenant de tous pour mettre la dernière main à ce qu’on est en train de lire. L’ouvrage est massif et singulier : deux blocs de récit, de cinq cents (les aléas de la publication du tome 1) et quatre cents pages (les tomes suivants et la dépression de sa femme), encadrent un essai torrentiel de cinq cents pages, « Le nom et le nombre », dont le noyau est une analyse serrée de Mein Kampf (Mon combat) de Hitler.

Ce tome a donc la particularité d’être largement consacré aux conséquences de la publication des tomes précédents pour ses proches. Knausgaard a été déchiré toute sa vie par un sentiment de culpabilité, mais jamais il n’a été plus torturé que lorsqu’il se rend compte des gifles qu’il a assénées aux membres de sa famille en déballant le linge sale sur la place publique : « Ce roman a fait du mal à tous ceux qui me sont proches, il m’a fait du mal à moi et, dans quelques années, quand ils seront assez grands pour le lire, il fera du mal à mes enfants. » Quiconque déciderait de tout dévoiler comme il l’a fait, sans complaisance, finirait par trahir autant de gens et créer autant de malaise. Si bien qu’à la dernière ligne de Fin de combat, terminant l’œuvre un matin de septembre, peu avant que sa femme sorte de l’hôpital et rentre à la maison, il annonce qu’il n’écrira plus. Il avait rêvé jour et nuit d’être un écrivain, « une lumière pour les autres », puis constaté à l’Académie d’écriture qu’il n’en était pas un, et voici qu’après l’être devenu il annonce au bout de huit livres (en comptant les deux romans écrits avant Mon combat) que c’est fini. Rien n’autorise à douter de sa bonne foi, même si heureusement sa décision a fait long feu puisque suivront une tétralogie sur les saisons, de nombreux essais et un autre roman en 2020 pendant la pandémie.
*
Si, contrairement à Jean-Jacques dans ses Confessions, Karl Ove ne se dépeint pas en victime, la honte reste la grande affaire de sa vie. Son père ne ratait jamais une occasion : « À la maison, il n’y avait que papa. Occupé dans la buanderie quand j’arrivai, il se tourna vers moi, de la colère plein les gestes. – J’ai cueilli des fleurs pour toi, annonçai-je. – Ce sont les petites filles qui cueillent des fleurs, répliqua-t-il. » L’écolier se fait humilier par ses camarades de classe, l’adolescent par les filles. Jusque dans la vingtaine une anicroche avec ses amis peut lui faire monter les larmes aux yeux.
On finit par tout savoir sur ses rages, ses défaites et ses impatiences, ses pensées secrètes (« Mon père est mort et je pense à l’argent que ça va me rapporter. Et alors ? Je pense ce que je pense, je n’y peux rien, n’est-ce pas ? ») et ses faiblesses de caractère (« Avais-je, ne serait-ce qu’une fois, engagé la conversation avec une personne inconnue ? Non, jamais. Et rien n’indiquait que je le ferais un jour »), sans oublier les coups bas (lui et son copain volant dans une épicerie tenue par deux gentilles vieilles dames). Quand la femme dont il est amoureux, une dénommée Linda, le repousse, il se taillade le visage avec un morceau de verre, et la première fois qu’ils s’embrassent il tombe sans connaissance (des secours sont appelés).
Knausgaard ne protège jamais ses arrières, son récit est fondé sur un pacte de sincérité. Il n’est pas un saint martyr pour autant, dans les pires situations il y a toujours quelqu’un de prêt à l’aider. Sans compter les victoires. Parlant de sa mère :
« Si elle n’avait pas été là, j’aurais grandi uniquement avec papa, et alors là, d’une façon ou d’une autre, à un moment ou à un autre, j’aurais mis fin à mes jours. Mais sa présence contrebalançait la noirceur de papa. Aujourd’hui je suis en vie, et le fait que ce soit sans joie n’a rien à voir avec l’équilibre de mon enfance. Je vis, j’ai moi-même des enfants et la seule chose que j’ai vraiment essayé de réussir avec eux, c’est qu’ils n’aient pas peur de leur père.
J’ai réussi. Je le sais. » (Jeune homme)
Mais l’œuvre est loin de se résumer à un exorcisme pour régler des problèmes personnels. En fait, Knausgaard s’est davantage servi de ses problèmes pour faire une œuvre littéraire que l’inverse.
*
Comme les vannes sont grandes ouvertes et qu’il ne retouche pas, il lui arrive de laisser en suspens ce qu’il raconte et de passer à autre chose, si bien que par endroits le récit est décousu. Mais bien plus souvent il étire et s’attarde, sans filtrer le superflu. Il va raconter sur soixante-dix pages le périple de deux ados partis acheter de la bière en cachette. S’adressant à sa mère la veille du jour de l’An, vingt-cinq ans après les faits :
« – Est-ce que tu pourrais repasser ma chemise en même temps ?
Elle acquiesça.
– Tu n’as qu’à la mettre sur la table à repasser. »
C’est ainsi qu’il mentionne sa marque préférée de déodorant, décrit le signe de la main qu’il fait au serveur pour commander ou la position de sa mère au volant quand elle recule dans l’entrée. Les changements de couches font partie de sa vie ? Les changements de couches entrent dans le roman. Ses enfants – la description de leur caractère, de leurs journées, leurs chicanes et leurs demandes, racontées sans mièvrerie ni sentimentalisme – occupent d’ailleurs une place énorme dans l’œuvre, sans qu’il ne leur arrive jamais rien de spécial. En pleine dispute, il peut nous renseigner sur l’état de cuisson des saucisses ou réciter le NIP de sa carte bancaire qu’il cherche à se rappeler. L’essentiel et l’inessentiel se bousculent constamment. Faits sans importance, mais non pour autant dépourvus d’intérêt :
Les voitures passaient suivies d’une traîne virevoltante de neige. Un énorme camion descendait la rue dans le cliquetis de ses chaînes, il freinait par à-coups et parvint à s’arrêter devant le passage piéton juste au moment où le feu passa au rouge. J’avais toujours une pointe de mauvaise conscience chaque fois qu’un véhicule s’arrêtait à cause de moi, une sorte de déséquilibre s’installait et j’avais le sentiment de leur devoir quelque chose. Plus le véhicule était grand, plus mon obligation envers eux l’était aussi, et c’est pour cette raison qu’en traversant j’essayai d’apercevoir le chauffeur de façon à pouvoir lui adresser un signe de tête et redresser ainsi l’équilibre. Or son regard suivait sa main levée pour attraper quelque chose dans l’habitacle, peut-être une carte car le camion était polonais, donc il ne me vit pas et c’était aussi bien, le freinage n’avait pas dû le gêner notablement. (La mort d’un père)
Ce minuscule événement n’aura aucune espèce d’incidence sur le récit. Autrement dit, Knausgaard signalera le fusil accroché au mur même s’il ne servira jamais à rien. Dans un cours, on vous dirait d’enlever tout ça, d’élaguer. Mais cette règle ne l’intéresse pas, parce qu’il ne s’agit pas là d’intermèdes. Au contraire, les banalités font corps avec le récit et c’est leur accumulation qui nous rend accro au roman et fait qu’on boit ses milliers de pages comme du petit-lait. Le foisonnement de coups d’œil francs jetés sur la réalité de tous les jours, cette curiosité pour tout ce qui l’entoure – de l’humeur de ses proches à l’allure des gens qu’il croise, en passant par le brouhaha de la rue ou la texture du ciel – est la manifestation d’une « présence au monde » hors du commun dans tout le roman.
Il poursuivra le même inventaire dans ses essais sur les saisons, où le ton est toutefois d’une extrême douceur par comparaison avec le roman. Autumn observe le monde sous mille facettes : les pommes, la gomme à mâcher, le sang, les guêpes, le pétrole, les boîtes de conserve, les lèvres vaginales, les boutons, la douleur, etc. Et il continue quelques mois plus tard dans les pages de Summer où il tient le journal des heures qu’il passe avec sa nouvelle-née.
*
Ces banalités qui pullulent dans le livre possèdent plusieurs vertus. D’abord, elles viennent avec l’élan qui entraîne tout le reste, et sans elles le récit risquerait de retomber dans le tri sévère que fait habituellement la fiction. Elles servent de repoussoirs aux scènes chargées d’émotion qui, surgissant dans la vie de tous les jours au fil d’un enchaînement de faits banals, ont un réalisme saisissant. Or la présence des émotions dans un roman est une règle sacrée pour Knausgaard ; c’est la raison pour laquelle il admire tant Hamsun et si peu Kundera. Elles servent aussi à faire remonter le passé lointain, puisque tous les éléments d’une vie sont imbriqués les uns dans les autres, c’est donc une façon de garder la machine bien huilée ; « The recall comes in the writing » a expliqué Knausgaard en entrevue.
Si un bon nombre de lecteurs s’impatientent du superflu dans Mon combat, c’est qu’ils sont mécontents de ne pas entendre le récit auquel ils s’attendaient. Mais aux yeux de Knausgaard la tâche première en littérature est justement de ne pas répondre aux attentes. Il a exprimé son ras-le-bol face à la fiction dans Un homme amoureux, dans ce qui est peut-être le passage le plus important de ces milliers de pages :
« J’avais la nausée rien qu’à l’idée de fiction, à l’idée d’inventer une histoire et des personnages à mettre dedans. J’y réagissais physiquement. … Peut-être était-ce parce que nous étions submergés de fictions et d’histoires. Qu’il y avait inflation. Où qu’on se tournât, on voyait de la fiction. Ces millions de livres de poche, de livres reliés, de DVD et de séries télévisées, partout il était question de personnages inventés dans un monde inventé mais conforme à la réalité. Et les informations dans la presse, à la télévision et à la radio avaient exactement la même forme, les documentaires avaient aussi la même forme, c’était aussi des histoires et ça ne faisait aucune différence si ce qu’ils racontaient s’était vraiment produit ou pas. Je traversais une crise que je ressentais dans tout le corps, comme une sorte de saturation qui se répandait dans ma conscience comme du saindoux, surtout parce que au cœur de toute cette fiction, vraie ou non, il y avait la similitude et que la distance avec la réalité était constante. Donc la fiction voyait la même chose. Cette même chose, c’est-à-dire notre monde était produite en série … Je ne pouvais pas écrire de cette façon, ce n’était pas possible, à chaque phrase je me disais : tu ne fais qu’inventer. Ça n’a aucune valeur. »
Il renchérit dans Fin de combat : quand « tout est fiction ou que tout se résume à être vu comme étant en soi une fiction, la tâche du romancier ne consiste plus à écrire d’autres fictions ». Comme il pleut sur la ville nous a rendus témoins de ses laborieux efforts tout au long de ses vingt ans pour écrire des romans traditionnels (il en écrira deux) et qui l’ont conduit plus tard à cesser d’inventer. Tel est donc son cheminement : – par sa forme le roman traditionnel crée une distance par rapport à la vie ; – pour abolir cette distance il fait éclater la forme et écrit sur lui-même sans retenue ; – mille détails sont amenés par le flot de la narration, indépendamment d’une intrigue ou d’une autre convention, voire d’un thème (« Je ne voulais pas écrire sur la relation d’un père et d’un fils, je voulais écrire sur papa et moi », affirme-t-il dans sa conférence de Yale en 2018). Selon ses mots dans La mort d’un père, son but était de « combattre la fiction par la fiction ». Il a donc pris le parti de tout raconter, non parce qu’il trouvait sa vie intéressante, mais parce que c’était le meilleur moyen d’atteindre au plus près le réel en se libérant des artifices traditionnels de la fiction. Dans ce mouvement sa propre personne est devenue, comme il l’a dit, « un endroit où passaient des émotions, des pensées, des images ». Tout Knausgaard est là.
*
Il a quand même inventé un peu. Il explique dans Fin de combat qu’après la parution des tomes 1 et 2, il a dû changer des noms dans les tomes suivants et apporter d’autres modifications sous la pression de son éditrice, des avocats et des réactions du public.
Et même s’il est doté d’une mémoire exceptionnelle, il lui a bien fallu colmater des brèches, ne serait-ce que pour continuer sans inventer, comme lorsqu’il raconte dans le détail de lointaines journées de sa jeunesse ou rapporte sur soixante pages le verbatim d’une conversation menée trois ans plus tôt ; visiblement il a recréé un dialogue « vraisemblable ». On sait par ailleurs que la frontière entre mémoire et imagination est ténue (peut-on raconter sans inventer ? voir à la fin de cet article l’entrevue conjointe avec Maggie Nelson).
La bonne vieille littérature réapparaît aussi toutes les fois où il rappelle le temps qu’il faisait, ici à quinze ans de distance :
« À la fenêtre, l’obscurité était pâle entre les arbres noirs. Il ne pleuvait plus mais le bruit du vent continuait à onduler à travers la forêt comme une sorte de houle. » (Comme il pleut sur la ville)
D’autres recettes reviennent par la bande, mais criantes car peu nombreuses parce que s’il inventait trop il n’y aurait plus de combat et l’œuvre s’écroulerait. Il y a les inévitables éléments de suspense (que va-t-il arriver à Linda ?). On l’a accusé d’avoir mis dans la bouche de certaines personnes des paroles qu’elles n’ont jamais prononcées. Mais il n’y a aucune raison là non plus de douter que, dans son intime conviction, il a dit la vérité et maintenu l’exigence de vérité pour tout ce qu’il écrivait sur lui-même.
La réflexion générale sur la mort qui lui sert de bloc de départ dans La mort d’un père, et qu’il a fignolée, ressemble, toute pénétrante qu’elle est, aux incipits des romans classiques et détonne sur le reste. Il risquait en s’élançant ainsi de se prendre dans les rets du roman traditionnel, mais refusant de revenir en arrière il a préféré rectifier le tir quelques pages plus loin :
« Aujourd’hui, nous sommes le 27 février 2008 et il est 23 h 43. C’est moi, Karl Ove Knausgaard, né en décembre 1968 et donc dans ma trente-neuvième année, qui écris. J’ai trois enfants, Vanja, Heidi et John, et j’ai épousé Linda Boström Knausgaard, en secondes noces. Ils dorment tous dans leurs chambres autour de moi, dans un appartement de Malmö où nous vivons depuis un an et demi… »
Si la littérature traditionnelle affleure ici et là, elle le fait loin du champ de bataille principal.
*
Parenthèse sur Proust. On a beaucoup fait le parallèle Proust-Knausgaard, en termes élogieux dans les pays anglophones, parfois pour rétrograder le Norvégien en francophonie où certains ont trouvé le livre mal écrit et bourré de clichés.
Il va sans dire que la facture stylistique de Mon combat est à mille lieues du peaufinage extraordinaire de la phrase chez Proust. Pas de paperolles chez Knausgaard, seulement la vérité brute de décoffrage. Contrairement à Proust, il a rejeté le principe de la beauté de l’œuvre littéraire, ou tenté de le faire parce que beaucoup de passages restent d’une grande beauté. Son idée n’est pas pour autant gratuite :
« En tant que procédé emblématique du style en littérature, en tant que filtre à travers lequel le monde est vu, la beauté donne de l’espoir à ce qui est sans espoir, de la valeur à ce qui est sans valeur, du sens à ce qui n’en a pas. C’est inévitable. La solitude décrite dans un beau style élève l’âme vers d’incroyables hauteurs. Alors la vérité disparaît, car la solitude n’est pas belle, pas plus que le désespoir, ou le manque. » (Fin de combat)

Il est certain que Karl Ove n’écrit pas avec la distance de Marcel observant son entourage, il y a toujours chez lui le moins de distance possible : c’est son credo. Et il est vrai que très peu de passages du roman pourraient être qualifiés de proustiens : il y a la paréidolie du visage aperçu dans la mer à la télévision à l’âge de huit ans (évoquée deux fois dans La mort d’un père, voir l’extrait cité à la fin) ; la description de la mort de la grand-mère ; le bel excipit de Jeune homme quand il quitte à treize ans le pays de son enfance ; quelques autres passages. C’est à peu près tout.
Mais la Recherche n’est pas qu’un assemblage de phrases. Le legs qu’a reçu Knausgaard de Proust crève les yeux dès qu’on regarde l’œuvre dans son ensemble : l’immense entreprise qui fait de la littérature une quête ultime, le projet de témoigner de tout ce qui a été vécu, les images et les digressions qui déverrouillent des portes insoupçonnées, l’action qui n’oublie jamais la réflexion, la nostalgie qui imprègne l’œuvre, tout cela aidé en partie, comme on l’a compris, par la mémoire involontaire.
Quand Jean-Yves Tadié souligne qu’avec Proust « en quelques phrases, à une vitesse prodigieuse, on passait de l’événement le plus simple, un pied qui trébuche [sur les pavés de l’hôtel de Guermantes], au sens de la vie, du monde, du temps, de l’œuvre d’art », on croirait qu’il parle de Knausgaard. À la différence que chez ce dernier le plus souvent l’incident, au lieu de déclencher une illumination, s’ajoutera simplement à la succession des moments banals qui se multiplient au fil des jours.
*
L’essai sur « Le nom et le nombre » enserré au centre de Fin de combat est éblouissant. Plusieurs y ont vu une sorte de hapax sorti de nulle part. Mais c’est un hapax qui avait des précédents. Il avait été question de l’extermination des juifs dans les tomes 3, 4 et 5. Karl Ove avait vu dans une sortie scolaire à la bibliothèque municipale les images de corps nus dans des camps d’extermination nazis. Plus tard il découvrira des traces du nazisme dans les affaires de sa famille. Et il y a son compatriote Hamsun qui l’accompagne depuis toujours.
Depuis la première ligne, le récit est jalonné de méditations qui partent dans toutes les directions, dans chacun des tomes Knausgaard a nourri sa réflexion en convoquant les plus grandes œuvres, en peinture comme en littérature. Non seulement il continue de le faire dans l’essai (magnifiques pages sur Turner et le Lorrain), mais au même rythme infernal que dans tout le reste. Même quand il expose ses idées, on lui entend le cœur qui bat, il dévore des ouvrages, attrape des données à la télévision, les note sans faire aucune espèce de vérification, et continue. Cette fidélité stylistique signe l’appartenance de l’essai au roman. Peut-être n’y a-t-il plus de personnages – mais il n’y en a jamais eu ! (« Linda n’est pas un personnage. Elle est Linda. Geir Angell [son meilleur ami] n’est pas un personnage. Il est Geir Angell. Vanja, Heidi et John existent, à cet instant précis, ils sont en train de dormir à quelques centaines de kilomètres de là où je suis. Ils sont réels. ») La vraie différence est qu’il met pour la première fois sa vie personnelle de côté sur des centaines de pages pour se tourner vers l’Histoire.
Malgré les pressions, Knausgaard a évidemment refusé de changer le nom de son père dans le roman, sinon son entreprise n’avait plus aucun sens : « tant de choses s’étaient accumulées dans le nom de mon père », et il serait le fils de qui, lui qui veut raconter sa vie ? Il a donc choisi de l’appeler « papa » comme on l’a vu, sauf dans les dernières pages de Fin de combat où il révèle son nom.
L’essai ouvre sur cette question. Il examine le traitement du nom chez Ingeborg Bachmann, Thomas Mann, Joyce, Kafka, dans Le bruit et la fureur et dans les Élégies de Duino. L’enjeu est sérieux : le nom – cette chose impossible à copier comme un visage, qui empêche d’émousser la sensation de la réalité crue, qui continue de vivre dans la société après notre mort.
Knausgaard se lance ensuite dans une dissertation débridée sur le poème Strette de Paul Celan (p. 511 à 583 !). La force de ce poème est qu’il cherche à s’approcher « de ce qui n’est pas sans le transformer en ce qui est ». Strette plonge dans l’Holocauste mais ne le mentionne jamais, exposant le silence du monde dans une terrible vision qui voit par exemple une roue rouler librement à travers un champ sans l’ombre d’une présence humaine. Suivent – c’est le nerf de l’essai – une longue réflexion sur le nazisme et un portrait de l’adolescent Hitler en artiste raté et humilié par l’école des beaux-arts ; on comprend l’intérêt de Knausgaard : il projette sa propre jeunesse sur celle de Hitler. Qu’est-ce qui peut bien distinguer Adolf Hitler, demande-t-il, de tous les adolescents perdus de son époque ? Hitler se privait de repas pour aller écouter Wagner ? Toute cette génération, pauvre ou aisée, était en quête d’absolu, Rilke de dix ans son aîné accueillera la guerre comme un dieu quelques années plus tard. Mais le grand spécialiste du nazisme Ian Kershaw a réglé le cas de Hitler depuis longtemps : il était dès le berceau l’être monstrueux qu’on a connu :
« Kershaw, et deux générations avec lui, maudit Hitler et tout ce qu’il incarne, à croire que montrer son innocence lorsqu’il avait dix-neuf ou vingt-trois ans, ou montrer certaines des qualités qu’il conservera toute sa vie, équivaudrait à les défendre, lui et le mal qu’il représente. Alors que, en fait, c’est justement l’inverse : seule son innocence donne du poids à sa culpabilité. »
Knausgaard met bien en relief la bassesse de Hitler, mais soutient qu’en le classant détraqué à la naissance on se lave les mains de tout blâme. À ses yeux, Hitler était quelqu’un comme vous et moi, et sa folie meurtrière est un mal à l’intérieur de nous. Il existe très peu de sources sur le jeune Hitler, mais Knausgaard accumule aussi des doutes factuels sur le jugement de Kershaw, en analysant ligne par ligne les mémoires du rare ami de Hitler dans sa jeunesse, August Kubizek. Il ne propose pas une théorie de remplacement pour expliquer les crimes du futur dictateur. Son essai n’est pas une thèse qui veut aboutir à de fermes conclusions, il expose le point de vue singulier d’un écrivain, et peut-être céderait-il sous l’assaut des spécialistes, mais il montre à quel point ces questions n’ont rien de tranché.
L’objet de sa quête reste la singularité de l’individu, que le nazisme a anéantie. Dans Mein Kampf, livre au style inexistant, Hitler ne s’adresse jamais à un interlocuteur. Il n’y a pas de tu, ni de vous chez lui. Il ne discute avec personne. Knausgaard, qui a travaillé à une traduction de l’Ancien Testament, recule avec René Girard jusqu’à l’histoire de Caïn et Abel pour montrer que l’abandon du tu est source de violence. Dans la LTI, la langue du IIIe Reich, ne survivent que deux entités : nous et eux. La société nazie assoie son ampleur sur le je terrifiant du chef et ce nous, de sorte qu’il n’existe plus une telle chose qu’un autre être humain.
Cet essai magistral est guidé par le principe qui régit tout le roman : rester collé au singulier, au concret, ne pas s’éloigner des vies particulières, la seule chose qui existe, éviter que le nom disparaisse dans le nombre. Au lieu de passer un lourd message tout imbu de son importance, Knausgaard poursuit dans ces pages-là son travail d’écrivain, pour qui le plus important est de préserver la complexité du réel.
*
Parenthèse sur Handke. Knausgaard s’arrête un moment dans Fin de combat pour essayer de comprendre ce qu’il a fait en écrivant ce livre, et relit Le malheur indifférent où l’Autrichien racontait le suicide de sa mère, femme ordinaire qui ne s’intéressait pas du tout à la politique et avait vécu le plus naturellement du monde dans le national-socialisme. Sa vie avait été dépersonnalisée à fond. Quand elle est revenue après la guerre dans son village de Carinthie, plus personne n’avait de destinée personnelle, il n’y avait plus d’individus. « Le mot "individu" n’était d’ailleurs connu que comme insulte », écrit Handke, qui montre comment une âme peut être étouffée quand un individu vit dans la soumission à la société.

Knausgaard, qui carbure aux émotions quand il parle de son père, admire Handke d’avoir pu raconter la vie de sa mère avec une écriture neutre, sèche, détachée, comme de l’extérieur de lui-même (ce regret honteux de ne pas avoir été à la hauteur d’un écrivain qu’il admire, c’est du Karl Ove tout craché…). « Quand j’avais commencé à écrire, avoue Knausgaard, c’était une langue semblable que je visais, sinon sèche, du moins crue, brute, c’est-à-dire directe, sans métaphores ni ornements littéraires. »
Handke disait éviter la « mise en formules », les « phrases poétiques », « (À partir de maintenant, écrivait-il dans une parenthèse, je dois veiller à ce que l’histoire ne se raconte pas trop d’elle-même) », tout en admettant qu’il faisait « un travail littéraire ». Or Knausgaard appréhendait le même danger depuis l’hiver 2008 : en racontant sa vie, glisser sans s’en rendre compte dans la littérature toute faite, dans un rituel dirait Handke, si confortable pour les lecteurs pourrait-on ajouter.
Il reste une nette opposition entre les deux : si Knausgaard envisage que son père a peut-être commis un lent suicide, il ne le considère que dans son rapport à lui-même. Pas une ligne dans l’œuvre sur ses deux divorces : cet homme est son père, point. Tandis que Handke recule jusqu’à ses arrière-grands-parents pour comprendre cette femme qui a vécu dans une Slovénie pauvre et oublié ses rêves intimes, pour ensuite s’effacer dans la collectivité.
*
« Le nom et le nombre » est la preuve qu’on peut faire à peu près tout ce qu’on veut dans un roman, on peut même s’en écarter sans en sortir. Il y a en fait des essais tout le long de Mon combat, mais chaque fois Knausgaard revient à son récit. Il dira que la fiction reste plus ouverte, plus complexe et plus puissante que l’essai.
Mais quelle sorte de fiction ? Toutes les étiquettes ont été testées sur Mon combat : roman autobiographique, familial, vécu ? Mais il n’y a pas de fabulation, aucun personnage n’est créé, le destin du héros suit la vie de l’auteur à la trace, son je n’est pas enrobé d’atours littéraires. Simple autobiographie alors ? Mais les nombreux essais n’ont rien à voir, le récit n’est qu’en partie rétrospectif, ne compose pas le tableau d’une vie, ne cherche pas à donner un portrait avantageux de l’auteur ni même à séduire le lecteur, accorde une place majeure à des futilités qui n’ont en rien déterminé sa vie. Méta-roman peut-être ? Des Scandinaves l’ont décrit comme une « biographie performative » ou une « fiction sans fiction ». Toutes les catégories semblent en déséquilibre, il y a toujours des passages qui ne cadrent pas. On dirait bien que Knausgaard a changé les règles du jeu.
Parce qu’il ne s’agit pas non plus d’une autofiction, avec l’auteur caché derrière un narrateur, mêlant savamment le vrai et le faux, travaillant la langue, cultivant une esthétique, cherchant l’effet. Knausgaard n’est pas sur ce terrain-là. Il a fait prévaloir la contrainte de la réalité au détriment des conventions du genre, même s’il ne s’y est pas parfaitement tenu. Avec lui, on a l’impression que l’auteur est sorti des coulisses (ou de sa tombe ?), a renvoyé le narrateur et pris les choses en main, réduisant les inventions au minimum, sans pour autant priver le récit d’un cachet littéraire qui lui vient sans doute du flux d’une narration que rien n’arrête et qui ne se préoccupe pas de tout mettre au net. Une autofiction est comme une balance avec du réel et du fictif discrètement répartis entre les deux plateaux. Si certains y recourent par pudeur, d’autres estiment peut-être qu’en complétant la relation des faits par la fiction, ils exprimeront mieux ce qu’ils ont à dire. Mais il n’y a rien de cela dans le roman de Knausgaard, il a vécu tout ce qu’il raconte, mis ses émotions sur la table, et les éléments « fictifs » y sont largement utilitaires, imposés soit par des facteurs externes, soit par des défauts de mémoire.
Knausgaard ne s’est pas observé de loin avec des lunettes d’approche à la manière des autobiographes et n’a pas brouillé la frontière entre le réel et le fictif comme dans les autofictions. Du même coup, il a rompu avec l’ironie des postmodernes, leur confortable recul (leur « posture »), et choisi d’être franc et honnête, s’affichant parfois en parfait innocent. Peut-être a-t-il mis fin à l’ambiguïté douteuse des autofictions et inauguré une nouvelle ère, celle de la post-autofiction (si on peut lui donner un nom barbare) ? Chose certaine, il a augmenté le potentiel du roman, et il n’est pas étonnant que l’œuvre ait suscité tant d’admiration, comme chez Zadie Smith qui avait été fascinée dès les premiers tomes par sa façon de faire coïncider la vie et l’écriture, et Rachel Cusk qui y a vu un événement majeur dans la littérature mondiale, parce que, disait-elle, il montre en empruntant le chemin de la vie qu’il n’y a pas d’« histoire » et c’est par là qu’il atteint à l’authenticité.






*
Florilège
Mon combat renferme des portraits, des affrontements, des récits de transport amoureux, des analyses littéraires, des évocations de paysages, des observations de toutes sortes. En voici un échantillon qui donne une idée de la manière de Knausgaard et des élans de sa pensée. Ces extraits sont tirés des admirables traductions, vives et souples, de Marie-Pierre Fiquet chez Denoël.
L’amour au temps de l’enfance :
« Le frisson qui me parcourait en la voyant ne disparaissait pas, elle était tellement belle que j’en avais mal. Sa parka bleu clair et lisse. Son bonnet blanc. La bordure en laine en haut de ses bottes. Son visage quand pour une raison ou pour une autre elle nous regardait d’un air renfrogné. Son sourire éclatant comme des millions de diamants. Quand la neige se mit à tomber, on partit à la recherche d’endroits à nous pour sauter, glisser ou creuser des galeries. Ses joues chaudes et rouges, l’odeur douce mais particulière de la neige qui variait tant selon la température, mais qui était omniprésente de toute façon, et puis toutes les possibilités qui s’ouvraient à nous. Un jour, alors qu’un épais brouillard enveloppait les arbres et que l’air était saturé de bruine, nos cirés adhéraient si peu à la neige qu’on glissait comme des phoques. Au sommet de la pente pierreuse, je m’allongeai à plat ventre, Anne Lisbet s’assit à cheval sur mon dos, Solveig sur celui de Geir, et on glissa ainsi jusqu’en bas. C’était le plus beau jour que j’avais jamais vécu. Et on recommença encore et encore. La sensation de ses jambes encerclant mon dos, sa façon de se tenir à mes épaules, ses cris quand on prenait de la vitesse, et le formidable chaos quand, arrivés en bas, on roulait dans un méli-mélo de bras et de jambes. » (Jeune homme)
Un accident :
« Un matin, sur le chemin de l’école, j’avais vu le père et sa fille remonter le ravin pierreux en contrebas de la route, ils saignaient tous les deux du front et la petite avait un mouchoir ensanglanté autour de la tête. Je me souviens qu’ils m’avaient fait penser à des animaux car ils n’avaient pas dit un seul mot, ni appelé, se contentant d’escalader calmement la pente caillouteuse. Au fond du ravin, leur camion avait percuté un arbre. Un peu plus bas coulait le fleuve, brillant et noir. Je leur avais demandé si je pouvais les aider, le père avait répondu que ce n’était pas nécessaire, que ce n’était pas grave, et bien que le spectacle fût insolite au point qu’il était difficile de s’en détacher, j’avais ressenti l’immoralité de rester là à les regarder et j’avais continué ma route vers l’arrêt de bus. Une seule fois je m’étais autorisé à me retourner : ils traversaient la route en boitant, le père vêtu comme toujours d’un bleu de travail entourait de son bras le corps menu de la petite de onze ans. Nous avions l’habitude de nous moquer d’elle et de son frère William. Les mots et les idées n’étant pas leur fort, il était aisé de les énerver et de les pousser dans leurs derniers retranchements. Plus tard je compris qu’ils n’y étaient pas indifférents. C’était un jour d’été ennuyeux où Per et moi avions sonné chez William pour qu’il vienne jouer au foot, et sa mère était sortie sur la terrasse nous engueuler, moi en particulier parce que je me croyais supérieur aux autres et surtout à son fils et sa fille. Je répliquai et il s’avéra qu’elle non plus ne s’exprimait pas aisément, mais elle était moins facile à remettre à sa place que ses enfants. Pour finir, je récoltai l’admiration hilare de Per qui trouva que j’avais de l’esprit et le tout fut oublié quelques heures plus tard. Mais dans la maison du virage, on n’oubliait pas. » (La mort d’un père)
Le jeune prof :
« Dévalant la pente à bicyclette, Vivian, Live et Andrea agitèrent la main et me crièrent salut en me dépassant, les cheveux au vent et les yeux plissés tout en fendant l’air. Je souriais tout seul longtemps encore après leur passage. Elles étaient si drôles, empreintes d’un grand sérieux qu’une joie enfantine tout aussi grande faisait voler en éclats.
….
Lorsque les enfants [élèves] entraient lentement en chaussettes et en gros pull, les cheveux ébouriffés par leur bonnet et les yeux ensommeillés, je les voyais tels qu’ils étaient, tout petits et fragiles. Et que je puisse parfois m’énerver et me mettre en colère contre certains me paraissait à la limite du concevable. Mais au cours de la journée, ils étaient entraînés dans des tourbillons de cris et de hurlements, de bagarre et de moquerie, de jeux et d’ardeur qui faisaient que je ne voyais plus les petites personnes en eux mais uniquement ces courants qui les traversaient. » (Aux confins du monde)
Un inventaire du monde :
« Dans la vie, tout est important, tout est pertinent en soi, parce que tout existe, et tout coexiste – les seize grandes stations pétrolières au large du détroit de Galtesund dans les années soixante-dix, le prunier sous ma fenêtre, le travail de maman place Kokkeplassen, le visage de papa que j’apercevais quand il passait en voiture, l’étang où nous allions faire du patin en hiver, les odeurs de la maison des voisins, la mère de Dag Lothar quand elle nous avait préparé un milkshake, la mystérieuse voiture qui stationnait un soir à Ubekilen, tout le poisson que nous mangions au déjeuner, le balancement des pins du voisin sous les violents vents d’automne, les accès de fureur de papa quand j’appuyais mon genou sur son siège dans la voiture, les gaufres du mardi, mon amour enflammé pour Anne Lisbeth, les ballons de football que maman et papa nous avait achetés lors de vacances en Allemagne, le mien avec des hexagones verts et rouges, celui d’Yngve [son frère] avec des hexagones jaunes et rouges, comment, un jour au parc, nous avions shooté le plus fort possible en l’air pour essayer d’atteindre l’hélicoptère militaire qui passait alors à très basse altitude. Ce dernier souvenir avait apporté avec lui une foule d’autres souvenirs – ainsi, durant le voyage des parents en Allemagne, j’avais habité chez mes grands-parents paternels et Yngve chez nos grands-parents maternels, une semaine dont je me souvenais avec une incroyable acuité, surtout les jours que nous avons passés dans le cabanon. Comme une couronne tressée de souvenirs, imbriqués les uns dans les autres, toute mon enfance reposait en moi. » (Fin de combat)
Passage proustien. Dans son nouveau bureau à Stockholm :
« Puis mon regard se posa sur le sol de la pièce. C’était un parquet relativement neuf et sa teinte marron-rouge n’avait rien à voir avec le style fin de siècle de l’appartement. Tout à coup, à environ deux mètres de ma chaise, je vis que les nœuds et les cernes du bois formaient l’image du Christ avec sa couronne d’épines.
Je constatai le fait sans y accorder plus d’attention car ce genre d’images créées par les irrégularités du sol, des murs, des portes et des plinthes — ici une tache d’humidité sur le plafond ressemble à un chien qui court, là une couche de peinture usée sur un seuil de porte ressemble à une vallée enneigée devant une chaîne de montagnes par-dessus laquelle des nuages ont l’air d’avancer —, ces images donc se trouvent partout, mais celle-ci dut déclencher quelque chose en moi car lorsque, dix minutes plus tard, je me levai pour aller remplir la bouilloire, il me revint soudain le souvenir de ce qui s’était passé il y avait très longtemps, au plus profond de mon enfance, un soir que j’avais vu au journal télévisé une image semblable dans la mer, lors de la disparition d’un chalutier. Pendant la seconde que je mis pour remplir la bouilloire, je revis notre salon d’alors, la télévision plaquée en teck, les taches de neige que je voyais luire çà et là sur le coteau à la tombée du jour, la mer sur l’écran de télévision, le visage qui y apparut soudain. Avec les images revint aussi l’ambiance d’alors, le printemps, la cité pavillonnaire, les années soixante-dix, notre vie de famille à cette époque-là. Et une nostalgie presque sauvage s’empara de moi. » (La mort d’un père)
Deux écrivains vus par le Knausgaard de 18 ans :
« Kundera aussi était un écrivain postmoderne mais cet apport d’autres mondes lui faisait totalement défaut, chez lui, le monde était toujours le même, c’était Prague, la Tchécoslovaquie et les Soviétiques, et soit ils avaient envahi le pays, soit ils allaient le faire, et c’était bien en soi, mais il sortait tout le temps ses personnages de l’intrigue, intervenant lui-même pour s’étendre sur une chose ou une autre, pendant que les personnages attendaient, comme s’ils restaient sans bouger devant la fenêtre ou ailleurs, qu’il ait terminé avant de se remettre à bouger. Et donc on voyait bien que l’action n’était qu’une intrigue et les personnes que des personnages, quelque chose d’inventé, on comprenait que ça n’existait pas, et dans ce cas, pourquoi le lire ? À l’opposé de Kundera, il y avait Hamsun, personne n’allait aussi loin que lui dans la présence au monde de personnages, si on devait les opposer l’un à l’autre, c’était ça que je préférais en tout cas, le physique et le réel dans La Faim par exemple. Là, le monde avait du poids, là, même les idées étaient captives, alors que chez Kundera elles s’élevaient au-dessus du monde et en disposaient à leur guise. » (Aux confins du monde)
Tout en considérant que le roman appartient au social, aux rapports entre les humains, Knausgaard reste envoûté par l’appel de Hölderlin : « Viens dans l’Ouvert, ami ! ». Pour le poète allemand « la poésie cherchait à s’insinuer dans l’espace entre le langage et le monde », ce qui n’est possible qu’avec l’aide du langage. L’Ouvert devient ainsi l’utopie du poète. Mais Knausgaard continue de courir après dans son roman (noter que l’ouvert, l’ouverture chez lui symbolise aussi ce qu’il cherche en écrivant, son désir de se libérer des carcans littéraires, comme l’ont fait remarquer des critiques) :
« Il suffit de faire un pas de côté et le monde change. Un pas de côté, et on est dans un monde dépourvu de nom … Cette petite boîte bleue avec un soleil rouge et ses côtés noirs rayés, à l’intérieur de laquelle les allumettes blanches aux têtes soufrées reposent comme dans un lit, c’est le divin qui est là, immobile, en haut du placard de la cuisine, entouré d’une fine couche de poussière, éclairé faiblement à travers la fenêtre par la lumière du jour, qui s’assombrit lentement, au moment où une muraille noire de nuages s’abat sur la ville, où les premières décharges électriques la sillonnent à toute vitesse, selon des chemins imprévisibles, et où le tonnerre gronde lourdement dans le ciel. Le vent qui se lève et la pluie qui commence à tomber, c’est le divin. La main qui attrape la boîte, fouille le petit lit du bout de l’index et sort une des allumettes est une main divine, et la flamme ardente qui apparaît quand cette main gratte la tête soufrée contre la surface râpeuse, et qui, en moins d’une seconde, devient une flamme régulière, plus douce, c’est la flamme du divin. Mais elle brûle à l’abri du langage, elle brûle à l’abri des catégories, elle brûle à l’abri de tous les liens et de toutes les connexions que ces catégories instaurent. » (Fin de combat)
Après une fête de village :
« Un moment après que le groupe eut cessé de jouer, on arrêta aussi de passer de la musique, et pendant que les gens quittaient la salle, la lumière fut rallumée, crue et tremblante, et le voile de magie qui enveloppait tout fut arraché. La piste de danse, ce lieu des rêves les plus doux et les plus chaleureux quelques instants auparavant, était maintenant nue, vide et maculée de boue et de gravier laissés par les bottes qui l’avaient piétinée toute la soirée. Le plafond, où avait pulsé une lumière rouge, verte et bleue quasi sous-marine, quand il n’avait pas brillé comme un ciel étoilé, n’exhibait plus rien qu’une barre de projecteurs au milieu de laquelle pendait une stupide boule disco, clinquante et bon marché. Les tables autour desquelles les gens s’étaient installés et amusés dans un espace de chaleur humaine étaient maintenant dans tous les sens, et au-dessous d’elles le sol était jonché de bouteilles vides, de paquets de cigarettes vides, de bris de verres çà et là et d’une longue bande de papier toilette que quelqu’un avait traînée sous ses pieds sans le savoir. Les tables étaient couvertes de taches collantes diverses et variées, de petites marques de brûlures de cigarettes, de cendriers débordants, de tasses et de verres empilés, de bouteilles vides de toute sorte et de thermos à café bon marché avec de longues traces de café sous le bec verseur. Ceux qui n’avaient pas quitté la salle avaient des visages fatigués et inertes, une structure osseuse tapissée de peau blanche et ridée, des yeux comme deux boules gélatineuses, des corps pleins de graisse et de bourrelets, ou si maigres et osseux qu’on imaginait leur squelette, qui reposerait bientôt, bien décapé, sous la terre salée d’un cimetière battu par les vents, quelque part au bord de la mer. » (Aux confins du monde)
Flirt raté :
« — Comment ça va ? demanda-t-il. Qu’est-ce qui s’est passé après la soirée ? Installés au salon, il mit My Bloody Valentine.
— Je l’ai raccompagnée chez elle. Il ne s’est rien passé, nous avons simplement parlé. Et puis je viens de la revoir à l’instant, au Wesselstuen. Je suis tellement amoureux que je ne sais plus quoi faire.
— Elle l’est aussi ?
— Aucune idée ! Je n’ai pas été foutu de lui sortir une seule parole intelligente. Tu sais ce que j’ai réussi à lui dire ?
Il secoua la tête.
— Je lui ai fait des compliments sur ses oreilles ! Tu imagines ! Je lui ai dit, tu as de belles oreilles ! Parmi toutes les choses que je pouvais lui dire, j’ai choisi ça. » (Comme il pleut sur la ville)
La vie à deux :
« Et plus je me renfermais, plus elle m’agressait. Et plus elle m’agressait, plus je remarquais ses sautes d’humeur. … Quand elle était fâchée, tout en moi n’était que présence. C’était comme s’il y avait dans la pièce une espèce d’énorme chien qui essayait de me mordre et dont je devais m’occuper. Parfois, quand nous parlions, il m’arrivait de sentir sa force, la profondeur de ses expériences, et de me sentir inférieur. À d’autres moments, quand elle s’approchait et que je la prenais, ou quand tout simplement nous étions allongés dans les bras l’un de l’autre, ou quand nous parlions et qu’elle n’était qu’incertitude et inquiétude, je me sentais tellement plus fort que rien d’autre ne comptait. Ces va-et-vient, ces fluctuations d’où pouvait surgir n’importe quand n’importe quel cataclysme, toujours suivi d’apaisement et de réconciliation, avaient lieu sans arrêt, il n’y avait jamais de pause et le sentiment d’être seul, y compris en sa compagnie, s’amplifiait.
Depuis que nous nous connaissions, nous n’avions jamais fait les choses à moitié, celle-là non plus.
Un soir que nous nous étions querellés puis réconciliés, on parla d’enfant. …
— Peut-être devrions-nous remettre ça à un peu plus tard, dis-je.
— Qu’est-ce que tu racontes ? dit Linda en me dévisageant.
— On peut attendre un peu et voir. Tu pourrais finir ta formation…
Elle se leva et me gifla de toutes ses forces.
— Jamais ! cria-t-elle.
— Mais qu’est-ce qui te prend ? T’es complètement folle ou quoi ? Tu me frappes ?
Ma joue brûlait, elle avait vraiment frappé fort.
— Je m’en vais. Et je ne reviendrai plus jamais, tu peux y compter.
Tournant les talons, j’allai chercher mon manteau dans l’entrée.
Je l’entendis sangloter à fendre l’âme dans mon dos.
— Ne pars pas, Karl Ove. Ne me quitte pas maintenant.
Je me retournai.
— Tu crois que tu peux faire tout ce que tu veux, c’est ça, hein ?
— Pardonne-moi. Reste. Cette nuit seulement.
Je me tenais devant la porte, dans le noir, à la regarder, en hésitant.
— D’accord. Je reste cette nuit. Mais après je pars.
— Merci.
Je me réveillai vers sept heures du matin le lendemain, quittai l’appartement sans petit-déjeuner et rejoignis le mien, que j’avais toujours. Je montai avec une tasse de café sur la terrasse du toit, m’assis et fumai en regardant la ville et en me demandant ce que j’allais bien pouvoir faire maintenant. » (Un homme amoureux)
Publication du tome 5 :
« Quand il fut terminé, je l’envoyai à tous ceux que j’avais mentionnés. Certains se mirent en colère, prétendant que je détruisais leur vie, et je remplaçai leur nom, d’autres me demandèrent de supprimer certains passages aux conséquences dangereuses dont je n’avais pas pris la mesure à l’époque, d’autres encore me dirent de ne rien changer du tout. Ce fut le cas de Tonje [sa première femme], la personne la plus importante du livre hormis Yngve. Je demandai à Linda de ne pas l’ouvrir parce qu’il lui serait désagréable de lire une histoire d’amour que j’avais eue avec une autre femme. De la même façon, mais pour une raison différente, j’avais demandé à maman de ne pas lire le troisième tome. Après avoir lu le deuxième, elle m’avait envoyé un mail où elle écrivait que cela faisait mal d’être rabaissée. À la lecture du quatrième, elle m’appela, courroucée au plus haut point, j’avais écrit quelque chose qui n’était pas vrai du tout à propos de l’époque où nous habitions tous les deux la maison de Sannes, un épisode qui concernait l’alcool – soit je m’étais complètement trompé, soit j’avais tout inventé. Je supprimai le passage. Le journal télévisé norvégien vint m’interviewer, après quoi je rentrai à la maison me coucher, paralysé par l’angoisse : l’interview serait diffusée aux informations du samedi soir, toute la Norvège la verrait, et j’avais à peine réussi à dire une phrase cohérente. » (Fin de combat)
Divers :
« Ma solitude, personne ne pouvait me la prendre. Le monde était un espace où j’évoluais et où tout pouvait survenir, mais dans l’espace que j’avais à l’intérieur de moi, qui était moi, tout était toujours pareil. Toute ma force était là. Le seul qui pouvait m’atteindre par là était papa, et il le faisait dans mes rêves quand il m’interpellait, comme planté dans mon âme. »
« La pluie qui claquait, l’eau qui s’écoulait par terre en formant de larges V, les cascades qui pulsaient des descentes de gouttière.
Oh, c’était le monde, et j’étais dedans.
Que faire ? J’avais envie de tambouriner des poings sur les vitres, de courir dans la pièce en hurlant, de renverser les tables et les chaises autour de moi, car j’étais plein à exploser de puissance et de vie. »
« Certains profitaient au mieux de la vie en travaillant, d’autres en ne travaillant pas. Bien évidemment je comprenais qu’il me fallait de l’argent et que ça signifiait que moi aussi je devais travailler, mais pas tout le temps et pas en faisant un travail qui me prendrait toutes mes forces et me rongerait l’âme, faisant de moi un de ces quinquagénaires idiots qui surveillent leur haie et qui regardent chez le voisin pour voir si son statut social est plus élevé que le leur. »
« Heidi se leva, je la suivis dans le couloir, lui brossai les dents ainsi qu’à Vanja et à John, avant de dire au revoir à Njaal et à Geir et de sortir sur le palier, sans que nous passions inaperçus des voisins, me dis-je, le niveau sonore des enfants étant toujours très élevé quand nous sortions de l’immeuble ou y rentrions, et les bruits ricochant le long des murs à travers tous les étages. J’avais souvent entendu les enfants depuis le septième étage, alors que je me trouvais moi-même au rez-de-chaussée, attendant l’ascenseur.
Tiens, c’est la famille norvégienne qui sort, se disaient-ils peut-être. Ils sont sacrément en retard aujourd’hui. Ou bien : Encore ce foutu Norvégien et ses gosses. »
« En réalité, me dis-je, il n’y avait que deux formes d’existence, celle liée à un lieu et celle qui ne l’était pas. Les deux avaient toujours existé. On ne pouvait pas choisir. »
« Je me faisais la réflexion que la prose était quelque chose où l’on pouvait reposer, comme on peut reposer dans un lieu, sous un arbre ou dans un fauteuil au jardin, et que cela avait une valeur en soi. »
♠
En complément
L’excellente conférence de Toril Moi (elle passe du norvégien à l’anglais vers la 14e minute) où elle situe l’œuvre dans la littérature actuelle
Le numéro des Scandinavian Studies de l’an dernier consacré à Knausgaard (donne un aperçu de la lecture qui a été faite du roman dans les pays scandinaves, suivi de parallèles avec Coetzee, Ferrante et Proust)
La conférence Inadvertent de Knausgaard publiée par Yale en 2018 (résumé de sa conception de la littérature, bien qu’elle apprendra peu à qui a lu Comme il pleut sur la ville)
Ses entretiens avec Joshua Rothman dans le New Yorker et James Wood dans la Paris Review
L’entrevue conjointe de Maggie Nelson (Les argonautes) et Knausgaard (porte sur leurs points communs : la manie du détail, les enfants, la mémoire vs la création, leur popularité, etc.)
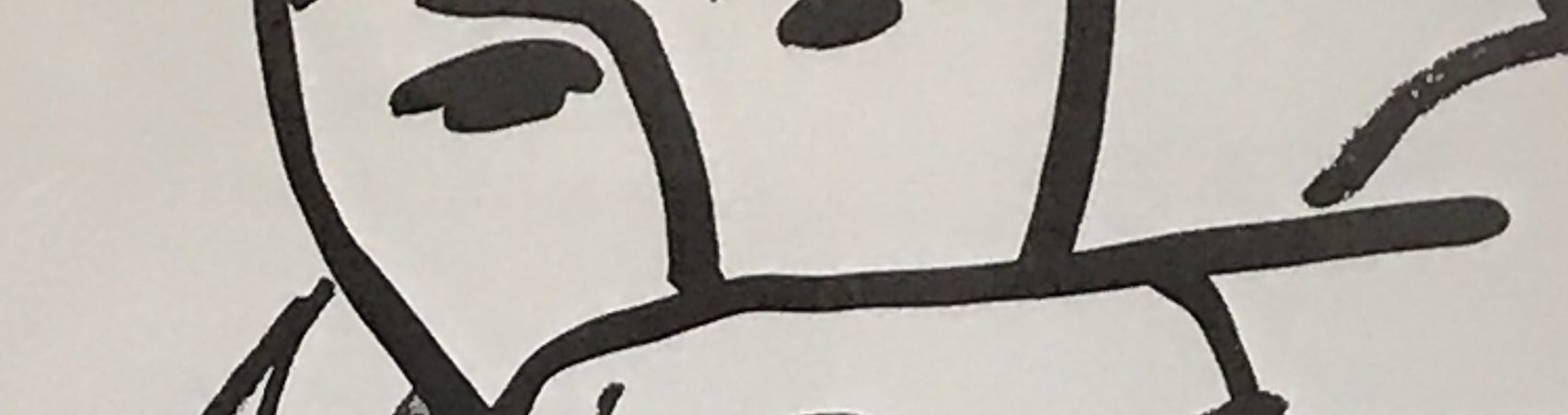
Excellent comme toujours. J’ai lu Un homme amoureux et c’est vrai que lorsqu’il commence à nous détailler ses promenades au parc ou ses journées à la garderie avec ses enfants on a vraiment envie de décrocher, Tout à coup, la littérature prend le dessus car le ton change radicalement. C’est un écriture qui nous brasse. Pour lecteur avisé, pas pour ceux et celles qui ne peuvent pas lire un « post » de 4 lignes sur FB. Merci Jacques.
J’aimeAimé par 1 personne
Immense travail sur une œuvre immense. L’article montre bien que cet auteur propose quelque chose d’unique. Des phrases comme celle-ci : « Je pense ce que je pense, je n’y peux rien, n’est-ce pas ? » ou celle-ci encore, « La solitude décrite dans un beau style élève l’âme vers d’incroyables hauteurs. Alors la vérité disparaît, car la solitude n’est pas belle, pas plus que le désespoir, ou le manque » donnent à réfléchir. C’est le moins qu’on puisse dire.
Votre article laisse entendre que Karl Ove Knausgaard proposerait rien moins qu’un nouveau type de littérature, pas classable. C’est ceci, mais pas tout à fait. Un peu comme cela, quoique, etc. Mais à coup sûr, c’est de l’écriture et c’est de la littérature.
Quant au procès plus ou moins intenté contre la fiction ou à la distance prise à son endroit, je crois pour ma part que c’est un peu négliger la part qu’y joue l’imagination et le plaisir troublant qu’elle peut susciter. Un auteur qui invente découvre au fur et à mesure qu’il avance dans son aventure les sens inconnus de lui que celle-ci en vient à lui révéler.
Je ne suis pas clair. Ce que je veux dire, c’est que les puissances de l’imagination, comparables à celles du rêve ou d’une certaine folie, permettent, un peu moins cependant chez des écrivains cantonnés dans le réalisme, d’explorer des territoires qui sont loin d’être insignifiants.
Cela dit, je comprends qu’on puisse se détourner, pour des raisons que Breton a du reste évoquées dans son premier manifeste, du roman conventionnel dont le seul mérite est de distraire des lecteurs et des lectrices. Alors que le contraire serait plutôt de mise. Leur remettre le nez dans ce que Artaud appelait d’un vilain petit mot enfantin qui se fait parfois dans les culottes.
J’aimeAimé par 1 personne
@Nicole Commentaire très juste sur K.O.K. Il vole à ras de terre pendant un bout de temps, puis tout à coup décolle comme une fusée. C’est comme ça d’un bout à l’autre.
J’aimeJ’aime
Breton opposait le roman à la poésie, et non à un renouvellement de la forme, bien qu’il aimait les romans gothiques comme Le Moine de Lewis ou le Château d’Otrante, et les Gracq sans doute. Mais oui, ils ont tous les deux une réaction semblable face à la littérature conventionnelle. Knausgaard cherche une façon de raconter sans rien d’artificiel. En fait, ce n’est pas une théorie universelle de sa part, c’est ce qu’il voulait faire, lui.
J’aimeJ’aime
Mettre en ligne la vie et l’écriture de Knausgaard ; met en ligne la vie et la lecture de Jacques Desrosiers. Impressionnant tout le temps qu’il a consacré au résumé de toutes ces lectures.
J’aimeAimé par 1 personne
c’est dans la revue LES LIBRAIRES que j’ai entendu parler de Knausgaard pour la première fois, on disait que son long roman autobiographique avait fait scandale et cela m’avait intrigué et puis il y avait sa photo, la gueule d’une rock star, ce qui est rare quand il s’agit d’écrivains; puis il y a eu un premier livre et tout de suite la magie a opéré, j’ai été happé comme on l’est, dit-on, par certaines drogues et au fond pour moi lire c’est un peu ça et avec MON COMBAT ce fut comme si j’avais retrouvé ma ferveur initiale, celle que j’avais connue quand j’avais découvert la lecture, me retrouver avec un auteur et tout lire de lui, tout savoir de lui, être fasciné, l’envier, le jalouser, avoir l’impression qu’il a pris ma place, qu’il a dit ce que je voulais dire et être conscient que lui, et lui seul, avait les moyens de le faire et au-delà de la jalousie et de l’envie, ces passions tristes ( Spinoza ), ressentir de l’affection et de l’admiration et le goût d’être reconnaissant, Knausgaard m’a donné du bonheur, je suis bien en sa compagnie même si je ne prendrai jamais de café avec lui; et cette reconnaissance je l’éprouve aussi pour ce beau texte que JD vient de faire paraitre ici, sur son blog; je le considère déjà comme ma bible personnelle, ce texte sera ma mémoire de Knausgaard, moi qui n’en ai plus, qui lis sans se souvenir et je m’y référerai pour me rappeler MON COMBAT et aussi pour me dire qu’avec un éclaireur comme JD j’ai de la chance.
J’aimeAimé par 1 personne
C’est sans doute, Pierre, à l’époque où vous lisiez cet article des Libraires que j’étais passé dans une librairie où mon premier Knausgaard m’avait sauté dessus, parce que je me souviens que quelque temps plus tard le dénommé Robert Baillie nous avait signalé à l’un et à l’autre, séparément, que quelqu’un d’autre parmi ses amis s’était entiché du même écrivain. Ce fut un cas réussi de matchmaking littéraire. Depuis je me suis toujours senti votre complice chaque fois qu’il est question de Knausgaard. À moi aussi il a donné un grand bonheur de lecture, et nous avons sans doute vécu des émotions semblables en tournant les pages de ses volumineuses confessions.
J’aimeJ’aime
J’ai lu d’abord « A Man In Love », en … 2014 (déjà), puis le premier tome, et me suis dit d’attendre le 6e volume pour retourner chez Knausgaard, en laissant les autres tomes de côté parce que tout de même, ce n’était pas Proust, justement. Mais là je vous lis — ce qui m’a pris toute ma matinée — en renonçant à l’idée de me priver des tomes 3 à 5, encore qu’avec le temps qui ne rajeunit pas, il y ait des tonnes de choses à lire (tout Montaigne, la correspondance de Flaubert, Huysmans, pour ne mentionner que des auteurs français), qui est une des rares bonnes raisons que ça me donne d’espérer vivre vieux…
J’aimeAimé par 1 personne
La correspondance de Flaubert, oui ! J’ai en ai lu deux tomes, entamé le 3e qui m’attend depuis 2 ans. Mais on commence à parler beaucoup de Flaubert cette année, j’ai donc de bonnes chances de m’y remettre. C’est difficile de fermer les yeux sur tant d’autres livres, mais, quitte à le dire pédantesquement, les œuvres énormes dont vous parlez sont celles qui donnent les plus grands bonheurs de lecture (ouache). Alors entre deux mastodontes je lis à la course toutes sortes de choses. J’avais aussi commencé par Un homme amoureux, puis 1 et en anglais 3-4-5, puis 6, et en français 3-4-5. Il faut croire qu’il m’a fasciné. Il est frappant aussi que depuis il a influencé ou rallié surtout des écrivaines dirait-on (Cusk, Nelson, etc.). Elles l’ont comme moi sans doute lu vite. Proust ou Montaigne, c’est une autre vitesse ! Des milliers de pages pour nous donner envie de vivre longtemps en effet.
J’aimeAimé par 1 personne
Ce sont là des choses massives dont j’ai compris l’ampleur avec Proust qu’en le lisant, est passé du statut de divertissement sophistiqué à celui d’expérience réelle au même titre qu’une relation ou un voyage déterminants. Ces lectures qui vous passent au travers du corps pour devenir une partie de vous — du temps que vous passez sur cette terre, et qui vous forment et même vous changent, parce que, oui, ça existe, mais ailleurs que dans le rayon « Croissance personnelle » — sont un des dons les plus élevés qu’on puisse découvrir de la littérature (la lecture), soit en tant qu’elle est capable de procurer une expérience qui n’est plus de procuration mais, à mon avis, bien concrète, et avoir le même poids et la même vivacité qu’un souvenir personnel ou celui d’une époque entière de sa vie. Mon avidité me porte vers les sommes exhaustives et massives qui épuisent leur sujet, par admiration pour cet effort, et aussi par la conviction que ces ouvrages ont besoin de moi et en appellent à mon zèle — le traité sur la mélancolie de Burton, par exemple, me reproche de le négliger depuis cinq ans — mais on pourrait en dire autant d’un poème relu maintes fois, de l’autobiographie sauvagement fantasmée (une autofiction au sens le plus flamboyant du terme) que sont « Les chants de Maldoror » ou « Une Saison en enfer », textes relativement courts qu’à juste titre, on peut considérer comme des autoportraits et des bilans de vie procédant de la même démarche de synthèse, ou « Les Poètes de sept ans » qui est dans le peu de mots qu’il déploie injecte un souffle romanesque dans le genre poétique jamais vu auparavant, que je sache, inventant le genre du poème-roman ou du roman-poème. Baudelaire (dont on recommence à parler en ce moment aussi, que se passe-t-il ce printemps?), en comparaison, était un miniaturiste; la correspondance de Flaubert en a cependant marqué le coup, et le jeune Rimbaud correspondant avec Izambard, les limites qui lui inspiraient l’envie de le dépasser. En conclusion cette littérature qui exige qu’on s’y investisse comme on commettrait un sacrifice (Knausgaard 3 à 5 lus en anglais puis relus en français? C’est intense) satisfait un désir fondamental auquel peu de gens veulent se risquer, celui de pouvoir se projeter dans d’autres vies que la nôtre, dans ses moindres détails, pour sentir cette connexion et cette intimité humaine qui rappellent comment les petites différences pour lesquelles les humains se battent et se haïssent sont des leurres.
J’aimeAimé par 1 personne
Très beau texte, bien senti. Vous recoupez un propos d’André Major qui, dans ses Carnets, parle du pacte qu’il avait conclu avec « des artistes devenus aussi vivants que si je les avais côtoyés depuis toujours ». J’ai déjà discuté de ça avec quelqu’un : j’ai presque toujours lu de façon thématique, quelques années jadis à ne lire que des Québécois, puis pendant trois ans que de la poésie européenne, puis deux ans avec les Russes, et ainsi de suite. Au début des années 1990 j’ai plongé dans Thomas Bernhard, en même temps que beaucoup de monde. Pendant quatre mois, je n’ai lu que du Bernhard, pas de journaux, pas de revues, pas de télé, même pas de musique, rien d’autre. Si au moment de mourir on voit passer dans un éclair tout le monde qui a compté, il sera là avec les autres, pas avec la même présence que les proches évidemment, mais pas loin, et plus que de nombreuses connaissances. Voilà, vivre c’est aussi lire.
J’aimeAimé par 1 personne
Oui, André Major en a parlé, je crois, dans « Le sourire d’Anton » (pour Tchekhov), expliquant ce pour quoi il abandonnait la fiction pour se faire diariste à plein temps. Toutefois, si je m’adonnais à votre genre d’ascèse, j’aurais peur de m’ennuyer prématurément avec le style d’une seule personne. 3 semaines avec Thomas Mann sans musique, sans radio, sans rien, pourrait m’écoeurer de lui avant de l’avoir épuisé comme sujet. De temps en temps, laisser reposer un livre est la meilleure solution pour y retrouver de l’intérêt, après quelque temps quand on y revient. Mais Thomas Bernhard est un auteur immersif qui se prête à ce genre de relation fusionnelle. En général par ici, mon régime me ferait lire un ou deux chapitres de romans différents, plus trois ou quatre nouvelles (ou lettres ou entrées de journal, ou articles) par jour, chacune par des auteurs différents. Toujours en quête d’étonnant. Il faut creuser pour en trouver, je ne m’arrête pas tant que je n’ai pas la certitude d’avoir découvert quelque chose dans ma journée. Pour ça il aura suffi qu’une phrase bien faite me fasse rire – ou me cause une quelconque émotion, mais je tiens le rire en très haute estime, car c’est une réaction peu complaisante et involontaire; le vrai rire est toujours sincère, car il nous échappe et constitue donc un critère indiquant que le texte nous a subjugué. Bref, si cette phrase bien faite (qui fait rire) intervient dans les 30 premières minutes de la journée, les heures restantes peuvent se consacrer à… absolument rien du tout. (J’arrête de lire.) Et si cette phrase bien faite tarde à se faire remarquer, je peux rester deux jours debout sans dormir à la chercher. (Ou à essayer de la produire.) C’est comme ça…
J’aimeAimé par 1 personne
Bonjour,
J’ai lu avec beaucoup d’intérêt votre article concernant Mon combat.
J’espère que vous me pardonnerez cette question aussi triviale mais j’aurais aimé savoir comment vous êtes vous procurez l’image de Matisse qui figure dans l’entête de votre article. Mes parents possédait une lithographie identique que j’ai récupérée et sur laquelle je cherche en vain des informations.
Je comprendrais bien sûr que vous ne répondiez pas à cette saugrenue requête et vous remercie encore dans tous les cas pour votre analyse éclairante sur cette œuvre admirable dont je termine en ce moment la lecture.
Bien cordialement.
J’aimeJ’aime
Bonjour, Vous avez bien reconnu la litho de Matisse. J’avais vu l’affiche il y a plusieurs années dans une boutique du Vieux-Montréal qui avait toutes sortes d’exclusivités et de litho de la même époque. J’ai vite découvert sur Internet, Pinterest, etc., qu’elle était assez rare. Alors je suis retourné l’acheter et je l’ai fait encadrer. Elle annonce une exposition à la galerie Maeght rue de Téhéran à Paris dans les années 50. Je ne saurais comment m’y prendre pour en trouver d’autres, mais il doit y avoir moyen ! Je vais voir plus tard si je peux vous envoyer une photo.
J’aimeJ’aime
Excusez-moi, je vous relis et je vois que vous l’avez en votre possession, cette affiche. Je n’en sais pas plus que ce que je vous ai dit.
J’aimeJ’aime
Merci pour votre réponse. Cela recoupe l’information qu’il m’avait déjà été donnée sur l’existence d’une affiche reprenant ce portrait. Aucune confirmation donc concernant l’existence d’autres éventuelles lithographies.
Je vais continuer mes recherches et ne manquerais pas si vous le souhaitez de vous tenir informé.
J’ai découvert votre site grace à la vidéo «Écrire c’est trahir »de Yasmina Behagle.
Bien à vous
J’aimeJ’aime
Oui, Yasmina m’avait envoyé un mot très agréable sur mon papier. C’est la galerie Maeght qui a produit l’affiche et exposé sans doute ce dessin de Matisse. Tapez dans internet « dessins Matisse » ou « dessins Matisse 1951 », ou cherchez quelque ouvrage sur l’ensemble de ses dessins. Enfin, bonne chance.
J’aimeJ’aime
Merci pour ce formidable article sur Karl Ove. Oui je l’appelle par son prénom comme s’il faisait partie de mes proches. Comme d’autres c’est par « un homme amoureux » que je suis entrée dans cet univers et ne l’ai plus quitté attendant la parution en francais de chaque volume. Votre article me fait extrêmement plaisir.Je me sens moins seule !
Il est remarquablement détaillé. J’ai essayé de faire lire Knausgaard à mes amis lecteurs de « grandelitterature » par ailleurs. Échos mitigés . Peut être y a t’il en France un goût de la forme…du style finalement très conventionnels et une mise à distance de l’émotion.
Je vais lire maintenant votre article sur l’essai consacré à Munch. Je m’en réjouis d’avance
J’aimeAimé par 1 personne
Merci beaucoup, Chantal Petrucci. C’est très agréable d’être lu avec un tel enthousiasme. Pendant des mois et des mois, je n’ai lu comme vous que du Knausgaard, sans jamais avoir l’impression de manquer quoi que ce soit. Vous mettez le doigt sur le problème de sa faible visibilité en France : il a un style bien sûr, comment faire autrement, ça roule à un train d’enfer en passant par tous les registres, mais voilà il n’y a pas chez lui une mise en valeur du style comme vous le suggérez. Sans doute parce qu’il ne met pas en valeur sa personne. On doit juger qu’il est souvent trop proche de la langue parlée (on a déjà reproché à Simone de Beauvoir d’écrire comme on parle !), mais aurait-il pu faire autrement si son idée était d’un bout à l’autre de se vider le cœur ? En France c’est perdant, je crois, de raconter des choses humiliantes sur soi-même – la honte est la grande affaire de KOK – et de se présenter comme quelqu’un de tout à fait ordinaire. Ajoutez la comparaison avec Proust, et d’entrée de jeu les carottes étaient cuites pour lui en France. On a juste oublié que pour raconter autant de choses sur soi-même avec autant de franchise quand on est ordinaire… suggère qu’on n’est pas tout à fait ordinaire. Au moins, les cinq premiers tomes ont été vraiment bien traduits en français. Dans le sixième ils se sont mis à plusieurs, et il y a des passages de bâclés. J’ai remarqué que souvent les Américains, dans les revues et sur les réseaux, l’appellent comme vous faites par son petit nom.
J’aimeJ’aime
Photo de cette période
J’aimeJ’aime
…Ah, voilà bien sûr! Voilà pourquoi Knausgaard n’a pas trouvé en France un écho aussi puissant qu’ailleurs. Parce qu’il « écrit comme on parle »…
Moi, j’aime ça et je vois que vous aussi!
Merci pour cet article intéressant.
J’aimeAimé par 1 personne