La poésie est omniprésente de diverses manières dans ces trois livres : par le survol d’œuvres contemporaines chez Antoine Boisclair, le récit d’une vie entièrement dédiée à la poésie dans Les villes de papier de Dominique Fortier, celle d’Emily Dickinson, et l’apologie d’une mystique littéraire chez Carl Bergeron.
*

Antoine Boisclair, Un poème au milieu du bruit : lectures silencieuses
Ce recueil qui se présente comme une simple collection d’essais pourrait presque servir d’introduction à la poésie. L’auteur a beau se limiter à une poignée de contemporains, il dégage de leurs poèmes des thèmes soit rattachés depuis toujours au cœur même de la poésie (le temps, la mort, la nostalgie), soit proches des grandes préoccupations actuelles (l’écologie, la métamorphose des villes, l’engagement politique). Sa palette est large : poésie québécoise, française, américaine, antillaise, mexicaine, polonaise, portugaise, géants comme Pessoa ou Szymborska (<chim-bor-ska>), poètes connus (Gaston Miron, Yves Bonnefoy) à côté d’autres qui nous sont moins familiers (comme Derek Walcott ou Amy Clampitt). Sans parler de tous ceux qui surgissent au fil des pages, de Guillaume de Machaut à T.S. Eliot. Sa sobriété de ton donne à ses textes quelque chose de clair et tranquille qui nous fait entrer de plain-pied dans les poèmes. À la fin de chacun de ces dix-huit courts chapitres, on a très bien saisi ce qui est en jeu dans les vers qu’il vient de passer au peigne fin.
Ses analyses sont d’autant plus fines qu’il évite la paraphrase (ce « veau d’or de la critique adoratrice », écrit Jacques Brault dans Images à Mallarmé). Il faut lire le chapitre entier qu’il consacre à un petit quatrain haïkuesque de Philippe Jaccottet (« Il y aura toujours dans mon œil cependant / une invisible rose de regret / comme quand au-dessus d’un lac / a passé l’ombre d’un oiseau »), qu’il examine avec une attention aux détails digne de Jakobson et Lévi-Strauss dépeçant Les chats de Baudelaire.
Il ne manifeste jamais crûment son enthousiasme, en revanche il ne craint pas la polémique. Pour lui, la poésie ne se laisse approcher que dans une bulle de silence et non dans le brouhaha d’un spectacle – d’où le titre du livre. Il est las de l’oralité en poésie. À sa manière pascalienne, Un poème au milieu du bruit est comme un acte de résistance à la poésie performée en public. Je ne sais pas s’il irait jusqu’à la condamner, mais il l’écarte de son chemin. Ce n’est pas une foucade, il réaffirme le principe avec insistance tout au long du livre, et son avant-propos est à l’avenant. La poésie concerne au premier chef le lecteur ou la lectrice seule dans son coin en train de lire un poème sur le papier ou la liseuse.
Le belge David van Reybrouck maintient dans ses Odes que la force de Leonard Cohen venait de ce que ses chansons « émergeaient de tout le tumulte de la musique pop », qu’elles étaient nées d’« un désir de silence dans un monde rempli de bruit ». C’est le sentiment qu’on a en lisant Boisclair, que la poésie qui parle « à voix basse » doit émerger au-dessus du reste. C’est un autre rythme de vie. Il le montre bien quand il explique comment Wallace Stevens crée une fusion entre le poème et la personne qui le lit, ou qu’il plonge dans Plus haut que les flammes de Louise Dupré qui, secouée par sa visite d’Auschwitz, écrit à la limite entre les mots et le silence.
Les poètes sur lesquels il s’attarde lui servent souvent de tremplin pour illustrer sa conception de la poésie. Il n’aime pas l’emphase, se méfie de l’exubérance, vante la retenue et l’observation, la simplicité alliée à la finesse philosophique comme chez Hélène Dorion. Aux poètes qui veulent refaire le monde, il préfère ceux qui l’habitent comme leur maison. Dans une entrevue, il a expliqué que les poèmes à pente philosophique nous gardent « à l’abri des clichés de la poésie militante, de ses travers lyriques ». Mais s’il condamne les excès du lyrisme, il l’admire quand il est dépourvu de narcissisme ; la poésie militante, non, mais engagée oui. La poésie est là pour nous ouvrir les yeux, et non pour prêcher la vertu.
On comprend entre les lignes qu’il ne prise pas la poésie marquée au coin de la colère ou de l’insoumission. C’est sans doute pourquoi chaque fois qu’il évoque le surréalisme – et il le fait à plusieurs reprises dans le livre – c’est immanquablement comme un repoussoir. Par contre il parle toujours avec ferveur du réalisme, surtout côtoyant l’idéalisme comme chez Bonnefoy, le lyrisme et la métaphysique comme chez Walcott ou dans le sublime « Bureau de tabac » de Pessoa, dont il fait une analyse remarquable. Comme il met au-dessus des autres les poèmes qui nous donnent à voir le monde, au lieu de nous en éloigner comme chez les surréalistes selon lui, il cite souvent Ponge qu’il voit comme un maître et met généreusement en continuité aussi bien avec les célèbres Notes de chevet de Sei Shônagon (11e s.) qu’avec un recueil d’Aurélie Foglia paru en 2018. Vu le grand nombre de témoins qu’il fait intervenir presque à chaque page, j’ai regretté de ne voir nulle part passer l’immense Michaux, curieux de la place qu’il lui aurait réservée dans son panthéon. En voilà un qui n’était ni réaliste, c’est le moins qu’on puisse dire, ni surréaliste. Mais loin de la réalité ? Voilà une notion qui n’a rien de limpide. Il est bien possible que dans une poésie comme celle de Michaux il y ait trop de secousses à son goût.
La précision, la justesse du mot, la lisibilité sont des qualités primordiales à ses yeux. Il nous met en garde contre les poèmes qui nous jettent à la figure des métaphores incompréhensibles, autant que contre la poésie du quotidien. Même la poésie tournée vers le réel brut doit transcender la laideur du monde, au lieu de verser dans la poésie-poubelle. Aussi est-il impressionné par la méditation poétique, comme chez Octavio Paz observant une « rumeur d’eau qui brille » à côté d’un dépotoir à ciel ouvert, ou Amy Clampitt évoquant la mer qui brasse indifféremment pierres précieuses et bouteilles de bière. La poésie est de la littérature, elle ne peut se réduire à une régurgitation de l’expérience empirique.
Antoine Boisclair admettrait sûrement que la poésie a connu de grands moments sur scène (il suffit de penser à Speak White de Michèle Lalonde). Mais son livre rappelle que la puissance d’envoûtement d’un poème lui est souvent conférée par la voix feutrée du poète, qu’on ne peut entendre qu’en tendant l’oreille dans la concentration et le silence. Beaucoup de pages mériteraient d’être commentées, celles sur les vers amoureux de Marie Uguay, sur l’énigmatique Abraham Moses Klein qui ressentait les affinités entre les cultures juive et québécoise, sur la manière dont Louise Glück élève le silence jusqu’à la paix intérieure dans « Musique céleste ». Grâce largement à l’érudition de son auteur, c’est un livre au contenu riche.
*
Dominique Fortier, Les villes de papier
J’ai longé plusieurs fois le présentoir très fourni de la librairie où je m’étais arrêté, à Rimouski, avant de repérer ce livre si discret dans l’édition Alto. Objet de curiosité qu’on aurait dit qu’on pouvait déplier comme un origami, pour en faire surgir des villes, peut-être des poèmes cachés comme dans une cocotte de papier. La soigneuse page d’herbier qui orne la couverture évoquait déjà une sensibilité aux aguets.
À l’intérieur on découvre une Emily Dickinson attentive presque sensuellement au monde à la portée de son regard : son jardin, un nid de brindilles, l’érable devant sa fenêtre, le blanc immaculé de ses robes, effacés à l’occasion par la voix inopportune d’un visiteur au rez-de-chaussée. Cette femme qui finira par se cloîtrer dans sa chambre, ne voulant plus voir personne sauf ses proches, Les villes de papier ne la présente pas comme une recluse attendant d’être délivrée par quelque expert en psychose (la légende a d’ailleurs exagéré sa réclusion), mais comme une écrivaine qui a donné sa vie à la poésie, sans même se soucier de publier les centaines de poèmes qu’elle jetait dans le tiroir de sa commode. Elle a choisi de vivre à l’écart non de l’ordre social, mais de la société. C’est la ligne de force sur laquelle avance la prose délicate de Dominique Fortier : dédramatiser la solitude d’Emily Dickinson.
Fortier fait alterner le récit de cette vie mystérieuse avec des fragments de la sienne. Sur elle-même, elle ne semble rien inventer (sinon la coïncidence assez extraordinaire entre la rue Holyoke où elle aurait habité à Boston et le Holyoke Seminary fréquenté par Dickinson ?) ; elle relate ses déplacements, travail, recherche, achat d’une maison, à peine sa vie, ce n’est pas une autofiction. Sur Emily, il lui a bien fallu enrichir les quelques éléments connus de sa biographie, seule façon de nous faire entrer dans l’intimité de ses gestes et de ses pensées. Ce n’est pas pour autant une biographie romancée parce qu’elle n’enjolive rien, et exofiction ne nous mènerait pas plus loin parce qu’elle n’invente pas pour le plaisir d’inventer (comme l’a fait Christian Bobin dans La dame blanche où elle devient une « sainte ») : Fortier raconte pour cerner la poète au plus près, en la rendant très présente à la manière d’un personnage. Ne serait-ce que pour ces raisons, Les villes de papier est bel et bien pour moi un roman, avec des épisodes, comme l’a vu Alto, bien plus que l’essai qu’il est devenu en France. Mais plus importante que ces étiquettes est la liberté avec laquelle Dominique Fortier a pris les moyens à sa disposition – biographie, réflexions, autobiographie, inventions, prose poétique – pour nous montrer une écrivaine se rapprocher du réel par la voie des mots et devenir une « créature de papier » (p. 132).
Le contraste entre les deux femmes est saisissant. Fortier se livre très peu alors qu’elle met Dickinson à nu, laquelle n’est qu’élans, tensions et sensations pendant que l’auteure promène son bébé dans une poussette ou évoque calmement les fusions municipales. Ce déséquilibre peut laisser perplexe, si bien que les pages où elle passe au je autobiographique – une trentaine sur les deux cents du livre – apparaissent comme des parenthèses dans le récit. Je me suis parfois demandé en lisant si ces fragments autobiographiques étaient vraiment nécessaires. Puis j’ai bien été obligé de constater que le procédé est habile : il donne à la fois plus de réalité à l’évanescente Emily et une assise solide à l’imagination de Fortier. Qu’on pense à l’érable dans la cour de la poète et à celui devant la maison de l’auteure à Montréal ; au séjour à Boston, seule ville visitée par les deux femmes. Il y a un rare passage où la poète et la prosatrice finissent par se rejoindre, le récit et l’autobiographie par s’interpénétrer, quand l’auteure envisage d’aller voir la maison d’Amherst :
« Et si, au terme de la visite, plutôt que de suivre sagement le guide, je me tapissais sous un lit ou me glissais derrière une porte – et si je restais jusqu’au soir, attendant que tout le monde soit reparti pour sortir de ma cachette, aller à la fenêtre, dans l’obscurité, et observer les restes du jardin figés par les premiers gels d’automne –, alors j’aurais la nuit pour moi toute seule.
Qu’est-ce qu’elle attend, cette Emily de trente, quarante, cinquante ans ? L’amour ? Dieu ? Un geai bleu ? Un lecteur qui enfin lira ses poèmes comme elle rêverait qu’ils soient entendus ? Ou simplement la mort, qu’elle repousse chaque jour en écrivant quelques mots de plus, fragiles incantations qui font dans l’obscurité de toutes petites lumières – des lucioles. »
Ces parenthèses permettent aussi à Fortier de relancer chaque fois sa quête, la raison pour laquelle elle a écrit ce livre : voir si le meilleur endroit au monde où l’écrivaine qu’elle est pourrait enfin jeter l’ancre ne serait pas dans une ville qui n’existe pas mais où l’on vit, une ville de papier.
On ne sait pas si l’idée de publier inspirait à Dickinson de l’indifférence ou si elle aurait craint d’y perdre son impressionnante indépendance littéraire, sa véritable chambre, qui la protégeait autant des lieux communs que des règles strictes de la syntaxe, où elle pouvait écrire de la poésie vivante et non des platitudes. Mais qui sait si avec le temps elle n’a pas eu le goût de publier (Edmund Wilson était d’avis qu’avec un peu d’encouragement elle l’aurait fait). Pensons aux quarante fameux cahiers de ses poèmes qu’elle a soigneusement confectionnés à la main bien des années avant de mourir. Sur cette question, Fortier rappelle qu’écrire et publier sont deux choses distinctes, et elle a raison de s’en tenir aux faits : Dickinson n’a à peu près rien publié de son vivant. Et même si elle l’avait fait, publier serait venu par surcroît.
Si le récit donne parfois l’impression de piétiner, il faut concéder qu’il se veut une lente rêverie méditative et que Fortier, tout en suivant les étapes de sa vie, cherche d’abord et avant tout à saisir Emily Dickinson en quelque sorte hors du temps. Sa poésie aussi a évolué, et là encore si le livre cite peu (l’édition Grasset y aurait en partie remédié) c’est que son but n’est pas d’éclairer l’œuvre mais de découvrir la poète de l’intérieur. On la voit à un endroit en train d’écrire. Après tout, imaginer un poème, l’écrire sur un bout de papier, le retravailler, le ranger, puis le reprendre ont occupé son quotidien pendant des années (366 poèmes dans la seule année 1862). Il est important de rappeler que ses poèmes, qui peuvent être difficiles à comprendre, partent dans toutes les directions, pas seulement vers le jardin : certains ont la légèreté de papillons ou sont animés de traits d’humour, mais beaucoup regardent l’au-delà, plusieurs ont une dimension métaphysique, d’autres sombres ont des accents baudelairiens (« Pour être Hantée – nul besoin de Chambre – / Nul besoin de Maison – / Le Cerveau a des Couloirs – pires / Qu’un Lieu Matériel – … », trad. Claire Malroux). La poète réfugiée dans sa chambre y laisse passer toute la gamme de ses émotions et de ses réflexions. Quand elle tombe amoureuse, ce sera un échange de lettres, les siennes couchées dans le même style elliptique et nerveux. Son intimité la comblait, toute à sa poésie et à ses textes. Sa famille ? « Ces étrangers. » Elle aurait bien aimé être un merle. Misanthrope ? Possible.
Les villes de papier a un air de parenté frappant avec Un poème au milieu du bruit. C’est comme si la poésie était affamée de silence et de solitude. Mais Dominique Fortier étend le diagnostic au-delà de la poésie, puisque sa méditation sur la vie d’Emily Dickinson tourne autour du doux fantasme de n’être que plume qui écrit. Alors qu’aujourd’hui la moindre publication déclenche un tintamarre médiatique, on voit bien que son livre, sous ses dehors tranquilles, a quelque chose d’une provocation.

© Music Box Films
*
Carl Bergeron, La grande Marie ou le luxe de sainteté
Si Christian Bobin voulait à tout prix raconter la vie d’une « sainte », il aurait dû oublier Emily Dickinson et s’intéresser à Marie de l’Incarnation. Il a peut-être été refroidi par le fait que la seconde a suivi un parcours inverse de la première, puisqu’elle s’est d’abord cloîtrée, puis décloîtrée en laissant tout derrière elle pour traverser l’Atlantique vers des contrées inconnues et hostiles, et aider à bâtir la Nouvelle-France. Bergeron ne ménage pas les mots pour souligner sa grandeur spirituelle et littéraire.
Carl Bergeron est à peine visible dans la vie littéraire, presque tenu à l’écart dirait-on parfois. Quelques inconditionnels avaient encensé Voir le monde avec un chapeau, qui avait autrement donné lieu à d’étranges critiques, dont l’une saugrenue dans la revue Liberté lui tricotait un bonnet d’âne avant de lui taper dessus à grands coups de Gramsci. Avec son Épreuve que doivent affronter les Québécois pour surmonter leur embarras linguistique, quelques désagréables portraits de femmes, des jugements impatients sur un tas de sujets comme le jogging, le printemps érable ou les employés de bureau – de toute évidence il ne cherchait pas la gloire. Ici et là on observait aussi des décalages abrupts de ton, le texte tombait d’un coup dans un autre registre, quand par exemple il abandonnait sa fresque historique et urbaine pour s’adresser émotivement à ses parents. Mais Bergeron abordait tout avec une franchise rare, donnait de magnifiques pages sur la honte, sur la littérature, sur la ville et les gens qu’il croisait, comme cette vieille bossue qu’il avait aperçue un soir en train de fouiller dans les vidanges et dont le visage « ruisselant de lumière » dans l’obscurité l’avait ébloui (on était proche de Léon Bloy). Qui sait si ce n’est pas cette pauvre femme démunie qui l’a mené plus tard à Marie de l’Incarnation, car lorsqu’il a plongé dans sa correspondance, il semble avoir éprouvé un émerveillement aussi fort.
Bergeron fait remonter la naissance du peuple québécois non pas à la rébellion des Patriotes au 19e siècle, comme Ferron et tant d’autres, mais aux années du 17e siècle où a été fondée la Nouvelle-France, pays
« où il n’y a pas plus d’assurance qu’aux feuilles des arbres quand elles sont agitées du vent »
écrivait l’ursuline, et qui a pourtant « déjoué tous les calculs », écrit-il. Il voit Marie de l’Incarnation y briller de tous ses feux autant par son action et sa vocation mystique que par son envergure littéraire. Comme elle a engagé toute sa vie dans ce pays sauvage et uni son âme à son destin, soutient Bergeron, sa place est au cœur du « patrimoine spirituel » qu’il faut préserver si l’on veut résister à l’« amnésie numérique » si menaçante aujourd’hui. Son livre cherche donc à donner à Marie une place centrale dans notre culture.
On y découvre une femme extraordinaire et attachante. Sa réaction à l’incendie qui détruit le monastère des ursulines en plein hiver est mémorable : le Ciel lui permet ainsi de « se défaire “des mille petites choses de néant” qui lui encombrent l’âme » (p. 40). Caractère de fer et bouclier amoureux, au sens mystique, note Bergeron, dépeignant une femme à la fois éprise d’infini et les pieds sur terre, faite d’abnégation et d’une générosité débarrassée de tout orgueil. Le personnage en impose. Rien que par sa ténacité, la société québécoise lui doit énormément selon Bergeron.
Marie Guyart est bien sûr loin d’avoir été la seule à faire face aux conditions difficiles de la Nouvelle-France, mais pour Bergeron elle dépasse les autres figures connues, y compris Champlain, par son étoffe spirituelle. Ce point est capital dans sa vision des choses parce que pour lui le destin du Québec n’a pas qu’une dimension politique, mais aussi spirituelle, et c’est l’héritage de cette richesse spirituelle qu’il nous invite à mettre à profit. Sa position n’est vraiment pas dans l’air du temps, mais comme il semble très à l’aise loin des idées reçues j’ai l’impression que cela lui est parfaitement égal.
Il examine la question spirituelle sous plusieurs angles, qui ne sont pas toujours convaincants. Il y a de la pose chez lui quand il rapproche le mystique et le libertin, qu’il voit non comme des martyrs souffrant de pathologies mais comme des gens heureux (Philippe Sollers ici a remplacé Léon Bloy). Même s’il nous convainc que Marie était une femme normale, « gaie et pleine d’esprit » et non une folle comme on l’a parfois dépeinte, on voit passer en filigrane un amalgame discutable entre joie (« vivre dans l’amour de Dieu ») et plaisir. Il est vrai que déjà dans Voir le monde avec un chapeau, flirts et élans spirituels allaient de pair.
Son rapprochement entre mysticisme et poésie est beaucoup plus intéressant. Le poète et le mystique parlent le même langage, orienté vers l’aventure intérieure, le mystère comme voie d’accès à la connaissance. Ils cultivent un « esprit de vérité » en nette opposition à l’« esprit de ressentiment » qui veut tout désacraliser. À la fin, sur de longues pages écrites dans le style peut-être un peu trop onctueux d’une prédication, il pourfend la vision étriquée de la vie et de l’histoire qui règne dans le milieu intellectuel, le refus de regarder vers le haut, vers la grandeur et la beauté. Son plaidoyer exprime par moments une exaspération poignante devant l’écrasement de l’être par l’avoir, qui a tout avalé jusqu’à notre âme, dans un monde interdit de tout élan vers quelque chose d’infini.
Ce rapprochement ouvre l’autre grand volet de son entreprise : Marie l’écrivaine. Bergeron la considère comme un génie. « N’est-ce pas délicieux », demande-t-il, après nous avoir fait admirer une page de sa correspondance. Les passages qu’il cite sont en effet un délice à lire : qualité supérieure du texte, intelligence, vivacité d’esprit empreinte de douceur, animée par une bonté à toute épreuve. Les quatre siècles qui la séparent de nous n’ont pas fait vieillir sa prose étincelante. Mais il va très loin quand il prédit que le 21e siècle la rendra « plus vibrante à notre conscience qu’un Proust, un Céline ou un Joyce ». Admettons que les paris (faciles) sont ouverts, mais la récolte qu’il nous offre – quelques paragraphes, des citations éparses, des fragments – est trop maigrichonne pour y voir clair, ou nous imprégner de sa stature.
C’est peut-être là une limite de ce petit livre, une soixantaine de pages réparties entre quatre courts chapitres quelque peu décousus. Est-ce pour mieux les faire tenir ensemble que Bergeron s’adresse à nous tout le long à la deuxième personne (« Ami lecteur,… ») ? Ce tutoiement est sans doute là aussi pour rappeler que « l’Histoire n’existe que pour se refléter dans un Je, un Tu ou un Nous ». Toujours est-il qu’après avoir salué Marie dans les deux premières pages, il saute à une chronologie rapide du Québec et résume les grands débats sur le destin national des années 1950 à aujourd’hui. Arrivée de la sainte au Canada dans le 2e chapitre, dans le troisième la force de sa foi dans le pays incertain. Dans le quatrième, elle est déjà disparue. Sinon en figurante, pour céder sa place à Gaston Miron, comme si elle n’était pas le sujet véritable du livre. Et c’est compréhensible parce que le but principal de Bergeron est d’ancrer aussi bien le passé du Québec que son avenir dans la littérature. Il avance d’ailleurs avec un certain panache que tôt ou tard les écrivains, par leur singularité, feront revenir dans la société les valeurs qu’incarne Marie.
On reste néanmoins avec l’impression que La grande Marie ne fait qu’effleurer – quoique passionnément – son sujet. Il est bien possible que Marie de l’Incarnation doive être intégrée au socle de notre culture, mais je vois cet essai d’abord comme une invitation à la redécouvrir et le prélude à une suite qui explorerait à fond son œuvre. En attendant, avec le peu de place qu’elle a toujours occupée dans le paysage littéraire français, malgré l’admiration que lui portait Bossuet, il est clair que Bergeron a démontré qu’elle appartient à ce côté-ci de l’Atlantique.

♠
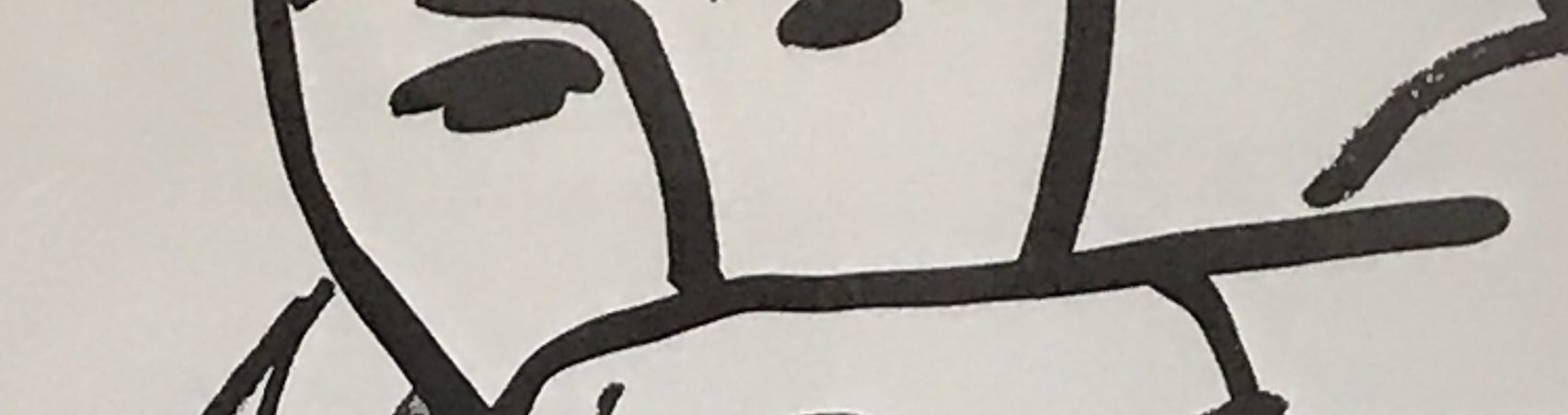

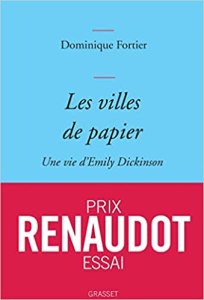
C’est toujours avec plaisir que je me plonge dans ces « Quartiers littéraires ». La critique y est vraiment de la critique. Desrosiers présente les ouvrages qu’il commente avec objectivité et sans s’empêcher de vraiment les commenter, c’est-à-dire d’exprimer ses désaccords autant que ses accords. Ses réserves donnent le goût de lire les livres qu’il commente. Elles piquent la curiosité autant que ne le feraient des éloges. Elles ouvrent au dialogue. C’est que lui-même dialogue avec les livres qu’il lit. Bref, aucune complaisance dans son ouverture à autrui.
J’ai lu le livre d’Antoine Boisclair et l’ai beaucoup aimé. Quand j’avance que le lecteur de « Quartiers littéraires » parle avec objectivité, je me base sur ma propre lecture. Je constate que le compte-rendu du critique est fidèle au contenu de l’ouvrage qu’il commente. « Un poème au milieu du bruit » est un ouvrage remarquable. On peut voir en Boisclair un émule de Brault et de Melançon, poètes admirables, dont la sobriété n’est pas la moindre qualité. Sans parler de leur érudition et de leur savoir-faire. Enfin, je dis ça un peu rapidement, mais assurément Boisclair est une figure particulièrement intéressante de notre paysage culturel.
Je n’ai pas lu l’ouvrage de Dominique Fortier, mais le texte de Desrosiers me donne envie de le lire plus tôt que je ne l’avais prévu. Desrosiers écrit que « plusieurs poèmes de Dickinson] ont une dimension métaphysique, [que] d’autres sombres ont des accents baudelairiens (“Pour être Hantée — nul besoin de Chambre —/ Nul besoin de Maison —/ Le Cerveau a des Couloirs – pires/ Qu’un Lieu Matériel —…”, trad. Claire Malroux). Bref, ne serait-ce que pour lire de tels vers, je veux rouvrir ses recueils et mieux lire la poète.
Quant au livre de Bergeron, là aussi, il faut remercier le critique de nous le présenter. Qu’il juge que ceci ou cela ne fait pas son affaire, alors qu’autre chose lui paraît tout à fait intéressant, voilà, je me répète, une manière bien libre de lire et de commenter. Cela suscite chez moi beaucoup de respect. Bravo !
J’aimeAimé par 1 personne
Merci beaucoup pour cet article, attentif aux détails et aux propos général de mon essai. Votre lecture témoigne d’une grande sensibilité et j’en suis très reconnaissant. Henri Michaux ? J’avais pensé commenté un de ses poèmes… Ce sera peut-être pour un autre livre !
Bien cordialement,
Antoine Boisclair (désormais abonné à votre blog).
J’aimeAimé par 1 personne
«au propos» et «commenter», bien entendu. Désolé pour les coquilles: mon message est parti trop vite…
J’aimeJ’aime