Jérusalem, mai 2018
Le mur des Lamentations nous est familier depuis longtemps, mais quand sa masse de pierres surgit devant nos yeux au bout d’un dédale de ruelles, on est saisi par le bourdonnement des prières qui montent tout le long de la paroi – au lieu de tomber comme celles que déversent les haut-parleurs des mosquées. La voix d’un imam est tranchante, ses silences sont sans réplique. Mais les haredim qui chuchotent leurs prières au pied du mur colossal, ou qui les martèlent dans le souterrain du côté gauche, prient en solitaire. C’est comme s’ils appartenaient encore à la diaspora. Arrivés bien avant la création de l’État, ils ont conservé la méfiance traditionnelle des juifs à l’égard de l’autorité. Ce n’est pas étonnant de les voir manifester parfois aux côtés des Palestiniens contre les implantations dans les territoires occupés.
La prière finie, ils s’enfoncent tête haute dans la cohue qui a envahi le souk arabe pour faire ses emplettes en cette fin de journée de ramadan. On se demande comment ces étroits couloirs bordés d’échoppes parviennent à absorber une telle marée humaine. Deux ou trois fois il n’y a plus moyen d’avancer, les marchands crient au-dessus des têtes « Come! Come and see! », le bruit est à la limite du supportable. À certains carrefours, des grappes de policiers derrière des barrières de métal se tiennent sur le qui-vive. On dirait que la tension va dégénérer à côté des montagnes de fruits, d’amandes, d’épices, de friandises, de pains, des poteries sur les étals, des panneaux de foulards colorés. Les haredim se frayent un passage sans rien regarder, sortent de la vieille ville par la porte de Damas, en ignorant comme presque tout le monde les quelques femmes en niqab qui tendent la main, assises par terre : « Shekels, shekels please! », et retournent dans leur quartier de l’autre côté de la rue.
Mea Shearim pourrait servir de décor à un film sur les ghettos polonais du 19e siècle. Du linge pend aux fenêtres, des monceaux de déchets traînent aux intersections. Le dénuement y est non seulement volontaire mais ostentatoire. Pas de voiture, pas de musique, que le bruit feutré des conversations. L’après-midi de sabbat où nous y entrons, ma fille et moi, le plus discrètement possible, manches longues et pantalon, nous sommes les seuls touristes. Les hommes portent manteau noir et toque de fourrure, les quelques femmes que nous croisons sont chics, l’une, vêtue d’une très belle robe de taffetas rose, pousse calmement un landau auquel s’accrochent une ribambelle d’enfants qui nous observent avec une curiosité amusée. Elle nous salue d’un shalom.

*
Pour aller voir l’autre mur, nous prenons un autocar arabe vers la Cisjordanie à la gare de Jérusalem-Est. Sur une banquette, s’occupant de ses deux bambins, une jeune Palestinienne dont le voile noir, très ajusté autour de son visage, ne fait que mettre en valeur la géométrie nette de ses traits, comme s’il ne cachait rien. Une heure plus tard, nous voici dans la basilique de la Nativité à Bethléem, après avoir traversé la vieille ville avec une dizaine de touristes, de France, de Croatie, de Grèce. Même chose qu’hier à la basilique du Saint-Sépulcre à Jérusalem : affluence énorme de visiteurs, beaucoup de circulation, guides qui tirent des groupes dans toutes les directions et des queues interminables, aujourd’hui devant la Grotte de la Nativité, hier devant l’autel de la Crucifixion, devant la Pierre de l’Onction, devant le tombeau du Christ. L’endroit où il est né, l’endroit où on peut toucher le rocher où il a été crucifié en se baissant dans un trou aménagé sous un autel, l’endroit où son corps a été lavé, l’endroit où il est enterré. Visitant la Palestine en 1850, Flaubert n’en revenait pas de toutes ces stations : « Quelle rage de tout préciser ! ils voudraient tenir Dieu dans leurs mains. » Reste que malgré l’atmosphère d’animation qui règne aux deux sites, de nombreux pèlerins de partout viennent ici avec une réelle ferveur. On en voit d’émus, certains en larmes ; devant un autel au Saint-Sépulcre une jeune femme se tenait agenouillée, les bras levés vers le ciel, en extase.

Mais nous sommes saturés. Nous allons flâner à la terrasse d’un restaurant au square Manger. Un chauffeur de taxi privé nous a vite repérés. Il nous offre de nous promener pendant quelques heures autour de la ville, va et vient entre plusieurs clients, fait des gammes sur les prix. On finit par céder. On se fait d’abord conduire à la butte d’Hérodion dont Hérode le Grand, qui ne lésinait pas sur la main-d’œuvre, a fait creuser le sommet un peu comme le cratère d’un volcan, pour y aménager palais et théâtre, invisibles de l’extérieur. Nous la gravissons à pied. Manil, notre chauffeur, nous attend en bas, le site, situé en zone C, lui étant interdit (la Cisjordanie est divisée de façon compliquée, et très désavantageuse pour les Palestiniens, en trois zones : A contrôlée par la Palestine, B sous contrôle civil palestinien et contrôle militaire israélien, C contrôlée par Israël). Plus tard, le long d’une route, il ralentit mais à peine, par prudence, pour nous montrer d’un doigt rageur une colonie israélienne sur le dos d’une colline : une centaine de maisons aux jolis toits rouges, blotties les unes contre les autres, encerclées par une muraille et surveillées par des soldats au sommet d’une tour. Cela fait maintenant quinze ans que Manil, cinq enfants, n’a pu mettre les pieds à Jérusalem. Mais comme beaucoup d’autres il a pu y faire soigner ses enfants, entreprise toujours hasardeuse comme le savent les lecteurs du roman de David Grossman, Une femme fuyant l’annonce, qui ont vu Ora amener secrètement, une nuit, un enfant palestinien très malade dans un hôpital de Tel Aviv.
Nous roulons sur les routes cahoteuses des zones A et B. Soudain l’horizon est bouché : juste à côté de nous, la barrière de séparation. Huit mètres de haut. Sa surface est tellement lisse qu’elle semble fraîche peinte. Mais plus loin, au cœur de Bethléem, elle est d’une laideur repoussante. Elle ne fait rien pour soulager une ville pauvre, dont le centre n’a pas grand-chose pour lui, saletés partout, devantures de magasin délabrées, coups de klaxon continuels, taxis en maraude agressive, vieux compresseurs de clim accrochés sans harmonie aux murs des bâtiments. Banksy a aménagé l’an dernier à quatre ou cinq mètres du mur – avec la Montréalaise Dominique Pétrin – le Walled Off Hotel, qui offre des dortoirs bon marché et des chambres extravagantes à 900 $ la nuitée, conçues pour offrir « la pire vue que l’on puisse avoir d’un hôtel ». Sous ses pointes en saillie intimidantes, le mur est une orgie de graffitis, de dessins au pochoir et d’accusations à peine allégées par le slogan Make Hummus Not Walls répété partout et les quelques récits pacifiques. Une Palestinienne y raconte qu’à Noël son père s’amène à la frontière de Jérusalem. Le soldat : Quel est ton nom de famille ? – Lama. – Ton nom de famille ! – Lama. Le soldat durcit le ton, commence à s’impatienter, repose la question. L’autre répond toujours Lama. Des gens commencent à pleurer. Le commandant du checkpoint arrive en courant. Quel est ton nom de famille ? Lama. Il se rappelle tout à coup que le mot arabe lama veut dire pourquoi en hébreu. « N’était-ce pas la meilleure réponse à donner à un checkpoint ? » conclut sa fille.

Notre promenade se termine sur une prise de bec avec Manil – plus ou moins surprenante après la visite qu’il nous a imposée dans une boutique tenue par des gens qu’ils connaissaient et où nous avons très peu acheté. Il me demande le double du prix convenu selon nous. Il se tourne vers nous le visage en feu, se met à m’engueuler, interdit à ma fille de participer à la discussion. ‘Twas 170 shekels. – No 340! You Canadians, I will remember! Plus moyen de parler. Après conciliabule, on laisse 250 shekels sur le siège avant et il disparaît. C’est un pro : il a sûrement gagné.
Au retour, sur l’autoroute vers Jérusalem, l’autocar s’arrête à ce qui ressemble à un poste de péage. Mais le chauffeur indique aux moins de 45 ans de sortir et d’attendre en ligne dehors. On est au fameux checkpoint 300, que franchissent chaque matin des milliers de Palestiniens qui travaillent en Israël. Plus un mot dans le bus. Une soldate de 20 ou 21 ans apparaît en avant. Elle avance lentement dans l’allée avec, collé à son dos, le doigt sur la gâchette d’une kalachnikov, un ado tête rasée, boutonneux, 18 ans maximum, qui a l’air d’avoir grandi trop vite. La fille, longs cheveux noirs, ne croise les regards de personne. Ne parle pas. N’a aucune expression faciale. Examine les passeports un à un, presque immobile. Puis ils sortent par la porte arrière. Pendant quelques minutes, l’atmosphère reste chargée de l’amer silence qu’ils ont laissé dans leur sillage. Les autres rembarquent, silencieux aussi. Ce n’est qu’une routine, on le sait bien. Mais la sensation d’être à leur merci est glaçante.
*
Le lendemain matin, à 7 heures et demie, nous empruntons la passerelle réservée aux non-musulmans qui veulent accéder à l’esplanade des Mosquées (apparemment ce nom n’existe qu’en français, dans les autres langues on dit mont du Temple ou Haram al-Sharif, « noble sanctuaire »). Une tranquillité incroyable règne dans cet immense jardin, avec ses fontaines, ses arches et ses allées ombragées. Mais j’ai à peine fait quelques pas sans réfléchir vers la mosquée al-Aqsa, à droite en entrant, qu’un surveillant me crie de faire demi-tour : interdit aux infidèles. Vers la gauche, au centre, comme un puissant aimant mais qui exercerait son attraction lentement, le dôme du Rocher (le dôme abrite le rocher). Le but des architectes arabes était de concurrencer la rotonde de la basilique du Saint-Sépulcre qu’on aperçoit à quelques centaines de mètres dans la vieille ville : ma coupole est plus belle que la tienne. Ils ont réussi.
Assis au premier palier, je suis en train de contempler en contre-plongée les faïences bleues du Dôme quand passe devant moi un homme grand et mince, dans la soixantaine, en longue robe blanche du ramadan. Il m’observe un peu, ralentit le pas et s’approche. C’est un enseignant du secondaire à Hébron – lieu saint des trois grandes religions, le pire foyer de violence de toute la Cisjordanie, avec des colonies au sein même de la ville. En 1929, des Arabes massacrent soixante-sept juifs. En 1994, un extrémiste juif, célébré depuis comme un héros par des fanatiques, assassine vingt-neuf Palestiniens en train de prier. Aujourd’hui, dans la vieille ville, des grillages au-dessus des petites rues protègent les boutiques palestiniennes des ordures et des projectiles de toutes sortes lancés par les colons qui vivent aux étages supérieurs. Mohammed a fait sa part pour la revanche des berceaux : il a treize enfants. S’il a pu venir sur l’esplanade, c’est grâce à son âge. Ses aînés, autour de 30 ans, l’un architecte, l’autre ingénieur, les deux au chômage, n’auraient jamais pu passer. L’une de ses filles fait sa médecine dans une université palestinienne : cours en anglais, 4 000 $ par trimestre ; il en rit. Il a l’air moins triste que désabusé. Il se moque avec dédain des restrictions d’eau ridicules, voire sadiques, imposées par Israël. Pour lui, Jérusalem a tour à tour été occupée au fil des siècles par tous les religieux et non-religieux possible : rien n’est figé. Il nous invite à venir chez lui. Mais nous quittons la ville dans trente-six heures.
Déjeuner dans une boulangerie de la rue Jaffa à midi. Dans la file d’attente, un jeune soldat attend son latté, mitraillette en bandoulière comme si de rien n’était. Plus tard, au grand marché de Mahane Yehuda, au milieu des pyramides d’olives, des cafés, des bars à bière, de jeunes militaires, gars et filles, ont tombé leur uniforme après leur journée de travail et enfilé jeans et t-shirt, en gardant nonchalamment à l’épaule leur fusil-mitrailleur comme on porte un sac de ville.

Musée d’Israël. De l’autre côté de la rue, le gros bloc de la Knesset. Dans les jardins du musée, maquette géante du Second Temple, à quelques enjambées d’une imposante sculpture de Henry Moore. L’intérieur grandiose, rempli de dons de juifs du monde entier (notamment nos Bronfman, dont nous verrons le nom au fronton d’édifices à Tel Aviv et à Haïfa). Collections d’archéologie époustouflantes avec des figurines vieilles de plusieurs millénaires. Dans le Sanctuaire du Livre, où personne n’ose élever la voix, les fameux manuscrits de la mer Morte découverts dans une jarre par un berger bédouin. Plusieurs groupes de touristes américains, certains regroupés par confession, dociles, plutôt amorphes, mais c’est vrai qu’il fait extrêmement chaud. Beaucoup de Brésiliens aussi, en groupes nombreux, très réveillés, moins disciplinés, tous vêtus d’un t-shirt jaune et bleu avec casquette assortie, certains tenant haut un fanion, assorti, pour assurer la cohésion.

*
Massada
Traversée de la Cisjordanie d’ouest en est, sur une autoroute israélienne, pour aller visiter Massada. C’est un énorme plateau juché à 450 mètres, une fois et demie la hauteur des plus hautes falaises de Forillon en Gaspésie. La vue sur la mer Morte d’un côté et les bosses du désert de Judée de l’autre est à couper le souffle. Hérode y avait érigé une place forte avec grand luxe : deux palais, salle de divertissement, bains, citernes, entrepôts. Trace noire de l’Histoire : À la chute de Jérusalem en 70, neuf cents zélotes (juifs) refusant la loi romaine se réfugient sur le plateau avec femmes et enfants. Quand les légions romaines réussissent à pénétrer dans la place après un siège de trois ans, ils se divisent en groupes de dix, chargent une personne dans chaque groupe de tuer les neuf autres, puis de se suicider. Plutôt mourir que de devenir esclaves. C’est encore, ou déjà, le refus de l’autorité.
Après la visite, à peine sommes-nous embarqués dans l’autocar que le chauffeur perçoit notre accent et passe au français. Il nous suggère d’arrêter à la plage d’Ein Gedi, à la hauteur de l’oasis, pour aller flotter sur les cristaux de la mer Morte avant de rentrer à Jérusalem. Toutes les autres plages viennent d’être fermées pour la journée à cause de la température extrême. Pour nous simplifier la vie, il ne poinçonne pas nos billets. Il a envie de bavarder. Il raconte en français qu’envoyé sur le front du Sinaï pendant l’affreuse guerre du Kippour (1973), il a traversé en blindé le canal de Suez dans des conditions épouvantables, sous les ordres de son commandant – le général Sharon. Camarades blessés, torturés ou tués par les Égyptiens. Le seul mot de guerre lui donne envie de vomir. On ne peut que penser à l’épave qu’est devenu pendant cette même guerre le mari d’Ora, torturé par les Égyptiens – jusqu’à ses mamelons qui n’étaient plus à la même place. Notre chauffeur est dans la soixantaine avancée, c’est une seconde carrière ou peut-être un privilège offert aux militaires à la retraite. En Palestine, ils sont plus jeunes, c’est sans doute l’une des rares carrières possibles.
La chaleur reste écrasante, malgré les nuages pâles qui ont répandu comme une encre grise dans le ciel. Ils nous protègent un peu, mais nous cachent les montagnes de la Jordanie de l’autre côté. À la sortie de la plage, pas un chat à l’horizon. Sauf ce bonhomme bien ordinaire assis dans l’abri d’autocar en compagnie d’une femme en fin trentaine, l’Israélienne typique, l’air à la fois frondeur et engageant, le regard direct : « He’s my friend, not my husband! » lance-t-elle en riant quand nous arrivons près d’eux. Nous voici donc les quatre, seuls sur le bord de la route 90, à attendre. Après quelque temps, le bruit d’un moteur au loin. Mais c’est un sherout, ces fourgonnettes qui servent de taxi collectif. Il ralentit, s’arrête à notre hauteur. La femme se lève et va discuter avec le chauffeur, mais il demande trop cher et elle l’envoie promener. Le bonhomme nous parle en hébreu, elle interprète. Il est déjà venu travailler avec d’autres ouvriers israéliens à Halifax quand il était jeune. Elle-même a essayé il y a peu d’entrer au Canada, mais les agents de la douane ont soupçonné (avec raison) qu’elle voulait travailler. Pendant qu’elle parle, le vieux sort d’un sac en plastique tout chiffonné une grosse grappe de raisins rouges, en détache les deux tiers et nous les met dans les mains sans dire un mot. On raconte notre mésaventure avec Manil : « Vous aviez peut-être tous les deux raison. Balagan qu’on appelle ça. Ça arrive souvent. »
L’écrivaine Zeruya Shalev a déjà décrit Jérusalem comme une ville grave et mélancolique. À la gare routière le lendemain, j’en garderais volontiers l’image d’une ville de province – si ce n’étaient de ses tramways ultra-modernes qui glissent en silence dans la rue Jaffa et de la concentration extraordinaire de langues qu’on y entend. Jusqu’au copte d’un jeune moine d’Alexandria qui, visiblement excité d’être ici, a voulu se faire photographier avec nous l’autre jour près du mur des Lamentations. Il nous avait chaleureusement remerciés en nous donnant ce qui semblait être des cartes de prières.
*
Tel Aviv
Venant de Jérusalem, c’est le choc. On se croirait projeté dans une grande capitale d’Europe, adoucie par des touches méditerranéennes. Des gratte-ciel dans tous les styles, espacés les uns des autres comme pour permettre à chacun de bien se faire voir : tours en vilebrequin, en forme de sablier, cylindres, d’autres imitant le tronc d’un palmier, style international, brutaliste, éclectique, ornements baroques ici et là. Autant la ville trois fois millénaire semble soudée à la croûte terrestre, autant ces tours élancées dégagent une impression de légèreté, comme si Tel Aviv n’était que de passage. La ville a été fondée pour échapper au poids de la tradition : mission accomplie, c’est une création moderne sans passé. On oublie facilement qu’il y a une centaine d’années l’endroit n’était qu’un désert de dunes au nord de Jaffa. Comme un décret ottoman obligeait les juifs à déménager chaque année, une poignée d’entre eux décidèrent de construire des maisons à l’extérieur de la ville. Nous y sommes.

Promenade sur le boulevard Rothschild, sorte de cours Mirabeau jalonné d’arbres majestueux. Des fauteuils poires aux couleurs vives sont éparpillés sur les pelouses publiques, bien encadrées par la limpide architecture Bauhaus, avec les balustrades arrondies de ses balcons et ses murs blancs, qui contrastent avec les bâtiments couleur sable de Jérusalem. Au bout de toutes ces rues : la mer, le soleil, les palmiers, des kilomètres de plage. Disons qu’on ne sent pas beaucoup l’autre monde ici. Les boîtes à livres et les nombreuses librairies poussent la religion à l’écart. Les drapeaux de la fierté gaie flottent aux fenêtres, il y a une parade annuelle et un festival de films LGBTIQ+. Des segways roulent sur les promenades sinueuses des plages. Sur les boulevards, les terrasses débordent de monde. Shakshukas, couscous, petits pains au fromage sont servis du matin au soir, plats végés toujours offerts, quelques restaurants véganes. Autant d’insouciance est incroyable si peu loin de Gaza, à cinquante kilomètres au sud. En fait, la ville ne dort que pendant les 24 heures du sabbat, et encore, au grand dam des orthodoxes dont on entendra quelques-uns, très tard le vendredi soir, injurier des touristes attardés aux terrasses.
Nous louons transats et parasol sur la plage pour reprendre notre souffle. Mais inutile d’essayer d’oublier « la situation », ha-matsav, comme disent les Israéliens. Cinq fois dans l’après-midi, des hélicoptères militaires passent à grande vitesse au-dessus des plages. On aperçoit au large une corvette se diriger vers le sud. Un monsieur se promène discrètement entre les chaises et murmure sur le ton d’un profond reproche « Shabbat shalom ». Dans un joli lacis de ruelles en escalier du Vieux-Jaffa où nous avons déambulé, les mots Free Palestine ont été peints en noir sur le mur d’un passage. Un peu partout dans la ville, des panonceaux rouge et blanc indiquent les abris où se précipiter en cas d’alerte.
Juste au nord du Vieux-Jaffa, le quartier branché de Neve Tzedek. Dans la courbe d’une rue, empiétant sur la chaussée, une terrasse occupée par un immense groupe de jeunes juifs canadiens dans la vingtaine qui voyagent avec Birthright Israel (mouvement fondé en partie par les Bronfman).
Musée d’art de Tel Aviv. Beaucoup d’œuvres de la deuxième moitié du 20e siècle, et présentement exposition d’Avraham Ofek, l’un des artistes pluridisciplinaires les plus connus en Israël. Toiles empreintes de solitude. L’œuvre vedette de l’exposition montre un homme labourant seul sa terre ; elle s’intitule A Man without Land Is Not a Man, sentence reprise du Talmud et bien sûr ouverte aux interprétations. Le parcours d’Ofek est typique : il naît en Bulgarie en 1935, émigre en Israël à 14 ans, soit un an après la création de l’État, et s’installe avec sa famille dans un kibboutz. Dans un essai de 1994, Grossman, né dans les années 50, décrit la curieuse atmosphère qui régnait à l’époque de son enfance : « … There were young couples who confronted life with determined optimism, and Holocaust survivors who walked the streets like shadows and whom we children feared. »

Le musée projette le film The Clock de Christian Marclay, dans une salle où on peut entrer et sortir librement. C’est un collage de 24 heures qui montre en rafale de très courts extraits de films américains, britanniques et français depuis le début du cinéma, avec dans chaque séquence une indication de l’heure visible ou audible : sur une montre, sur une horloge ou dans une conversation. Le film est un exploit de montage. En plus, l’heure indiquée correspond exactement à l’heure où vous êtes en train de le regarder. Nous avons le temps de voir le bout entre 1 h 5 et 2 h, où passent Humphrey Bogart, Laurel et Hardy, Woody Allen, Marlene Dietrich, Marlon Brando, quelques plans de Godard. Puis un surveillant crie : CLOSED !
Le soir, en coupant à travers un quartier tranquille, nous tombons sur la petite terrasse d’un resto qui ne paye pas de mine, Big Heart, dans une rue plus ou moins bien éclairée, Rabbi Akiva. Étonnamment le menu de brochettes est trilingue non pas en hébreu-arabe-anglais, ou hébreu-anglais-russe comme dans le Vieux-Jaffa où certaines annonces sur des panneaux sont même unilingues russes, mais en hébreu-anglais-français. On se rend vite compte qu’aux tables autour de nous, les gens parlent français. Pas des touristes, visiblement des habitants du quartier. Îlot de juifs francophones au cœur de la ville.
Vendredi, vers 19 h, comme si le tocsin avait sonné, les rideaux de fer sont baissés devant tous les commerces, les transports en commun s’interrompent d’un coup. Sabbat, calme et silence. Mais notre dernière nuit à Tel Aviv est courte malgré tout, courtoisie des chats en rut du quartier qui en profitent pour lancer leur appel à l’Autre. Tôt le matin, on hèle un taxi dans la grande rue Allenby déserte, pour aller prendre à la gare un sherout vers Haïfa. Le chauffeur se moque : « Sherout? No sherout, it’s Saturday! ». Lui peut nous conduire à Haïfa, à cent kilomètres d’ici, pas de problème. On ne mord pas. À côté de la gare, fermée bien entendu comme tout le reste, attend la longue file des fourgonnettes jaunes prêtes à partir dans toutes les directions du pays. Pendant qu’on le paye, il ne nous jette pas un seul regard.
*
Haïfa, juin
Les petites villes indiquées sur la carte le long de la côte se révèlent de grosses agglomérations, avec des tours d’habitation en chantier des deux côtés de l’autoroute. La population du coin n’a pas l’air prête de « retourner d’où elle vient », comme le réclamaient des membres du Hamas en célébrant le 70e anniversaire de la Nakba il y a deux semaines. Le lendemain, en ville, seuls sont ouverts les restos de la Colonie allemande, le quartier central, qui n’a plus rien de germanique, sinon l’architecture sobre et nette des bâtiments sur la belle avenue Ben Gourion. On marche vers le quartier chrétien ; dimanche oblige tout est au ralenti. De ce pas vers le quartier arabe : celui-là un peu endormi à cause du ramadan. Haïfa est une ville compartimentée, mais avec des cloisons peu épaisses. C’est la seule ville d’Israël où en décembre on fête en même temps le ramadan, Noël et Hanouka. Qui sait si les laïcs de la place n’ont pas leur journée à eux.
Les Jardins Bahaïs, l’une des grandes attractions d’Israël, sont une merveille pour les yeux : 19 étages de terrasses en fleurs qui descendent devant la mer. Sur le site, la guide obligatoire, une Ukrainienne, nous explique que le bahaïsme voit l’humanité comme une grande nation encore adolescente, qui cessera de faire la guerre une fois adulte. La symétrie des jardins évoque l’égalité des religions, de tous les humains, des hommes et des femmes. Aucun prosélytisme, comme dans le judaïsme, pas même vis-à-vis de leurs propres enfants. Ce n’est peut-être qu’une façade, mais elle est bien ravalée. Les extraordinaires jardins font hélas ! de l’avenue Ben Gourion une plaque tournante pour les cars de touristes. On les voit libérer leurs voyageurs qui descendent sur le trottoir l’air perdu, se dégourdissent les jambes comme des girafons, puis font des blagues – et le site perd aussitôt de son charme. Ils ne voient pas les petits collants fort optimistes apposés sur les poteaux le long de l’avenue et qui prédisent en arabe le retour des Gazaouis : From Haifa To Gaza No Sound Is Louder Than The Sound Of Returning Back, selon la traduction que nous texte un ami, pendant que nous nous rafraîchissons à une terrasse avec une bière Taybeh de Ramallah.
Heureusement que de ses nombreuses collines, bien qu’épuisantes à marcher, la ville offre sur la baie, où sont toujours ancrés une trentaine de cargos, une vue qui enveloppe l’endroit d’un calme champêtre et donne le goût d’y rester. On voit la mer de presque partout. Tout va au ralenti.
Sur la plage, devant un quartier résidentiel, un homme qui a l’air très fatigué fouille lentement les poubelles une à une. Pas de chance, une femme est passée juste avant lui, en faisant le même trajet, et a rempli son sac. Une heure plus tard, une autre femme, plus soigneusement mise, et plus chanceuse, trouvera de quoi l’intéresser. Elle travaille avec un gant de caoutchouc.
Dimanche soir, concert de l’Orchestre philharmonique de Philadelphie avec Yannick Nézet-Séguin au Rappaport Hall. C’est une pure coïncidence pour nous. On a obtenu des billets de fond de salle ce matin. Concerto pour piano de Brahms avec Hélène Grimaud et 4e de Tchaïkovski. Vigueur de Nézet-Séguin, ses moments de recueillement dans le concerto où il écoute très concentré la pianiste, et la marée d’énergie qui monte à la fin. Leur tournée n’a pas été de tout repos. À Bruxelles, YNS a jeté sa baguette par terre et quitté la scène quand deux manifestantes se sont mises à crier en début de concert pour protester contre la visite de l’orchestre en Israël. Il s’est fait étriller dans les réseaux. Il n’y a pas de mots pour décrire l’ovation que le public d’Haïfa leur a réservée, à lui et à Hélène Grimaud, admirée localement pour avoir refusé de suivre le mouvement BDS.
*
Saint-Jean-d’Acre
Une journée entière dans la ville des croisés, Akko en hébreu, Akka en arabe. La restauration de la forteresse des Templiers est impressionnante. On y déambule dans une rue réelle du Moyen Âge en écoutant le bruit qu’il y avait à l’époque. Des colonnes de trois mètres de large soutiennent le plafond du gigantesque réfectoire des Hospitaliers qui soignaient les pèlerins venus en Terre sainte. Sur un corbeau, dans un coin, une fleur de lys sculptée vers le début du deuxième millénaire. On parcourt à pied les tunnels qui amenaient l’eau – et qui ont servi à prendre la poudre d’escampette quand les Mamelouks sont venus chasser les croisés dans les années 1200. On raconte que des religieuses cloîtrées se sont tailladé le visage pour enlever aux Mamelouks l’envie de les violer.

Quand la ville est cédée à l’État d’Israël en 1948, beaucoup d’Arabes s’enfuient, c’est la Nakba, mais un grand nombre restent. Les Arabes sont partout dans la ville aujourd’hui, au point que souvent on ne sait pas s’il faut dire toda ou choukran. Quand le serveur prévient : We don’t serve alcohol, on est fixé. Dans des gargotes bon marché, juifs ou Arabes ont visiblement du plaisir à préparer les sandwichs en mêlant au houmous assez de légumes – chou, carottes, courgettes, fenouil, oignons, aubergines – pour couvrir en quelques bouchées une semaine complète du guide alimentaire.
Pendant que le soleil plonge dans la Méditerranée, huit ou neuf hommes s’agenouillent pour prier sur la belle promenade le long de la mer. À la fin, ils se séparent en deux groupes en échangeant des poignées de mains, comme s’ils ne se connaissaient pas un quart d’heure plus tôt. C’est une ville paisible, du moins en apparence. Elle aussi est à faible distance des barils de poudre : Beyrouth à cent kilomètres à vol d’oiseau, et Damas au nord-est, au-delà du plateau du Golan. Cas d’appropriation culturelle tous azimuts, dans la partie turque du souk, nous achetons de la poterie arménienne d’un Grec orthodoxe qui aligne ses heures d’ouverture sur le ramadan.
*
Il fait nuit quand nous rentrons à Haïfa dans un train Bombardier presque vide. Le lendemain, deuxième arrêt au café Almakwa dans le quartier arabe. Le monsieur maigre assis à fumer dans un coin nous a reconnus et nous regarde avec le sourire. C’est Samir, père du proprio. Il a aménagé de ses mains tout ce qu’on voit, tables, comptoir, plancher. Il vient à peine de finir le travail le mois précédent, tout est nickel chrome. Comme le café comprend une petite buanderie au fond, Samir a fixé à un mur une essoreuse manuelle, au plafond une corde à linge avec des vêtements d’enfant, et arrondi le bout de quelques tables pour imiter des planches à repasser. Il s’est bien amusé. En partant, il nous indique un raccourci vers la gare ferroviaire. Le billet pour Tel Aviv, cent kilomètres, coûte seulement 27 shekels (10 dollars). On finit la soirée au comptoir bar de La Shuk sur la place Dizengoff, en plein cœur de la ville, après avoir patienté une bonne heure dans la file d’attente. Le lendemain matin, notre taxi s’immobilise au checkpoint à l’entrée de l’aéroport. Le temps pour une soldate de vérifier d’un coup d’œil que les téléphones des deux passagers sur la banquette arrière sont fermés. Il ne nous reste qu’à franchir à l’intérieur trois autres barrières de sécurité.

Avril 2019. Dans un article des Temps modernes, no de juillet-septembre 2018, Jérôme Segal se penche sur la popularité du véganisme en Israël. Les véganes refusent de manger toute nourriture issue de souffrances animales. Ils sont antispécistes (le racisme met une race au-dessus des autres, le spécisme met une espèce au-dessus des autres). C’est devenu en Israël le fer de lance de beaucoup d’activistes parce qu’il leur permet d’être efficaces socialement. Comparés à ceux d’autres pays, les véganes israéliens ne sont pas nécessairement intersectionnels (ceux qui se battent sur plusieurs fronts en même temps) : un bon nombre se dévouent exclusivement à la cause animale. Pourquoi en Israël ? Deux raisons, selon Segal. Pour beaucoup de juifs, c’est une façon de faire le lien avec les opprimés, c’est-à-dire avec leur propre histoire. Segal cite des essayistes qui ont montré les similitudes entres les abattoirs et les camps d’extermination nazis. « Pour les animaux, la vie est un éternel Treblinka », disait l’écrivain Isaac Bashevis Singer. Mais il y a une autre raison : le pinkwashing, comme l’a dénoncé le journal Haaretz (Marek Halter rappelle dans son Odyssée du peuple juif que « la critique extérieure de l’action du gouvernement israélien n’égalera jamais celle des médias locaux »). La droite israélienne aime mieux voir les jeunes s’engager pour les droits des animaux que pour ceux des Palestiniens. Même Benjamin Nétanyahou se fait maintenant préparer des repas véganes une journée par semaine. Les soldats de Tsahal ont le droit d’obtenir des bottes confectionnées sans cuir. La volonté de faire de Tel Aviv la capitale mondiale des LGBTIQ+, que j’ai mentionnés plus haut, obéit au même motif. Détourner l’attention, pour sauver l’image du pays.
♠
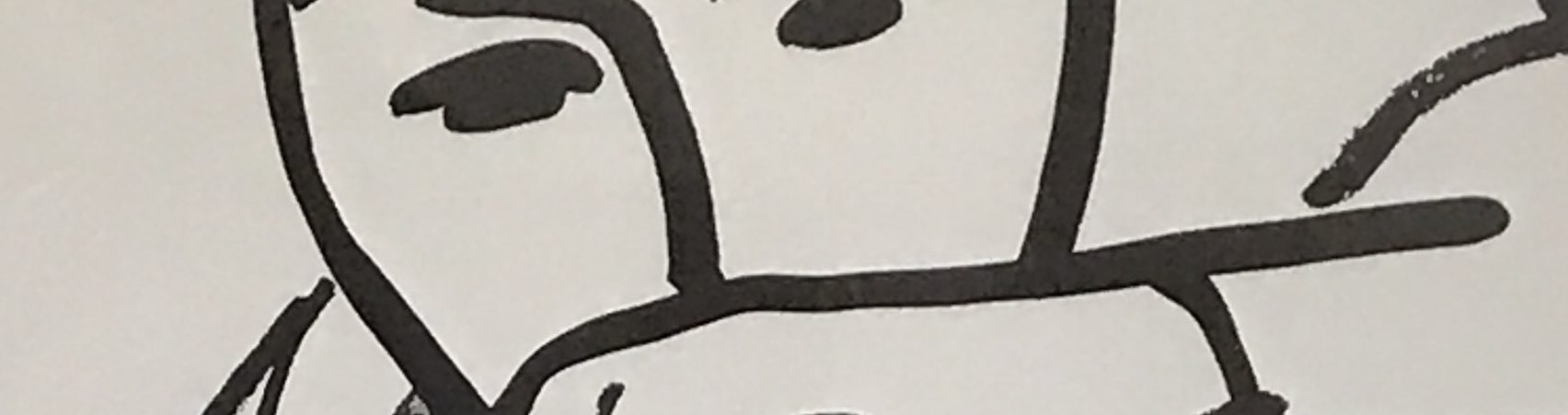



Merci pour ce beau voyage Jacques.
J’aimeAimé par 1 personne
Merci Nicole ! Je suis gâté de vous avoir comme lectrice.
J’aimeJ’aime
Un récit magnifique, que je vais m’empresser de recommander sur mon blog !
J’aimeAimé par 1 personne
Merci beaucoup, Gabriel. Vous me faites très plaisir.
J’aimeJ’aime
C’est par hasard que je suis tombée sur ton blog. Ton récit est passionnant et tellement bien écrit, c’est un délice de te lire. Merci Jacques!
J’aimeAimé par 1 personne
Merci, Lyne, de cet agréable commentaire. Comme mon site ne me rapporte rien, la qualité des lecteurs et lectrices est beaucoup plus importante que leur nombre 😊.
J’aimeJ’aime
Vous lire est comme un beau voyage !
Léon Ouaknine.
J’aimeAimé par 1 personne
Merci infiniment, Léon. De votre part, c’est comme un sceau d’authenticité !
J’aimeJ’aime