29 mars
Couru pendant une heure dans le brouillard le long des sous-bois près de chez moi. Quelques incursions sur des terrains broussailleux, où j’ai tapé des flaques d’eau, de la terre mouillée, des bouts de gravelle et brisé de minces feuilles de glace. Vu passer à travers le brouillard, lentes et silencieuses, cinq ou six automobiles. Le trafic n’est déjà plus le même. Hier, ma rue étroite occupée sur toute sa largeur par deux camions de livraison qui se sont croisés, et derrière eux la fourgonnette rouge et blanche de Postes Canada. La rue est à eux. J’arrive dans le quartier voisin. Quelques enfants chaudement habillés sur leurs tricycles, un facteur en gilet jaune l’air épuisé, une joggeuse dans un joli blouson rose matelassé. C’est comme si j’avais vu toutes les couleurs de l’arc-en-ciel malgré le couvercle gris au-dessus de nos têtes. Pour le contraste, un couple courait côte à côte vêtus du noir mortuaire à la mode. Et plus loin trois parapluies. Comme Descartes observant du haut de sa fenêtre les chapeaux en bas dans la rue, j’en ai savamment inféré qu’il y avait des gens en dessous, sans être sûr si c’étaient des hommes ou des femmes. Ils semblaient à l’abri de tous et de tout. Peut-être qu’ils le garderont quand le soleil reviendra. Je deviens ivre de cette tranquillité. Je ventile en tout confort. L’angoisse viendra en temps et lieu. Entendu aucun oiseau.
*
30 mars
Pluie battante. Je marche sans me presser. Aucun humain à l’horizon. Puis la pluie cesse, et cachés dans les arbres les mini-bipèdes, qui s’étaient mis en pause, recommencent à siffler.
*
2 avril
Le calme des rues me rappelle ces années où je sortais du bureau chaque jour au début de l’après-midi, beau temps mauvais temps. C’était la seule façon d’encaisser les heures qui restaient à faire. Je ne me suis jamais lassé des paysages désolants que je traversais. Il y avait bien les vieilles résidences cossues du quartier d’Argentine, dont les Anglais avaient trouvé le nom d’origine, Argenteuil, trop difficile à prononcer, mais elles se comptaient sur les doigts de la main. Il y avait aussi un bout de canal sur quelques centaines de mètres, mais son aménagement sévère par les urbanistes tranchait trop avec les alentours pour les faire oublier : vitrines sales de dépanneurs, maisons fatiguées, rues qui avaient l’air de ne pas savoir quoi faire, et des parkings plus ennuyants que le lundi matin le plus ennuyant. J’ai enduré parce qu’à cette heure-là les rues étaient tranquilles et que chaque fois un rien m’attendait, un arbuste arrosé de soleil ou un sentier oublié où l’herbe repoussait, et qu’il allait toujours en rester pour le lendemain.
Tout m’est remonté hier pendant que je courais le long du treillis d’un poste électrique, avec ses panonceaux intimidants, et que le gravier frais dégagé de l’hiver, tout propre, me jouait une petite musique sous les pieds. Je n’avais pas eu besoin d’avoir devant les yeux Montréal contemplé du haut de sa montagne ou le fleuve pour qui courrait sur une crête de Charlevoix, paysages grandioses devant lesquels on voit tout mais sans rien regarder, parce que ce tout est loin et indifférent. L’écrivaine américaine Nina MacLaughlin a raconté comment le roman Mon combat de Karl Ove Knausgaard, qu’elle était en train de lire, lui avait donné une bouffée d’euphorie pendant sept à dix secondes. Elle courait une fin d’après-midi en descendant une colline face au soleil couchant, écoutant les corneilles qui volaient au-dessus du champ à côté, quand soudain plus rien n’échappa à son regard. Avec sa manie du détail et le motif obsessif chez lui d’abolir la distance, Knausgaard l’avait amenée à regarder le monde de près. Citant le poème où à notre désir ardent de nous déconfiner Hölderlin oppose tout ce qu’il faut garder, elle rappelait que c’est à nous qu’il revient de donner un sens à ce banc de parc, à ce pigeon, à l’eau qui bout sur la cuisinière. Parmi ces points de contact avec la réalité figurent les paysages grands comme un mouchoir de poche qui occupent maintenant notre horizon à longueur de semaine, la bête rue où on habite, un chantier de construction abandonné dans le voisinage ou, comme à coté de chez moi, vide de gens et de voitures, le Royaume des témoins de Jéhovah que j’ai traversé en rentrant.

*
12 avril
Rues désertes. Pâques, la résurrection, la fête, mais sauf pour les perce-neiges tout le renouveau reste aplati sur le calendrier. Dès que le ciel tire un peu sur le gris, les gens préfèrent rester chez eux. Je comprendrais isolés dans la quiétude de leur chalet, avec des voisins assez éloignés pour les observer à travers des jumelles. Mais en ville, entre les quelques mètres carrés où ils sont confinés et un peu moins de soleil, ils choisissent encore leurs murs. J’avoue que je n’avais pas tellement envie de m’attarder non plus. Avec les rues vides et ce temps morne, le paysage urbain a quelque chose d’absurde, qui rappelle trop qu’il pourrait n’y avoir plus rien ; et j’ai couru tout le long au lieu de marcher-courir.
Cloîtrés à la maison, oui, mais le plus souvent avec les leurs, ou seuls avec d’intenses souvenirs ou un animal de compagnie. Sándor Márai raconte dans son journal qu’un jour pendant la guerre, peu avant qu’un obus aérien détruise sa bibliothèque de cinq mille livres à Budapest, il se retrouve confiné au milieu d’inconnus dans le sous-sol d’un hôtel. Il découvre alors un cercle de l’enfer oublié de Dante, « celui où l’on ne peut jamais être complètement seul ». Il se demande combien de temps il lui reste à vivre, ne sait pas qui est encore vivant dans sa famille, et pressent que son logement va disparaître d’une journée à l’autre. – « Et après ? » – Et ses livres ? – « Il me restera tous les livres de toutes les bibliothèques du monde. » – Ses petites possessions, ses vêtements, tout ce qu’il a amassé ? – « Mon âme et la langue hongroise me tiennent à cœur ; quelques livres, quelques contrées, quelques poèmes, en hongrois. Le reste m’importe peu. »

*
16 avril
Longue marche. Attiré par le ciel clair et la neige tombée durant la nuit. D’abord sur le boulevard, où circulaient beaucoup plus d’autos que de piétons, à cause du froid, puis raccourci à travers le parc et retour par le bord gazonné de la route qui le traverse. De la neige il ne restait déjà au sol qu’un tapis élimé. À l’exception d’un attroupement en forme de conciliabule à un endroit, très peu de monde, parfois pas une âme qui vive. Avec mon bâton, je devais avoir l’air du pèlerin qui poursuit son bonhomme de chemin vers Compostelle sur des sentiers déserts, parce qu’on ne l’a pas mis au courant que tout est fermé partout ou qu’il est devenu intérieurement inaccessible.
« Tout va bien ? », demande un officier russe à Márai, enfermé cette fois dans une petite villa sans électricité qu’il loue à l’extérieur de la capitale, avec sa femme et sa belle-sœur – qui avaient intérêt à se faire discrètes parce que les Hongrois entassaient par dizaines de milliers leurs compatriotes juifs dans des trains en partance pour la Pologne – et un jeune garçon charmant qui leur a été confié et qu’ils finiront par adopter. Quelques jours avant, une vingtaine de soldats russes sont entrés sans frapper et ont envahi la salle de séjour, la cuisine, les autres pièces, eux quatre confinés à une petite chambre. « Tout va bien », répond Márai. Tous les confinements sont peut-être contre nature, mais en comparaison du sien, le nôtre, du moins pour ceux qui sont logés convenablement, est un cinq-étoiles.
J’ai sursauté quand, près d’un chemin abandonné, trois dindes sauvages ont bondi d’un fourré en courant. Si je pense aux histoires truquées qu’on invente un peu partout, rien à craindre d’elles, trop farouches pour envahir une ville. Entre les branches des arbres, j’ai vu virevolter assez de petites têtes noires et blanches de mésanges pour commencer à douter aussi que les oiseaux soient en train de disparaître ; plutôt confinés par mimétisme ou sentant qu’il se passe quelque chose d’inhabituel. En haut un pic cognait sur un bouleau ou un faux-tremble, des écureuils se couraient après au ras du sol en criant. À la fin, dans les rues résidentielles, la neige s’est remise à tomber à plein ciel pendant quelques minutes.
*
1er mai
Conduit en voiture à une clinique médicale à l’autre bout de la ville, pour une déchirure musculaire causée par le jogging. Blessure qui m’a semblé irréelle sur le coup, comme si ce microbe nous avait mis à l’abri de tout le reste, alors que bien sûr les pépins viennent encore dans toutes les dimensions, mauvaises journées, querelles, déboires amoureux, violence, mille choses.
Ne m’étant déplacé depuis plusieurs semaines que dans un vague périmètre de tout ce qui se fait à pied à partir de la maison, j’ai eu l’impression de traverser une ville étrangère. Ce matin, appels de la clinique, d’abord pour m’annoncer que mon médecin me donnerait une consultation téléphonique après le week-end, puis une heure plus tard que s’étant ravisé il préférait qu’un de ses collègues me voie la journée même, avec son suivi par téléphone lundi. Ce n’est pas moi qui vais me plaindre du système de santé.
Dans le petit centre commercial où loge ma clinique, longue file d’attente qui s’étire devant plusieurs magasins. Ce sont les clients de la Société des alcools, séparés par un bon trois mètres les uns des autres et qu’elle laisse entrer au compte-goutte, si on peut dire. Leur solitude semble avoir eu besoin de plus d’hydratation que prévu. À l’intérieur de l’immeuble, un panneau stop en papier pend à une cordelette au-dessus d’un checkpoint improvisé, où une préposée masquée vous demande la raison de votre visite avant de vous laisser passer. La porte de la clinique elle-même placardée d’avertissements. La salle d’attente vide. Après quelques minutes, le jeune médecin frais diplômé m’a mis en route pour la réparation.
Au retour, tout m’est déjà trop familier, comme lorsqu’on revient en ville après les vacances, sinon pour la succession de commerces avec leurs panneaux FERMÉ. À l’arrêt au coin d’une rue, noté les gens assis aux tables de pique-nique d’un parc devant une grande affiche recommandant de ne pas utiliser les tables de pique-nique du parc.
*
4 mai
Rester à sa table ou aller se promener ? Houellebecq :
« Ce confinement me paraît l’occasion idéale de trancher une vieille querelle Flaubert-Nietzsche. Quelque part, Flaubert affirme qu’on ne pense et n’écrit bien qu’assis. Protestations et moqueries de Nietzsche, qui va jusqu’à le traiter de nihiliste : lui-même a conçu tous ses ouvrages en marchant, tout ce qui n’est pas conçu dans la marche est nul, d’ailleurs il a toujours été un danseur dionysiaque, etc. Peu suspect de sympathie exagérée pour Nietzsche, je dois cependant reconnaître qu’en l’occurrence, c’est plutôt lui qui a raison. Essayer d’écrire si l’on n’a pas la possibilité, dans la journée, de se livrer à plusieurs heures de marche à un rythme soutenu, est fortement à déconseiller : la tension nerveuse accumulée ne parvient pas à se dissoudre, les pensées et les images continuent de tourner douloureusement dans la pauvre tête de l’auteur, qui devient rapidement irritable, voire fou. »
Peu suspect de sympathie pour Nietzsche…, il ne met pas de temps en effet à le disqualifier. On ne marche pas pour faire apparaître des idées neuves, explique-t-il, mais pour « calmer les conflits induits par le choc des idées nées à la table de travail (et c’est là que Flaubert n’a pas absolument tort) ». Si bien que Nietzsche divague selon lui quand il prétend avoir élaboré ses conceptions philosophiques en marchant dans les prairies. « Sauf lorsqu’on écrit un guide touristique, les paysages traversés ont moins d’importance que le paysage intérieur. »
Les éditeurs pourront rouler là-dessus à l’automne pour faire mousser les livres sur le confinement. En attendant, on peut se demander si Flaubert, qui détestait se promener et qui a écrit quand même quelques bons livres, restait vraiment assis dans son fauteuil de chêne quand il hurlait ses phrases « dans le silence du cabinet, comme un énergumène ! » (lettre du 8 juillet 1876). Philip Roth avait trouvé un compromis : il écrivait debout et marchait dans son bureau, sans sortir. Truman Capote, lui, ne se levait même pas de son lit. Le confinement semble mieux fait pour les écrivains que pour les philosophes.
*

20 mai
Il neigeait l’autre jour à Chelsea quand je suis allé chercher des repas commandés la veille, de lourds flocons qui voilaient les bords de la route et même le restaurant où j’ai attendu l’heure et la minute convenues, masqué derrière le volant comme un voleur de banque dans un vieux film, avant d’entrer prendre mon butin : potage, deux entrées, plat et dessert. La saison avait décidé de remonter les éphémérides. On peut faire la même chose encabanés, tourner les pages à l’envers, ruminer sa vie, mais le risque est grand de rester embourbé. À l’autre extrême, les prophètes nés du confinement, immobiles à grands pas, nous vaticinent une révolution des mœurs, l’effondrement prochain de l’économie ou, par les journées de grande forme, la fin du monde. À quoi peut bien servir de prendre ses désirs pour des réalités quand la réalité occupe déjà toute la place. On dirait que la solitude les a diminués. Parce que cet arrêt forcé teste notre capacité à garder contact avec le présent. Je vois souvent rappeler le mot que Kafka a inscrit dans son journal le 2 août 1914, quand l’Allemagne a déclaré la guerre à la Russie, un mois après l’attentat de Sarajevo : « Après-midi piscine. » Ni ressassement ni divination, ce n’est pas le temps de régler des comptes ou de débiter des prédictions, mais de cultiver son cuir. Dans le roman d’Iván Repila que j’ai vu cité sur un site littéraire, deux jeunes garçons sont enfermés au fond d’un puits. Le Petit se tourne vers le Grand :
« Tu m’aimes ? demande le Petit
– Il va pleuvoir. »
Rêver n’est pas commode, ni le réveil très agréable, en temps de pandémie et les bonnes nouvelles sont vite périmées. Demain promenade.
*
26 mai
Je lis sur le balcon. Dans la rue, une jeune fille en chandail rayé style marin, équipée d’un casque, de protège-poignets et -genoux, fait ses premières armes sur des patins à roues alignées flambant neufs. Penchée par en avant et les bras écartés, elle roule lentement, sérieuse, très concentrée. La grâce n’y est pas encore, mais c’est une question de minutes parce qu’elle gagne de l’assurance à vue d’œil. Après qu’elle a redessiné cent fois la même boucle devant les maisons, une copine ou sa grande sœur vient la rejoindre, et les deux prennent leur élan, elle toute souriante, déjà délestée d’une partie de sa lourdeur, et disparaissent au coin de la rue.
Je ne tenais plus en place, j’ai posé mon livre et décidé d’aller marcher, à pas de tortue, prudemment. Dans les rues où je déambule maintenant, même au soleil les gens se promènent comme s’ils faisaient à contrecœur un exercice qui leur a été prescrit. Ils n’avaient pas l’habitude d’observer les alentours, je vois bien qu’ils ne la prendront pas de sitôt. Et c’est dommage parce que l’habitude crée la vertu, et non l’inverse, du moins selon Aristote. Un couple s’en vient sur l’autre trottoir. Une pluie fine commence à tomber. Puis elle s’arrête, sans qu’ils semblent s’en rendre compte, lui restant le menton enfoncé dans le col de son manteau, elle cachée sous son parapluie. La douceur du temps ne les concerne pas. Ils ne voient pas les geais, les cardinaux, les roselins affairés qui filent au-dessus de nos têtes, ni les deux ados à trottinette qui s’amusent à lancer des bonjours à tout le monde. Direction les sous-bois. Là tout est normal – à part le ruisseau qui a l’air de vouloir sortir du bois tellement son courant est fort. À la lisière d’un champ, la seule étreinte dont j’ai été témoin depuis un bout de temps, un cerisier d’automne enlace sans retenue un bouleau jaune.

*
29 mai
Les chiens que je vois faire leurs promenades quotidiennes depuis deux mois n’ont pas dû se rendre compte de la situation. On n’était pas si loin de leur inconscience nous-mêmes, figés devant les écrans. Un avantage d’avoir les yeux rivés dessus est que la sortie de notre isolement ne devrait pas être trop difficile, même si elle ne sera pas nécessairement facile – en supposant que c’est une vraie sortie et non un exercice d’évacuation. C’est une bonne chose si je pense, par exemple, aux témoignages sur les abus sexuels que je vois défiler sur Instagram (pas les douteux dazibaos publiés sur les murs de Facebook) ; une moins bonne si nous sommes pour être emportés par le déluge d’images dont le monde est déjà saturé. J’essaie d’imaginer l’épisode de confinement sans ces défouloirs. Nos masses d’experts auraient trouvé un autre exutoire, la radio sans doute, mais l’isolement ressenti aurait été bien plus intense. Et comme d’habitude, ce qui se passe loin de chez nous aurait été jeté aux oubliettes.
♠
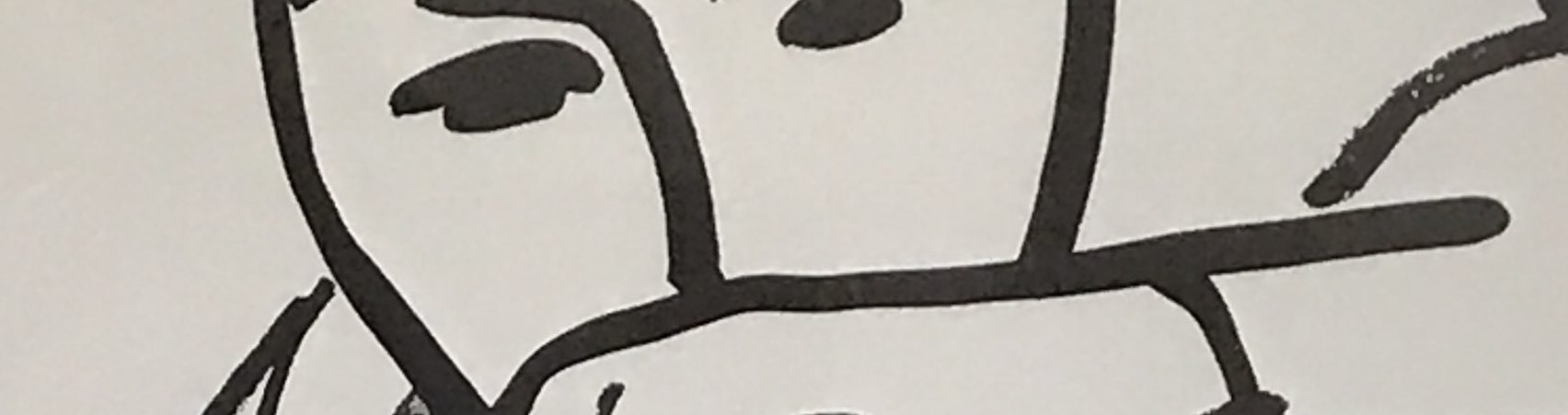
Et juin et juillet et août et maintenant septembre avec sa deuxième vague annoncée, le journal va-t-il en parler? Ou si comme moi, il
a un espèce d’engourdissement mauvais et le bourdonnement continuel Covid, Covid, Covid… qu’on dirait un leitmotiv éternel qui provoque un réel écœurement.
Superbe texte Jacques.
J’aimeJ’aime
Merci Nicole ! Si c’est pour aller mal, oui. Si tout va bien, pas de journal 🙂
J’aimeJ’aime
je me suis permis de citer trois passages de votre texte, vous avez une véritable écriture
J’aimeJ’aime
Oui, merci Pierre, je me suis relu à travers vous, c’est très gentil.
J’aimeJ’aime
Merci Jacques…texte vivant…..j’aime ..
bye Lise Gagnon
J’aimeAimé par 1 personne