La matière est toujours riche dans les carnets d’André Major. Il peut noter une vingtaine de réflexions en quelques jours et sans abuser d’aphorismes, parce que le plus souvent il développe sa pensée et va jusqu’à filer les thèmes à travers les années. On dit qu’il faut lire Cioran à dose homéopathique, deux ou trois pages à la fois : avec Major on peut prendre de plus grosses portions. C’est vrai qu’il est moins noir, et s’il se dit parfois revenu de tout il ne traîne pas d’amertume, sa pulsion de vie est trop forte. Citant en 1995 une phrase fameuse de Pessoa : « L’horreur de devoir vivre se leva de mon lit avec moi », il écrivait que « s’il m’arrive de me faire le lointain écho du contempteur franco-roumain ou du mélancolique employé de bureau de Lisbonne, la curiosité et le goût de jouir me rendent la plupart du temps la vie légère ».
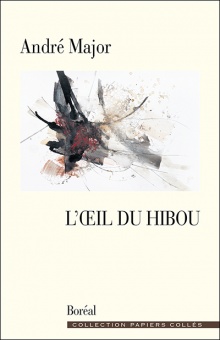 Il a été bien servi par sa décision – révélée dans Le sourire d’Anton en 2001 – de dire adieu au roman, n’ayant plus aucun désir de s’atteler à une œuvre de longue haleine, aspirant à un « calme profond, vaste comme un désert ». C’est ainsi qu’il se retirait dans ses carnets. Libéré de sa table de travail, il a embrassé la vie matérielle « sans pour autant éprouver le sentiment d’une perte », écrit-il dans L’œil du hibou. Il lit, bricole autour de son chalet, se promène dans les bois, n’attend plus « rien ni personne ». Désormais étranger parmi les siens, il s’est donné un cadre de vie serein où la rumeur du monde a cédé la place à la rumeur du paysage :
Il a été bien servi par sa décision – révélée dans Le sourire d’Anton en 2001 – de dire adieu au roman, n’ayant plus aucun désir de s’atteler à une œuvre de longue haleine, aspirant à un « calme profond, vaste comme un désert ». C’est ainsi qu’il se retirait dans ses carnets. Libéré de sa table de travail, il a embrassé la vie matérielle « sans pour autant éprouver le sentiment d’une perte », écrit-il dans L’œil du hibou. Il lit, bricole autour de son chalet, se promène dans les bois, n’attend plus « rien ni personne ». Désormais étranger parmi les siens, il s’est donné un cadre de vie serein où la rumeur du monde a cédé la place à la rumeur du paysage :
« Un vent du nord malmène le myrique baumier qui buissonne le long de la plage. J’essaie de ne rien entendre d’autre et de jouir de cette vie qui grouille autour de moi. »
En fait, il s’est placé à une distance mesurée de la vie littéraire, dans un entre-deux, sans vivre isolé comme les grands écrivains qu’il admire. Il a conservé de son enfance le rituel d’allumer la radio chaque matin pour garder le contact avec le monde. Une trop grande solitude a-t-il avoué lui aurait été intolérable. Il est comme resté à la fenêtre, il a géré sa solitude. Quand il reçoit des invitations, il les décline rarement malgré la résistance qui le tenaille :
« Sous un ciel gris, j’ai planté deux chênes prélevés dans la montagne et un pin qui poussait tant bien que mal parmi les framboisiers sauvages. Une neige fine tombait lentement en fin de journée. Le feuillage des érables illumine encore la montagne et les arbres. Je me tâte avant d’accepter de participer à une table ronde organisée à l’occasion de… »
Il le regrette parfois, comme après les remises officielles de prix, qui l’assomment. Mais il accorde des entrevues, envoie des articles, accepte une résidence d’écrivain, donne un cours de création littéraire, participe à un séminaire sur un film. S’il peut écrire marchant sur la berge que « la solitude ne [lui] pèse plus », c’est parce qu’elle sera éphémère. Il a la bougeotte, ce qui est sans conteste l’un des facteurs qui l’ont amené à abandonner le roman, qui cloue l’auteur à sa chaise.
*
À première vue, il donne l’impression d’avoir toujours fait la navette : vivre en solitaire lui donne un sentiment de plénitude, mais il continue de revenir ; la vie littéraire lui semble vite dénuée d’intérêt, et il déserte à nouveau. Cette question du va-et-vient entre vie publique et solitude, entre la ville et la campagne, revient d’un bout à l’autre de son œuvre. En 1964 déjà son roman Le cabochon racontait l’échec d’un exil à la campagne. Dans Le vent du diable, en 1968, Albert fuyait les mirages de la ville (où il retournera) pour retrouver dans la montagne la force de la nature et « la certitude des sensations ». Dans les Histoires de déserteurs, un gars et une fille quitteront leur village pour la ville, où tout tournera au désastre pour eux, tandis que deux autres femmes iront s’y libérer de leur dépendance conjugale. Il n’est pas étonnant qu’à l’époque Major se soit passionné pour l’œuvre de Félix-Antoine Savard : il y retrouvait des conflits créés par la soif de liberté (« Que défend Menaud si ce n’est la montagne, la forêt, horizon de sa liberté ? », écrit-il dans sa monographie sur Savard). Ce qu’on observe chez lui n’est pas tant une alternance, sans doute impossible, entre deux formes de vie qu’un tiraillement continu qui se manifeste dans tout ce qu’il écrit.
Major est connu pour avoir multiplié les volte-face tout au long de sa vie. Dès les années 60, après quelques années de militantisme il renonce à l’engagement politique. Ses premières œuvres puisent à pleines mains dans la langue populaire, puis il adopte un français soigné. Au fil des ans, il se fatigue du milieu littéraire, s’isole dans la nature, abandonne la fiction, tourne le dos au nationalisme. On se dit qu’à chaque étape il a suivi sa pente et préféré faire cavalier seul comme il l’a expliqué à la parution de L’œil du hibou en 2017. C’était aussi chaque fois une façon de se débarrasser d’un carcan. Mais on ne peut s’empêcher de voir un lien entre ses revirements et tous les non  qui jalonnent l’histoire du Québec et constituent, selon Mathieu Bélisle, un des traits fondamentaux des Québécois – du néant admirable de Marie de l’Incarnation au non du printemps étudiant, en passant par le non-poème de Gaston Miron, mon pays ce n’est pas un pays de Vigneault, les deux référendums et ainsi de suite. Sauf que les non d’André Major ne sont jamais catégoriques. Il s’est renchaîné à quelques reprises à sa table de travail pour écrire de la fiction. Il participe encore à la vie littéraire. Il revient toujours sur le front politique : il s’en est pris à la mauvaise foi des intellectuels face à la question amérindienne, et L’œil du hibou dénonce la bien-pensance, le débraillé linguistique, la détérioration des médias, les protestations de féministes contre la campagne de financement pour le cancer de la prostate. Plutôt que de dire non, il aura donné des réponses de Normand, ni oui ni non – ce qui est encore plus typiquement québécois. En ce sens, peu d’auteurs sont autant que lui à l’image de la société avec laquelle il prétend avoir pris ses distances.
qui jalonnent l’histoire du Québec et constituent, selon Mathieu Bélisle, un des traits fondamentaux des Québécois – du néant admirable de Marie de l’Incarnation au non du printemps étudiant, en passant par le non-poème de Gaston Miron, mon pays ce n’est pas un pays de Vigneault, les deux référendums et ainsi de suite. Sauf que les non d’André Major ne sont jamais catégoriques. Il s’est renchaîné à quelques reprises à sa table de travail pour écrire de la fiction. Il participe encore à la vie littéraire. Il revient toujours sur le front politique : il s’en est pris à la mauvaise foi des intellectuels face à la question amérindienne, et L’œil du hibou dénonce la bien-pensance, le débraillé linguistique, la détérioration des médias, les protestations de féministes contre la campagne de financement pour le cancer de la prostate. Plutôt que de dire non, il aura donné des réponses de Normand, ni oui ni non – ce qui est encore plus typiquement québécois. En ce sens, peu d’auteurs sont autant que lui à l’image de la société avec laquelle il prétend avoir pris ses distances.
*
À la date du 25 mai 2001, il avoue que sa vie matérielle en est venue à bloquer les « dérives imaginaires ». Ses journées sont en effet remplies : il jardine, herborise, cuisine des plats exotiques, améliore le confort de son chalet, répare des meubles, vernit son plancher, se taille des bâtons de marche, débroussaille son terrain, refait le quai, part en kayak sur le lac en été, en raquettes dans les bois en hiver, aménage une patinoire, il n’arrête pas.
Peut-être a-t-il voulu en finir avec la création littéraire parce qu’il rêvait de ces activités de bricolage et de plein air qui nous relient au « passé immémorial de l’humanité » et donnent toute sa place à la jouissance des sens. Il est possible aussi qu’après avoir choisi une sorte d’exil, il ait voulu conjurer le vrai désert dont il devinait encore la présence dans le voisinage de sa « solitude » : comme l’inspecteur Therrien dans les Histoires de déserteurs, qui sait si la panique ne l’a pas envahi quand l’oisiveté l’amenait devant « cet abime de silence où le risque était grand de perdre pied » ? Mais si les mille occupations quotidiennes auxquelles il se livre l’avaient comblé, il y a longtemps qu’il aurait pris congé des « désenchanteurs » – comme Pessoa, qui revient en force avec ses hétéronymes dans son roman À quoi ça rime ? en 2013, ou les solitaires purs et durs comme Hamsun, Kafka, et surtout Flaubert et Bernhard, les deux qu’il cite le plus souvent dans L’œil du hibou – au profit des « embellisseurs ». « Voir les choses telles qu’elles sont, explique-t-il, si cela plonge certains esprits dans la plus noire mélancolie, pour d’autres c’est tonifiant comme l’air du large. » Voilà pourquoi tous ses livres ont un côté sombre. Fréquenter les pessimistes comme il le fait, tout en se consolant régulièrement auprès de son cher Tchekhov, est sans doute pour lui une façon de garder les pieds sur terre, de ne pas oublier qu’il y a un désert qui guette la vie la plus remplie.
*
C’est moins par esprit de démission, de toute évidence, que le romancier a passé le relais au carnettiste que pour pousser plus loin sa quête de vérité.
Ce n’est pas que le roman soit un genre limitatif en soi : trop d’œuvres montrent qu’on peut faire ce qu’on veut avec. Ni que la fiction de Major manque de qualités : récits bien faits où le ton est juste, l’écriture sobre, les face-à-face intenses, comme au début du Vent du diable au ton si faulknérien (« On dirait que l’orbite de son œil ne contient plus son regard, que la peur rompt les liens de la chair… »), la narration prenante dans les scènes d’affrontement, comme les bagarres de « La semaine dernière pas loin du pont », qui sont de vrais page-turners ; sans parler de la finesse des jeux de séduction et des ébats sexuels que Major, davantage que beaucoup d’écrivains, sait rendre dans tous les registres, amoureux, sensuels, crus ou carrément pervers, et même les fiascos. La folle d’Elvis contient une superbe nouvelle, « Le bon vieux temps », qui est aussi forte, malgré le thème usé du couple usé,  que les meilleures de Raymond Carver. Les puissantes Histoires de déserteurs, où son tableau du petit monde de la Main n’a rien à envier à Tremblay, où il radiographie l’âme d’à peu près tous les habitants d’un sombre village, sont si savamment construites qu’on peut comprendre qu’il n’a plus eu envie de ramer à nouveau dans ce genre de galère. Mais le plus souvent – pas toujours, comme en fait foi le très beau récit À quoi ça rime ? – c’est une fiction qui reste conventionnelle, de facture classique, fait montre de peu d’audace créatrice ou stylistique, colle aux faits et gestes des personnages, est parfois prévisible, rebondit sur des coïncidences romanesques, manque à l’occasion d’envergure, et n’évite pas les lieux communs (« Il entre finalement dans un café où l’accueille une bonne odeur de café frais moulu »). Même les Histoires de déserteurs sont affaiblies par de longs passages surchargés de détails de toutes sortes et par une certaine raideur dans cette façon de raconter beaucoup de choses par le biais de rappels, au plus-que-parfait de l’indicatif, comme si une force supérieure avait scellé le destin de chaque personnage. Major a expliqué qu’il a voulu cesser d’être une machine à pondre des récits qui ne le menaient nulle part ; mais c’est peut-être ce à quoi le confinait un style trop réaliste, même s’il n’a pas toujours été imperméable à l’air du temps.
que les meilleures de Raymond Carver. Les puissantes Histoires de déserteurs, où son tableau du petit monde de la Main n’a rien à envier à Tremblay, où il radiographie l’âme d’à peu près tous les habitants d’un sombre village, sont si savamment construites qu’on peut comprendre qu’il n’a plus eu envie de ramer à nouveau dans ce genre de galère. Mais le plus souvent – pas toujours, comme en fait foi le très beau récit À quoi ça rime ? – c’est une fiction qui reste conventionnelle, de facture classique, fait montre de peu d’audace créatrice ou stylistique, colle aux faits et gestes des personnages, est parfois prévisible, rebondit sur des coïncidences romanesques, manque à l’occasion d’envergure, et n’évite pas les lieux communs (« Il entre finalement dans un café où l’accueille une bonne odeur de café frais moulu »). Même les Histoires de déserteurs sont affaiblies par de longs passages surchargés de détails de toutes sortes et par une certaine raideur dans cette façon de raconter beaucoup de choses par le biais de rappels, au plus-que-parfait de l’indicatif, comme si une force supérieure avait scellé le destin de chaque personnage. Major a expliqué qu’il a voulu cesser d’être une machine à pondre des récits qui ne le menaient nulle part ; mais c’est peut-être ce à quoi le confinait un style trop réaliste, même s’il n’a pas toujours été imperméable à l’air du temps.
En revanche les carnets sont uniques, si l’on met à part les quelques pages où il raconte sa petite vie (un rendez-vous à la banque pour planifier sa retraite). Major y fraye avec les plus grands, remet en marche leurs réflexions, montre comment nos idées, nos sensations, nos attitudes subissent le passage du temps, note des pensées saisissants (« Ces morts qui engraissent le sol aride où ils reposent après avoir tenté toute leur vie d’en tirer une maigre subsistance ») et dignes de la meilleure tradition française (« Il y a des gens dont les qualités intellectuelles forcent notre admiration, mais à qui nous ne pardonnons pas de paraître indifférents à la personne que nous sommes, comme si nous attendions d’eux une reconnaissance qui nous hisserait à leur niveau »). Il lâche les rênes à ses opinions sur ses contemporains (« on ne peut convaincre que les esprits vacants qui seraient aussi bien disposés à croire le contraire de ce qu’on leur affirme ») et s’il rappelle que ce qui lui importe avant tout, « c’est de faire danser la petite lueur d’une vérité commune », il ne craint pas de laisser affleurer une certaine misanthropie, répétant après Bernhard que « la plupart des gens sont mesquins », tout en évoquant avec émotion les siens :
« Quand j’arpentais ce terroir sans horizon où ceux de ma lignée avaient survécu tant bien que mal, j’avais l’impression de mettre mes pas dans les leurs, d’entendre la même rumeur qu’eux et, à défaut de partager leur destin, d’éprouver le sentiment de solitude et d’impuissance qui devait être le leur à la fin de la journée. »
L’un des rares reproches qu’on pourrait lui faire est de rester trop près de ses modèles, de ne pas aller souvent vers du neuf. Mais il est entier d’un bout à l’autre. Qu’il promène son regard ébloui sur le paysage des Laurentides, parle de ses rencontres ou de son travail d’écrivain, polémique, commente des œuvres, il a derrière chaque phrase qu’il écrit une présence de tous les instants qui faisait dire à Pierre Foglia que ses petites proses lui collaient « à la peau comme s’il les avait écrites exprès par amitié pour moi, comme des mitaines qui ne feraient qu’à moi ». La voix de Major est attachante, pacifique, elle vocifère mais avec modération, sans oublier ses colères rentrées. Le foisonnement de réflexions dans ses carnets est la preuve qu’il ne doit pas regretter sa décision.
*
Avec ses carnets il y a donc eu un bond en avant, mais sans véritable rupture, parce que lorsqu’on lit pêle-mêle romans et carnets, les ressemblances sautent aux yeux. C’est normal : il n’a pas changé de peau en changeant de genre, partout il poursuit les mêmes démons et savoure les mêmes délices.
Le monde sensible reste omniprésent. Comme le carnettiste de L’œil du hibou, le héros de ses romans s’arrêtait pour contempler « les hauteurs qu’illumine l’embrasement des érables ». C’est le même être tourmenté, qui rumine, vit comme sur la défensive,  cherche la bonne ligne de conduite, de façon obstinée mais presque avec désintéressement, par souci moral avant tout dirait-on. Le narrateur ne le quitte pas d’une semelle, lui relaie la lucidité, les passions, l’inquiétude, jusqu’aux goûts littéraires de l’auteur. Une nouvelle de La folle d’Elvis raconte l’histoire d’un prof de littérature qui quitte l’enseignement pour occuper un poste de gestion. Un autre de ses héros se désespère de l’entreprise médiatique où il travaille, comme Major lui-même de Radio-Canada où il travaillait. Un autre encore, roulant en voiture, se plaint du « bavardage habituel » à la radio « sur la chaîne soi-disant musicale ».
cherche la bonne ligne de conduite, de façon obstinée mais presque avec désintéressement, par souci moral avant tout dirait-on. Le narrateur ne le quitte pas d’une semelle, lui relaie la lucidité, les passions, l’inquiétude, jusqu’aux goûts littéraires de l’auteur. Une nouvelle de La folle d’Elvis raconte l’histoire d’un prof de littérature qui quitte l’enseignement pour occuper un poste de gestion. Un autre de ses héros se désespère de l’entreprise médiatique où il travaille, comme Major lui-même de Radio-Canada où il travaillait. Un autre encore, roulant en voiture, se plaint du « bavardage habituel » à la radio « sur la chaîne soi-disant musicale ».
Des détails matériels ont le même air de famille : le roman L’hiver au cœur nous donnait la liste complète des ingrédients d’un plat que préparait Antoine avant de passer la soirée avec une camarade d’enfance ; L’œil du hibou nous donne la recette d’une omelette parmentière que prépare le carnettiste avant d’aller faire une marche. Jusqu’à l’érotisme qui est constant : la pudeur va l’empêcher de mettre dans les carnets l’équivalent des scènes de La vie provisoire où la température est assez élevée ; mais il va prendre le temps de confesser que « dès que je m’étends pour la nuit, si je ne suis pas la proie d’une idée fixe, d’un remords lancinant ou d’une inquiétude, ma pensée s’érotise toute seule ».
On pourrait tirer la simple conclusion que le carnettiste se souvient du romancier. Major a décrit lui-même ses carnets comme un dérivé de la fiction. Rien n’empêche d’ailleurs de penser qu’un écrit intime a un « narrateur » tout autant qu’une œuvre de fiction (« There’s no such thing as nonfiction », disait Norman Mailer). Il est vrai aussi que roman et carnet ont parfois été écrits en parallèle. Mais j’aime mieux penser que le carnettiste était là depuis le début. Car un aspect frappant de la fiction de Major est la fréquence de ses intrusions dans le récit au cœur même de l’action : il identifie un arbre, mentionne une œuvre ou un plat, dénonce une faute de français entendue à la télé – comme si le narrateur était souvent interrompu par un porte-parole de l’auteur qui vient ouvrir une parenthèse pour faire un commentaire parfois sans lien avec le récit, mais en prise directe sur le réel. Dans Le cabochon, quand la mère d’Antoine lui crie que le souper est prêt, on apprend que la fricassée qu’ils vont manger comprend « du bœuf haché menu, avec des morceaux d’oignons, des patates pilées, le tout mélangé avec une sorte de sauce maison ». Quand le  narrateur de « La chair de poule » fait lire La montagne magique à son héros, on sent bien qu’il vient de l’amener chez l’auteur. Dans « Le grand tata », le narrateur n’arrête pas de se tourner vers le lecteur. Parfois l’élément est parfaitement intégré au récit : dans les Histoires de déserteurs, l’élection de Jérôme à l’Assemblée nationale est une illustration féroce des horribles bassesses de la politique ; quand la belle Émérence passe flambant nue entre la télé et son amant qui garde les yeux rivés sur son match de hockey, on entend comme une accusation d’impuissance qui n’est pas sans préfigurer certaines remarques sur le Québec dans L’œil du hibou ; quand le même amant est jaloux d’un « maudit baveux d’émigré » (en 1976) ou que Momo Boulanger insiste pour se faire appeler Baker, c’est Major qui tire à boulets rouges sur la société qui l’entoure. L’adieu au roman était annoncé dans sa fiction, ou à tout le moins la porte était ouverte.
narrateur de « La chair de poule » fait lire La montagne magique à son héros, on sent bien qu’il vient de l’amener chez l’auteur. Dans « Le grand tata », le narrateur n’arrête pas de se tourner vers le lecteur. Parfois l’élément est parfaitement intégré au récit : dans les Histoires de déserteurs, l’élection de Jérôme à l’Assemblée nationale est une illustration féroce des horribles bassesses de la politique ; quand la belle Émérence passe flambant nue entre la télé et son amant qui garde les yeux rivés sur son match de hockey, on entend comme une accusation d’impuissance qui n’est pas sans préfigurer certaines remarques sur le Québec dans L’œil du hibou ; quand le même amant est jaloux d’un « maudit baveux d’émigré » (en 1976) ou que Momo Boulanger insiste pour se faire appeler Baker, c’est Major qui tire à boulets rouges sur la société qui l’entoure. L’adieu au roman était annoncé dans sa fiction, ou à tout le moins la porte était ouverte.
Déjà en 1968, il mettait un point final au Vent du diable aux trois quarts du livre et le complétait par un carnet, où il révélait que tout ce qu’il venait de raconter était autobiographique. En 1995, La vie provisoire se termine sur la défaite, à l’élection municipale, d’une médecin qui avait promis d’ouvrir une bibliothèque. Encore aujourd’hui les évocations de sa vie domestique dans L’œil du hibou sont une façon d’empêcher ses réflexions dit-il de flotter dans « l’apesanteur ». Le réalisme littéraire de Major, la présence du quotidien tout au long de ses carnets, ses préoccupations terre à terre découlent d’un principe fondamental chez lui, que la réalité est « là où se trouve la vérité et non ailleurs », comme il l’écrit en citant Pierre Vadeboncœur qui dans L’œil du hibou fait un peu figure de maître à penser pour lui. Ce réalisme, expliquait-il ailleurs, ne consiste pas à être fidèle à une quelconque réalité, mais à raffiner son regard.
*
Major a beau dire qu’il en est venu à fréquenter les épiceries – et sans doute les quincailleries – autant que les librairies, il ne s’est pas éloigné une miette de la littérature. L’œil du hibou est un véritable carnet de lecture, activité ayant le gros avantage de se passer de voisin, dit-il dans un élan nietzschéen. Les nombreuses critiques souvent serrées des œuvres qu’il relit sont un délice. Parce qu’il relit surtout.
D’abord les ermites qui ont soumis leur vie à la littérature – ce qu’il ne comprend pas et refuse de faire, sans pour autant leur ménager son admiration : « On entend chez Tolstoï un cheval penser, chez Platonov le vent psalmodier, chez Gabrielle Roy l’horizon chuchoter à nos oreilles. » Ces écrivains, qui font partie de son identité profonde, ne pourraient rêver de meilleur lecteur que lui, qui les a côtoyés comme des compagnons tout au long de sa vie. (Sauf Victor-Lévy Beaulieu dont il redécoupe l’ego avec un scalpel.)
Il dévore les essais sur l’œuvre ou la vie d’écrivains comme Gide ou Faulkner. Il reste attaché à ceux qui comme lui ont renoncé à la création romanesque, de Gogol à Gracq en passant par Canetti. Hamsun, qu’il connaît par cœur, le fascine, seul dans la forêt ou sa cellule de prison. Il lit de près Naipaul, Pavese, Virginia Woolf, Handke, Stevenson, Borges, Jules Renard, Onetti, Simenon.
Ceux qui ont lu Prendre le large se souviennent du passage où, sous la neige qui tombe, Major s’imagine être le général Samsonov qui, dans Guerre et paix, somnole sur sa  monture sans rien faire, confiant que l’hiver s’occupera de décimer les armées de Napoléon. À Lisbonne, il plaçait le narrateur d’À quoi ça rime ? à une table à l’ombre des arcades d’un restaurant « pensant à Pessoa qui y rencontrait ses amis ». Dans L’œil du hibou, il marche avec le romancier Ernst Wiechert et ses mots, d’un « pas léger, comme si l’on avait des ailes, mais, sous terre, quelque chose accompagnait nos pas et ce n’était ni léger ni ailé : c’était noir et pesant comme le suc du pavot » : c’est une marche vers la mort.
monture sans rien faire, confiant que l’hiver s’occupera de décimer les armées de Napoléon. À Lisbonne, il plaçait le narrateur d’À quoi ça rime ? à une table à l’ombre des arcades d’un restaurant « pensant à Pessoa qui y rencontrait ses amis ». Dans L’œil du hibou, il marche avec le romancier Ernst Wiechert et ses mots, d’un « pas léger, comme si l’on avait des ailes, mais, sous terre, quelque chose accompagnait nos pas et ce n’était ni léger ni ailé : c’était noir et pesant comme le suc du pavot » : c’est une marche vers la mort.
Il n’a pas peur de changer d’idée. Maupassant était rabaissé dans L’esprit vagabond : noir et léger, l’auteur d’Une vie « n’était pas pour autant un écrivain » (l’opinion de Sartre) et Boule de suif manquait de « texture proprement littéraire » (avait-il oublié la larme qui roule sur la joue de Boule de Suif ?). Mais ici Maupassant rentre au panthéon et Major rappelle l’immense considération que Tchekhov avait pour lui.
Même s’il ne lit de la correspondance de Flaubert que les extraits de Préface à la vie d’écrivain, on ne souhaiterait jamais que son éditeur nous bricole une édition de ses carnets amputée de tout ce qui concerne ses ennuis de santé, son magasinage pour un chiot, sa bataille avec une compagnie d’assurances. Les écrits intimes comme les siens prennent leur intérêt quand on lit tout ce que l’auteur a couché sur papier, jour après jour, sur une longue période.
*
Major est dépourvu de prétention, malgré son énorme bagage il a quelque chose du gars ordinaire. « Je crois bien ne pas avoir une vision transcendante de l’essentiel, en quoi je ressemble à la plupart des gens ordinaires », disait-il dans Prendre le large. Dans L’esprit vagabond il ne cachait pas son plaisir d’avoir eu enfin un jour les moyens de s’acheter des vêtements seyants (comme Thouin, héros de La vie provisoire, qui a pu enfin se payer un « costume de velours côtelé » quand il est devenu journaliste). Dans L’œil du hibou, il se moque allègrement d’un poète québécois qui se décrit comme un « démarcheur d’infini ». Il est resté fidèle à la pauvreté de ses origines. Il expose ses faiblesses, par exemple que son éducation familiale l’empêchera toujours d’exprimer sa colère. Il est abusif de lui reprocher, comme on l’a fait, d’être « moralisateur » : c’est toujours un reproche qu’on adresse à ceux dont la morale nous déplaît.
C’est un homme loyal avec proches et amis. Il met tout de côté, travail littéraire compris, pour s’occuper de ses oncles et tantes jusqu’à leur dernier souffle. Peu après la mort de Jacques Ferron, il avait planté un amélanchier dans son jardin. Notons en passant qu’à la ville comme à la campagne, la première chose qu’il aperçoit sont toujours les arbres, sans doute à cause de cette présence rassurante que leur attribue Julien Green quelque part dans son journal. Major les connaît comme des intimes. L’un de ses personnages médite en se rappelant sa grand-mère :
«  Dans le cimetière de la famille, il n’y a que des saules pleureurs, les seuls qui soient dignes, croit-on, d’assurer le repos des morts. Ce sont des arbres à chagrin, aux membres las, aux murmures tristes et lents. Peut-être qu’elle aurait préféré l’ombre des pins et la douceur des cèdres. »
Dans le cimetière de la famille, il n’y a que des saules pleureurs, les seuls qui soient dignes, croit-on, d’assurer le repos des morts. Ce sont des arbres à chagrin, aux membres las, aux murmures tristes et lents. Peut-être qu’elle aurait préféré l’ombre des pins et la douceur des cèdres. »
Tout ne coule pas de source. Il arrive à sa prose de prendre son élan lourdement sur des arguments plus que sur des impressions vives. Le réalisme de ses romans se traduit à l’occasion dans ses carnets par un style démonstratif, qui manque de spontanéité – peut-être attribuable au fait qu’il résulte de révisions apportées à des notes jetées dans ses moleskines bien des années plus tôt.
Étrange trou noir entre le 1er avril et le 7 mai 2002, où il passe cinq semaines en France. Pas l’ombre d’une note, rien, comme s’il avait oublié d’apporter son calepin. Donc aucune impression directe de son voyage. Après coup, on apprend qu’il y est allé entre autres faire des recherches sur ses ancêtres. C’est encore une forme d’ancrage dans le réel. L’œil du hibou mentionne aussi sa participation à une rencontre des Major-Bontron d’Amérique à Ottawa. Lesquels apparaissaient déjà sous le nom de Bautront dans deux nouvelles de La folle d’Elvis, et auparavant parmi les villageois des Histoires de déserteurs, et même dans sa pièce Une soirée en octobre.
Dans Le sourire d’Anton, il disait rêver d’être « l’invisible blessure du sol » d’où la langue aurait jailli coulante, pour ensuite reconnaître qu’on n’est jamais « maître de son langage », que notre voix est toujours « maladroite », qu’elle nous trahit. L’œil du hibou réaffirme plusieurs fois l’importance de la flânerie et de la rêverie. Mais ses phrases abusent d’un tic qui peut devenir agaçant par endroits, cette façon de dire : après avoir mangé mon gruau et bu mon café, pour lire mon journal, faire mon ménage du lundi, ma sieste de l’après-midi, ma promenade du soir. Chaque fois que revenaient ces tournures, je gardais l’impression que sa vie est réglée comme un papier à musique. Quels bienfaits peut-on retirer de moments de flânerie aussi soigneusement planifiés ? Bien sûr, il n’allait pas en ces années 2000 retrouver l’insouciance de ses vingt ans quand il avait cette « rage de marcher » que décrivaient en 1966 ses Mémoires d’un jeune Canoque, et qu’il errait au hasard des rues dans le seul but de « se perdre pour se retrouver, s’épuiser pour renaître ».
*
Il est remarquable que des commentateurs ayant aussi peu d’atomes crochus que Gilles Marcotte et Pierre Foglia aient vu dans les carnets de Major l’une des proses les plus belles et les plus claires qui se soient écrites au Québec. Major y a mis tellement de vie qu’ils ne vieilliront pas de sitôt. L’idéal est de lire les quatre recueils dans l’ordre chronologique. C’est une façon de le côtoyer comme il le fait avec ses auteurs préférés. De L’œil du hibou, je retiens cette maxime notée le 21 mars 2002 :
« Ne plus croire qu’on a quelque chose à dire, quelle liberté ! Voilà qu’après avoir été à l’étroit dans son moi frileux, on peut sentir le souffle du monde passer à travers soi. »
Une réflexion qui donne une bonne idée du cheminement qu’a suivi la personne avec qui on a affaire tout au long de ces carnets écrits et revus sur une période de plus de quarante ans.
♠
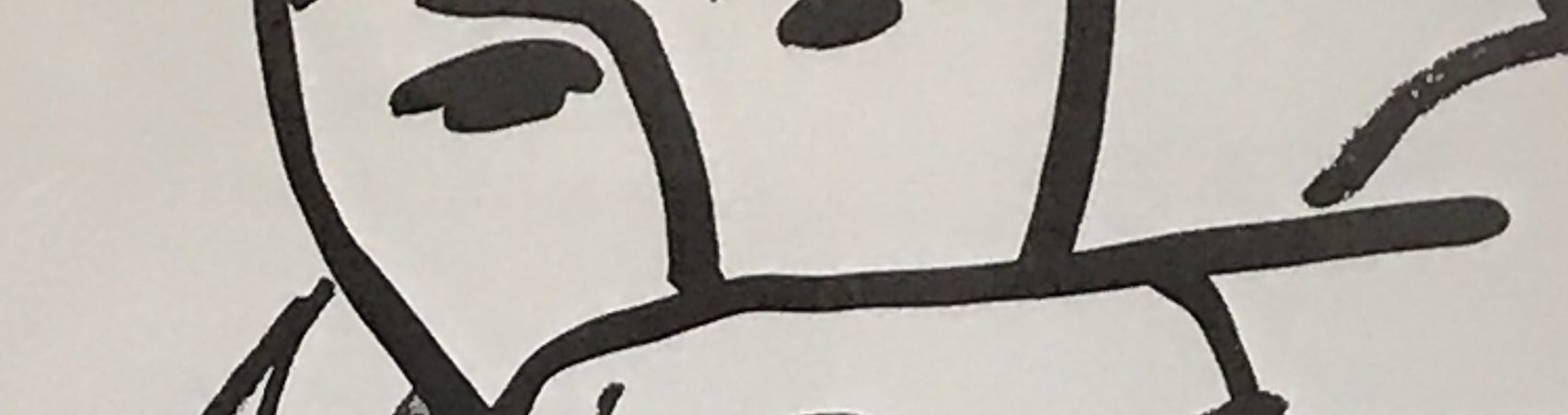



J’aime beaucoup votre blog. Un plaisir de venir flâner sur vos pages. Une belle découverte et blog très intéressant. Je reviendrai m’y poser. N’hésitez pas à visiter mon univers. Au plaisir.
J’aimeAimé par 1 personne
Merci beaucoup Angelilie pour ce généreux commentaire. C’est entendu, vous recevrez ma visite bientôt !
J’aimeJ’aime
Commentaire précédent de Jacques.
J’aimeJ’aime
Je le dis simplement : je suis impressionné. Ce n’est pas qu’une lecture portant sur un livre, c’est un ensemble de lectures embrassant toute une somme ! Évidemment, comme tout ce que j’ai lu sur ce blogue, cette étude donne envie de lire et de découvrir. J’espère que l’auteur a eu vent de cet écrit.
J’aimeAimé par 2 personnes
Merci encore une fois. L’auteur (Major) oui ! Grâce aux bons soins de quelques facebookiens qui le connaissent personnellement.
J’aimeJ’aime
Tout comme Daniel, je suis impressionné par ton embrassement de l’oeuvre d’André Major. Lorsque je l’aurai lu davantage, je reviendrai, relire ce que tu en dis. Pour l’instant, je viens de terminer la lecture de Prendre le large, complètement sous le charme, le livre abondamment ponctué de coeurs, d’étoiles, de soulignements, de références. Je vais commencer sous peu la lecture de Le sourire d’Anton ou L’adieu au roman. Merci Jacques, ton texte a éveillé mon intérêt pour André Major, son écriture me rejoint en plus d’un aspect.
J’aimeAimé par 1 personne
Merci infiniment Jean-Marc, surtout de prendre le temps de me faire ce compliment. Je feuilletais cette semaine un vieux carnet de l’écrivain André Carpentier qui disait qu’il y a chez certains écrivains, les meilleurs, un « bruissement » — ça veut dire, je crois, qu’on entend, qu’on reconnaît leur voix à tout coup. L’expression viendrait de Roland Barthes : le bruissement, « c’est le bruit de ce qui marche bien ». Ce n’est pas courant. Mais il y a ça chez André Major, cette présence forte de sa personne partout dans ses textes. C’est peut-être ce qui m’a le plus impressionné inconsciemment.
J’aimeJ’aime