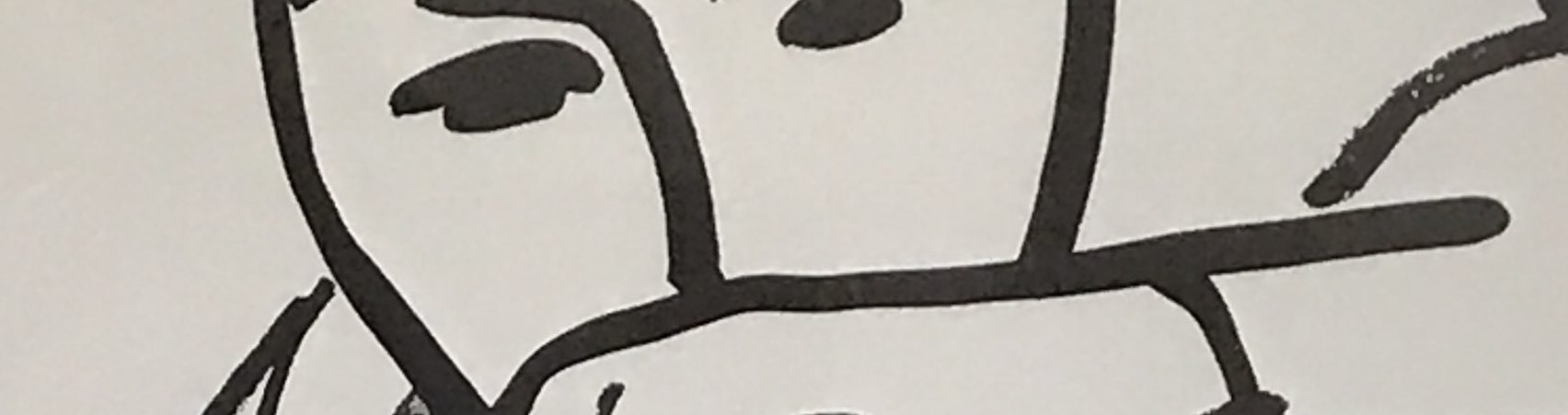Deuxième chronique sur un essai d’écrivain consacré à la peinture. Cette fois, le livre de Knausgaard sur Edvard Munch.

Knausgaard commence son examen des tableaux de Munch (1863-1944) par le très beau Champ de choux, peint en 1915. Ce genre de paysage pur, sans âme qui vive a marqué les peintres canadiens du Groupe des Sept, et c’est peut-être pourquoi en pays nordique nous nous sentons en terrain connu avec lui – sauf pour l’intense présence humaine dans ses autres tableaux, toujours hors champ chez Tom Thomson par exemple. On connaît surtout de Munch les célèbres toiles angoissées des années 1890, ces scènes de peur, d’isolement, d’anxiété, comme la foule de morts-vivants dans la Soirée sur l’avenue Karl-Johan, ou la jeune fille inquiète de Puberté, si fragile maintenant qu’elle sort de l’enfance et qu’émane derrière son épaule une ombre qui n’est rien d’autre que la hantise de ce qui l’attend. Quand Munch ne laisse entrer personne dans le tableau, il arrive que l’inquiétude persiste, peut-être parce qu’il nous montre quelque chose qui nous dépasse ou que notre absence y évoque la mort. Mais il s’en dégage souvent une certaine sérénité, parfois même une joie de vivre, ne serait-ce que dans le plaisir que procure la matérialité des couleurs, si bien qu’avec le temps il laissera entrer quelques personnages dans des tableaux ensoleillés.

*
L’intérêt de ce livre décousu, typiquement knausgaardien, réside en grande partie dans sa réflexion sur la création artistique. Pour pénétrer l’œuvre de Munch, Knausgaard met à contribution plusieurs penseurs français, aux côtés de Dostoïevski, d’artistes européens et de connaisseurs scandinaves. Deleuze y règne en souverain avec son idée de « la peinture avant de peindre », celle qu’il y a dans la tête de l’artiste et qui n’aboutira à la toile qu’après un grand ménage des clichés et de tous les encombrants. C’est une idée formidable, parce qu’elle implique que peindre ne consiste pas à transférer quelque chose sur la toile, mais à lui donner naissance. D’où l’importance suprême de la forme. On ne peut s’empêcher d’étendre cette idée à la littérature et d’y voir peut-être la source de la fascination qu’a exercée la peinture sur des écrivains comme Proust, Breton, Malraux et tant d’autres. Fidèle à son habitude, l’auteur de Mon combat a beau donner l’impression du lièvre qui gambade à gauche et à droite et jusqu’en-dessous de l’évier de cuisine, il reste préoccupé par l’essentiel.
Knausgaard relate aussi, dans un style vif, les nombreuses rencontres qu’il a eues pour monter l’exposition que lui a confiée le Musée Munch d’Oslo en 2017. Ses apartés seront familiers à ses lecteurs. Il compare le prix d’un portrait de Munch sur un site d’encan en ligne à celui d’une Golf d’occasion ; avoue avant de partir donner une conférence : « I got drunk a little during the dinner… » ; dit de l’historien de l’art Stian Grøgaard dont il est en train de serrer la main que « ses yeux me rappelaient vaguement ceux de Paul Auster », et ainsi de suite. La critique anglo-saxonne a jugé qu’on était encore dans l’autofiction du Combat avec ce livre. C’est un peu exagéré. Comme les romans de Knausgaard ne sont jamais tout à fait des romans, ni ses essais pas seulement des essais, So Much Longing n’est pas une vraie monographie. Qu’importe, la distinction des genres est un concept largement académique et Knausgaard n’appartient pas à ce monde-là. Il garde un côté brouillon, franc, primesautier.
*
Le livre ne raconte pas la vie de Munch, sinon par rappels. À quoi peut bien servir de connaître la vie d’un artiste, demande Knausgaard. Quand une œuvre se présente, on demande à l’auteur ses papiers, qui êtes-vous, de quel pays, quel âge avez-vous. Le temps passe et la majorité des œuvres ne laissent bientôt subsister, comme la mode vestimentaire, que le reflet de leur époque, qui y tenait une plus grande place que l’auteur lui-même malgré ses velléités. (Houellebecq avance la même chose dans une parenthèse au début de Soumission, quand il parle des œuvres d’autrefois où « on voit s’effilocher, au fil de pages qu’on sent dicter par l’esprit du temps davantage que par une individualité propre, un être incertain, de plus en plus fantomatique et anonyme ».) Knausgaard développe habilement cette idée par le paradoxe que ce sont les œuvres qui s’écartent de la norme au moment où elles sont créées qu’on tiendra plus tard pour représentatives de leur époque.
Selon lui, la biographie n’éclairera pas davantage une œuvre forte. Évidemment, après avoir écrit cinq mille pages d’autofiction, il serait mal placé pour nier l’existence de liens entre la vie et l’œuvre. Mais de là à mettre le doigt sur ces liens, il a raison de dire qu’il y a une marge. On n’est pas loin du Contre Sainte-Beuve de Proust. Knausgaard se rend bien compte que sa connaissance de la vie de Munch dans tous ses recoins ne l’aide pas à trouver de filon unificateur dans son œuvre, qui garde son opacité. Il voue à son compatriote une admiration sans borne, place Le Cri au niveau de Guernica de Picasso ou des champs de maïs de van Gogh, mais face à ses toiles extraordinaires quelle vie inintéressante. Il est toutefois frappant que Knausgaard soit l’un des rares à ne pas mentionner qu’au milieu de sa vie, en 1908, Munch ravagé par l’alcool s’effondre, pour être traité pendant huit mois dans un institut psychiatrique, avant de retourner s’isoler en Norvège pendant les 35 dernières années de sa vie. Il passe vite sur ces pérégrinations européennes d’avant 1908, qui lui ont permis de côtoyer des personnalités comme Delius ou Strindberg et de découvrir avec éblouissement grâce aux milieux littéraires allemands l’œuvre de Nietzsche ; c’est l’époque si déterminante à tout point de vue que décrit Stefan Zweig dans les premiers chapitres du Monde d’hier (où il mentionne sa découverte de Munch au tournant du siècle).

*
Knausgaard regarde plutôt évoluer le style de Munch. Il est clair qu’en suivant son œuvre sur plus de soixante ans, depuis ses tâtonnements symbolistes jusqu’aux paysages et portraits qui viendront après les scènes d’angoisse, c’est toute une vie qu’il observe. Il prend soin au moins de rappeler que Munch ne fera jamais rien d’autre que peindre (« life as painted reality »), qu’il n’aura jamais d’emploi, pas de famille ni de compagne permanente, conséquence en partie de sa peur des femmes, « comme moi-même » confesse Knausgaard. Conséquence aussi du goût d’une vie libre que lui a laissé sa fréquentation à l’adolescence d’un groupe d’anarchistes d’Oslo qui voulaient sortir la Norvège de son puritanisme. Comme Ibsen, Munch a exprimé avec force les passions réprimées dans une société qui s’apprêtait parmi les premières à faire avancer la cause des femmes. Il les a peintes libres, épuisées par le plaisir comme dans Le Lendemain ci-après, amoureuses comme dans Le Baiser.

Dès qu’on regarde un peu l’aube de sa vie, on n’est pas étonné que ses tableaux ne soient guère une invitation à la rêverie, que pendant longtemps l’anxiété y ait suinté de partout, que les personnages ne se regardent pas, semblent effarés par la nature qui les entoure. La tuberculose lui a ravi sa mère à cinq ans, puis sa sœur adorée Sophie à treize ans. La benjamine, dépressive en bas âge, sera internée à vingt ans pour la vie. Meurt ensuite son frère cadet, et quand il a trente-deux ans son père, médecin évangéliste qui soignait les pauvres gratuitement, un peu comme Jacques Ferron au Québec. Il lui restera ses deux sœurs cadettes, dont Inger qu’il a peinte magnifiquement dans une toile dont les premiers spectateurs se sont gaussés, tant Munch déjà ne perdait pas son temps avec les détails. De Sophie il réalisera dix ans après sa mort un portrait sublime, qui sera aussi l’objet de risée. Commune à ces deux toiles qui précèdent les œuvres célèbres des années 1890, la présence lumineuse du visage au détriment de tout le reste, l’un rempli de dignité, l’autre d’un espoir naïf.

L’Enfant malade (1885-1886) est le tableau le plus souvent mentionné dans So Much Longing. C’est une œuvre charnière où éclate un conflit esthétique : elle appartient encore à l’univers réaliste parce qu’elle nous fait observer une scène, mais elle est chargée d’un coefficient d’émotion très élevé parce que Munch y fait revivre un moment intense qu’il a vécu. Il veut être au plus près de la réalité, mais ne fait déjà plus confiance au réalisme. Sa solution dans les années suivantes sera de ramener la représentation entière du réel à l’émotion ressentie, par la voie de grands thèmes emblématiques, comme la jalousie ou la mélancolie.
Puis il reviendra à l’observation. Sans pour autant renoncer à la négligence qui saute aux yeux dans L’Enfant malade : les couches successives de l’œuvre y sont visibles comme si un livre était publié avec ses ratures et surcharges, sans cacher le brouillon derrière. C’est un aspect fondamental de son art, explique Knausgaard : le côté bâclé de beaucoup de ses toiles, avec les gros aplats de couleurs et la couche mince de peinture qui reste après tous les changements. Il rappelle que les spectateurs riaient, littéralement, quand la toile a été exposée pour la première fois, parce que, si la composition était irréprochable, le peintre s’était attaqué à un sujet solennel avec des moyens d’amateur (regardez les mains). Ils ont crié que le roi était nu ; ils n’avaient pas compris que Munch voulait déshabiller le roi. Avant les chefs-d’œuvre expressionnistes, L’Enfant malade montre quelque chose d’ouvert, une zone fluide entre l’espace réel et l’espace peint, tout près de l’acte de peindre, puisque le manque de fini a la vertu de nous renvoyer au moment où l’œuvre a été réalisée. Cette désinvolture dans l’exécution n’est peut-être pas étrangère à l’intérêt de Knausgaard l’écrivain, qui partage avec Munch l’idée d’entreprendre une œuvre sans cérémonie, puis de continuer sans s’arrêter.
C’est la ligne maîtresse du livre : Munch a enlevé le vernis de la peinture traditionnelle. Le filon unificateur que cherche Knausgaard n’est peut-être rien d’autre que ce relâché d’ordre purement formel, cette indifférence pour la finition qui traverse son œuvre. Il pointe du doigt le trait de couleur rousse sur la bordure droite du Cri. Dans Le Baiser, Munch a fait fi des singularités des deux visages. Des décennies plus tard, il suspendra ses toiles à des branches d’arbre sur son terrain pour les exposer aux intempéries. Il a déverni d’un bout à l’autre, jusque dans la dernière toile que commente Knausgaard, Peintre près du mur de la maison, exécutée à 78 ans, où il se livre au pur plaisir de peindre. Cent ans avant lui, Goya vieux avait fait ce genre de travail brut et spontané en peignant à coups de traits grossiers, en teintes sombres, directement sur les murs de sa maison, les visages effrayants, à peine esquissés, de ses peintures noires, non pour croquer des scènes de village, il s’en faut, mais pour montrer le monde halluciné de ses rêves. Il avait cessé de « travailler comme sur la mer rame un galérien, avec fureur, avec impuissance », pour emprunter les mots de Pierre Michon, et laissait maintenant tout venir d’un coup, loin de l’académisme – ce que Munch a fait toute sa vie, comme si Goya avait été son précurseur. Malheureusement, Knausgaard ne remonte pas loin en amont de Munch.


*
La renommée des toiles légendaires de Munch a neutralisé l’émotion puissante qui s’en dégageait au début : on ne les voit plus, on sourit devant des œuvres hantées par le désespoir ou le malheur. Or Munch cherchait à rapprocher le spectateur des œuvres. Quand il est mort dans son lit une fin d’après-midi, il était en train de lire Les Possédés de Dostoïevski, son âme sœur dans le royaume du manque de fini. Ce n’est pas l’homme repenti de Crime et châtiment qui l’intéressait, mais le maître en intensité, la description d’états d’âme qui correspondaient à ses propres obsessions, tout ce qu’il a montré dans ces gens « qui souffrent et qui aiment », selon son expression. Leurs œuvres à tous les deux ébranlent la stabilité de l’espace social, comme celle de l’autre grand Norvégien, Knut Hamsun, qui rapportait le monde entier à son narrateur affamé. Les comparant à Flaubert, Knausgaard fait remarquer que le monde qui entoure Emma Bovary est préservé dans son équilibre après son effondrement, tandis qu’eux trois nous laissent avec des émotions brutes. Sans doute que Munch aurait fait entrer le spectateur dans la même pièce qu’Emma, fermé l’espace autour d’elle, tout comme dans Le Cri le temps avale tout, le ciel, le fjord, le sol, les montagnes, en les subordonnant à la douleur de la personne qui crie ou entend un cri, dans le moment présent, sans échappée possible. En abolissant à la fois l’espace à l’intérieur du tableau et la distance entre le tableau et le spectateur, ses toiles cessaient d’offrir le réconfort de l’espace rassurant de la peinture traditionnelle.
*
Le livre aborde beaucoup d’autres points, notamment l’œuvre graphique de Munch où plusieurs voient la plus vive manifestation de son génie. Il a réalisé des milliers de dessins et d’estampes, dont des gravures et surtout des lithographies, certaines célèbres. Knausgaard le voit comme un contemporain : le coté direct, simple, cru de ses toiles appartient à notre époque. À travers ses rencontres, il découvre que plusieurs artistes actuels se réclament de lui directement. Stephen Gill enfouit ses photographies dans le sol pendant quelques jours, comme Munch accrochait ses toiles dehors. Anselm Kiefer, qui juge beaucoup de ses tableaux faibles mais reprend sans fin comme lui le motif des arbres et des forêts, cherche dans ses sculptures à reconquérir l’espace que Munch a aboli – et qui a disparu de notre monde où tout est près de nous – en le peuplant d’objets de toutes sortes sans aucune présence humaine. La Norvégienne Vanessa Baird fait exactement le contraire : elle figure dans ses tableaux inspirés de thèmes aussi sombres que chez Munch, mais bien plus provocants, une foule de monde, dont des enfants. Peter Doig refait du Munch à sa manière un siècle plus tard, et sa dette est nettement visible dans certains tableaux. C’est un aspect remarquable du livre que de montrer à quel point l’influence de Munch pèse encore lourd aujourd’hui.


♠
Notes. L’ouvrage a été traduit du norvégien par Ingvild Burkey. Peter Watkins a réalisé sur la jeunesse de Munch un superbe film (1974) qu’Ingmar Bergman a décrit comme « une œuvre de génie ». Malheureusement disparu de YouTube. – Novembre 2022. Le livre vient de paraître en français sous le titre Tant de désir pour si peu d’espace : l’art d’Edvard Munch, chez Denoël.