Je ne savais pas trop quoi penser il y a quelques années en lisant la Lettre à la France que l’essayiste québécois Pierre Vadeboncoeur (1920-2010) avait annexée à ses Trois essais sur l’insignifiance, en 1983. Il disait éprouver en marchant sur le sol français une sensation d’adhérence, un lien entre le sol et ses pas, au point qu’il avait l’impression d’y découvrir la source même de son être. C’est une expérience qu’il n’avait vécue nulle part ailleurs en Europe, celle d’un exilé qui, la toute première fois qu’il avait mis le pied en France, s’était senti « de retour ».
Sur les pavés d’Amsterdam, il se serait décrit comme un élève en train de goûter au plaisir d’apprendre des choses. Mais à Paris il se découvrait un lien presque ontologique avec le pays qu’il visitait. Il vivait l’expérience d’une amitié retrouvée à travers ceux qui dans l’histoire et la littérature lui ont procuré sa nourriture intellectuelle, autant qu’il sentait une présence l’accompagner à travers la langue, l’architecture et ses propres ancêtres. Il s’y retrouvait au-dedans de son histoire. Tandis que chez lui en Amérique, il se voit comme un Français largué sur un continent qui lui reste étranger. C’est une préférence personnelle, mais qu’il qualifie d’absolue.
*
Quelques années plus tard je lis les Trois essais sur l’insignifiance, dont les plus de cent pages forment une sorte d’introduction à la courte lettre à la France annexée à la fin. Le livre me tombe des mains. C’est l’une des charges américanophobes les plus virulentes que j’aie jamais lues. Paul Léautaud a écrit dans son Journal en 1942 que « les Américains n’ont rien en commun avec nous spirituellement ni socialement », pour Vadeboncoeur ils n’ont rien, point. Il dénonce sans plus de nuances « la stupéfiante atomisation que la culture américaine exerce sur la conscience d’un être, laquelle dès lors ne contient plus guère qu’une sorte d’agrégat d’idées inertes » (je souligne).
Dans un rare passage charitable, il reconnaît qu’il y a une bonne Amérique, qui se pose des questions, du moins « à ce qu’il paraît » ̶ mais ça ne dure pas longtemps. Ligne suivante, il ajoute qu’au fond la bonne et la mauvaise Amériques reviennent au même : les deux ignorent toute quête de sens. S’il concède que les États-Unis renferment une panoplie de richesses à tous les niveaux, il y constate un profond « déficit de civilisation », causé par une « absence de métaphysique, de morale, d’esprit, de spiritualité, une incroyable médiocrité » (je souligne).
Voilà réglé le cas des États-Unis. « Culture américaine » est un oxymoron. La réflexion et la métaphysique relèvent des compétences de l’Europe, et surtout de la France, Paul Claudel, Simone Weil, etc. De son côté, l’Amérique gesticule, magasine, vole, tue, mais ne réfléchit pas.
On a là deux fantasmes, ou deux métaphores : une France idéalisée et une Amérique noircie à travers une vision presque satanique. Les trois essais examinent le fameux polar noir de James Cain, Le facteur sonne toujours deux fois, livre paru en 1934 et qui a inspiré L’étranger à Albert Camus, l’installation The Dinner Party de Judy Chicago montée en 1974-1979, et enfin un happening violent survenu dans une résidence privée à Harlem en 1933 et dont a été témoin Julien Green. Le roman de Cain raconte une histoire de meurtre dans un style glacial. Ses personnages sont des ignares, des ambitieux sans morale, des damnés assoiffés d’argent. C’est une littérature brutale, sans âme, où se succèdent une série d’actes, hors de toute réflexion. Alors que chez Camus – chez l’Européen – le récit devient un appel, assume une gravité, cherche une lueur d’espoir, Cain affiche la même attitude face à ses personnages que ceux-ci face à la vie : il raconte comme eux agissent, sans aucune distance ni recul, de sorte que son histoire n’éveille aucun écho d’aucune sorte. Vadeboncoeur a beau reconnaître que Le facteur sonne toujours deux fois est un roman parmi d’autres dans la littérature américaine, peu lui importe, le livre décrit un monde sans âme et pose selon lui le bon diagnostic. Dans la table féministe de Judy Chicago, il ne voit que de la politique de mauvais goût, une œuvre militante entièrement tournée vers l’action et qui utilise sans ironie des moyens liturgiques (c’est un autel) à des fins antispirituelles. Sa critique n’est pas surprenante quand on connait son allergie viscérale au postmodernisme. L’œuvre, trop esthétique et pas assez humaine à son goût, pure installation visuelle dépourvue de pensée, assoit à la même table entre autres La reine Élisabeth et Emily Dickinson. Œuvre controversée, mais qui a suscité beaucoup d’admiration.
Dans la table féministe de Judy Chicago, il ne voit que de la politique de mauvais goût, une œuvre militante entièrement tournée vers l’action et qui utilise sans ironie des moyens liturgiques (c’est un autel) à des fins antispirituelles. Sa critique n’est pas surprenante quand on connait son allergie viscérale au postmodernisme. L’œuvre, trop esthétique et pas assez humaine à son goût, pure installation visuelle dépourvue de pensée, assoit à la même table entre autres La reine Élisabeth et Emily Dickinson. Œuvre controversée, mais qui a suscité beaucoup d’admiration.
Le happening de Harlem est aberrant, c’est le moins qu’on puisse dire. Vadeboncoeur y voit le plaisir de déclencher une bagarre aveugle à coups de poing, sans aucune autre idée chez les participants que de sortir de l’univers du désir pour vivre dans l’acte, de commettre une action non préconçue, basée sur des valeurs purement extérieures : éclat, vigueur, violence. Pour cette soirée, soit. Mais c’est un cas extrême. N’est-ce pas un peu comme si le hasard me faisait assister à une fête privée des Hells Angels et que j’en tirais des conclusions sur l’ontologie des Québécois ?
Pour lui, l’important est que Cain, Chicago et les fêtards de Harlem révèlent une civilisation sans nourriture spirituelle, tournée vers le vide, face à une Europe qui elle « ne s’est jamais affranchie de la juridiction de la vérité » et qu’il juge incapable d’inculture. Affirmation qui soulève mille questions.
Dans une lettre du 26 février 1981 à l’écrivain Yvon Rivard (reproduite dans Une amitié libre), donc dans les mêmes années que les Trois essais, Vadeboncoeur explique qu’il ne va « jamais dans la direction du mal, de ce qui fait mal », qu’il refuse de lire la littérature désespérée. À la littérature « on demande du pain, on ne demande pas des pierres », dit-il. C’est pourquoi vingt ans plus tard il applaudira tant Professeurs de désespoir de Nancy Huston. Il va jusqu’à s’interdire de lire Marie-Claire Blais, dont il soupçonne la vision du monde d’être trop sombre à son goût.
Si le noir le rebute autant, que diable est-il allé faire dans la galère de James Cain et compagnie ? La réponse est qu’il allé là où il pouvait en toute sûreté confirmer son préjugé. Dans l’essai sur Harlem, il défie les lecteurs de lui trouver un Teilhard ou une Weil américaines : « Trouvez-moi cette gravité… » Pourquoi avoir ignoré, comme on me l’a signalé, la grande écrivaine Flannery O’Connor (A Good Man Is Hard to Find), catholique comme lui, qui témoigne à sa façon de la vérité dans la civilisation américaine ? Ne connaît-il pas les chefs-d’œuvre de Melville et de Faulkner ? Ces exemples sont criants, et la liste d’autres grands écrivains, poètes, penseurs, essayistes américains serait longue.
On reste pantois quand d’un côté de l’océan il regarde « la France de saint Louis », de l’autre le Texas (p. 38). À ce jeu, on pourrait réduire à rien la culture de n’importe quelle société. Que conclure d’une comparaison entre la littérature américaine actuelle et ce que le critique Juan Asensio appelle depuis une vingtaine d’années « le cadavre de la littérature française » ? Si l’on peut mettre face à face James Cain et Paul Claudel, pourquoi pas Cormac McCarthy et Frédéric Beigbeder ? De toute façon, on ne juge pas un continent entier de façon aussi carrée, et il est étonnant de voir le faire un essayiste à qui André Major a adressé un jour le très beau compliment qu’il avait redonné « une sorte noblesse à la première personne du singulier » (dans une lettre de décembre 1978 reproduite dans Nous retrouver à mi-chemin). Étonnant qu’un esprit aussi exigeant, aussi affamé de culture que lui, ramène la littérature à une affaire de frontières géographiques, tout en repoussant dans un angle mort de grands pans de la réalité et de la culture non seulement américaines, mais québécoises et occidentales, par son rejet de la littérature du mal et sa frayeur devant la noirceur.
*
Cela dit, le livre contient des moments forts ; après tout, c’est du Vadeboncoeur, c’est-à-dire une sensibilité en quête d’élévation. Ce sont les moyens qu’il emploie qui sont douteux, comme si les dés étaient pipés. Car sa démarche est étrange : il ne tire pas de conclusions à partir de cas observés, au contraire il examine en long et en large trois cas soigneusement choisis pour illustrer l’idée partiale et toute faite qu’il a de la culture américaine. Au bout du compte, ses exemples sont trop singuliers pour être convaincants. Néanmoins ils lui servent à développer une critique très juste qui revient souvent dans ses écrits : l’absence d’une quête de sens, de tragique et de la possibilité de se dépasser qui mine nos sociétés. Les Trois essais ne sont donc pas un hapax dans son cheminement. Certains passages reprennent passionnément ces interrogations, cette soif de lumière chez lui, dans un monde qu’il juge sorti du champ de la culture, où l’âme – car la culture est « le culte de l’âme » – ne voit plus nulle part son reflet parce qu’elle n’est plus qu’un œil physique « tourné vers le dehors », alors que « les seules choses qui vaillent, ce sont celles qu’elle substitue, depuis une source que nous ne connaissons pas, aux réalités immédiates présentes à nos appétits » (je souligne). Cette noble et poignante vision ne soutient toutefois en rien son jugement expéditif sur la culture américaine.
Le livre n’est pas à la hauteur des œuvres charnières qu’avaient été en 1963 La ligne du risque (une œuvre majeure à tout point de vue) et en 1978 Les deux royaumes (où, cinq ans avant les Trois essais, il prenait ses distances avec la vie d’engagement social et politique qui avait été la sienne pendant des décennies), ou même de celles qui suivront comme L’humanité improvisée en l’an 2000 et ce bijou de réflexions sur la forme que sont les Fragments d’éternité, écrit quelques semaines avant de mourir en 2010.
*
Vadeboncoeur condamne sans appel le matérialisme qui règne aux États-Unis. On peut concevoir que sa vision de « l’Amérique » vaut pour tout l’Occident. D’ailleurs, dans un numéro spécial de la revue L’Inconvénient publié il y a trois ans, j’ai été frappé de voir l’experte Isabelle Daunais consacrer un article entier à l’essai de Vadeboncoeur sur Cain, sans faire la moindre allusion à l’antiaméricanisme qui suinte de partout dans ces pages, sinon pour le diluer à l’échelle de l’Occident (« le roman très occidental et très américain de James Cain »). Mais c’est sur l’Amérique et seulement sur l’Amérique que tire Vadeboncoeur, jamais sur l’Europe, encore moins sur la France qui est sa bouée de sauvetage. Ce qui laisse en suspens une énorme question, car si l’américanisation de nos sociétés a désormais privé de sens, de tragique et de dimension spirituelle l’ensemble de l’Occident, et réduit notre conscience à tous à « un agrégat d’idées inertes », à quoi peut-il bien servir de repoussoir ?
Comme Pierre Vadeboncoeur évoluait depuis un bout de temps à la fois dans les deux « royaumes » , on peut se demander si malgré un certain désabusement dans celui très prosaïque où nous passons le plus clair de notre temps, il ne continuait pas dans les Trois essais sur l’insignifiance à faire de la politique tambour battant, comme il le fera à nouveau en 2008 dans Les grands imbéciles. En 1983, d’un côté il appréhendait une crise profonde de la société, voyant progresser autour de lui un désert spirituel fait de matérialisme brut. De l’autre, il avait peut-être décidé de ferrailler avec l’ennemi en traitant cette crise spirituelle comme une affaire politique, car à tout bout de champ dans le livre on a l’impression qu’il est sur le point d’appeler les États-Unis « l’Empire du mal » – l’expression que Ronald Reagan employait de façon lancinante dans ces années-là pour décrire l’URSS. C’est typique : l’ancien militant qui cherche de l’air dans l’autre royaume, mais n’est pas encore prêt à lâcher le morceau dans le premier.
♠
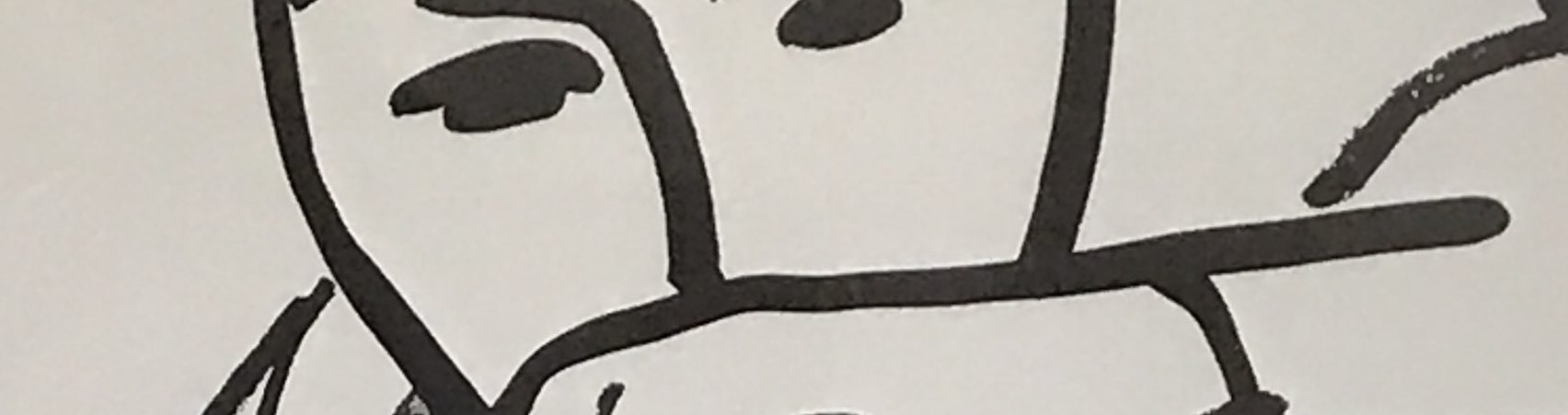
Excellent Jacques!
J’aimeAimé par 1 personne