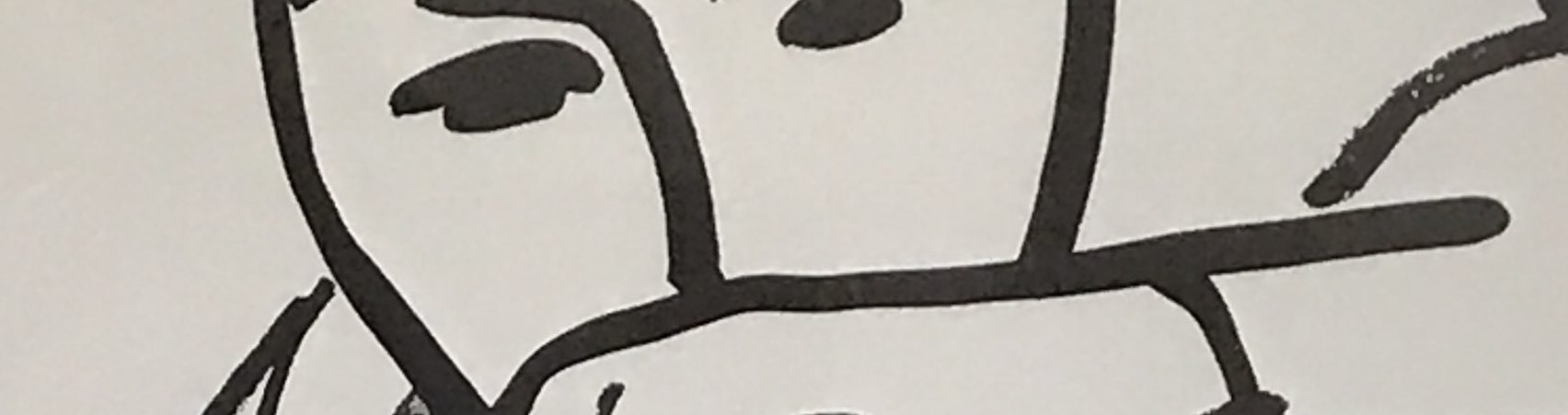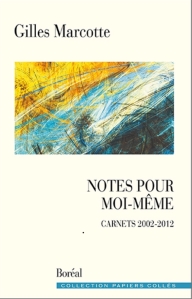
J’ai entamé ces Notes à contrecœur parce que les écrits de Marcotte m’ont souvent rebuté. Des louanges ou des condamnations exagérées, des idées carrées, une façon expéditive et peu convaincante d’aller au fond des choses, des opinions politiques qui ont de quoi vous envoyer les sourcils en orbite autour de la tête.
*
Il avait fait dans Le ciel de Québec de Ferron une apparition caméo qu’il n’avait pas dû priser. Il s’est vengé plus tard, un peu en conflit d’intérêts, par une analyse négative du « Pont », sublime conte où Ferron décrit l’aller-retour sur le pont Jacques-Cartier d’une vieille Irlandaise qui va vendre dans le Vieux-Montréal le bric-à-brac empilé sur sa charrette. Il lui reprochera de décrire l’aller comme un trajet morne, et le retour vers le vieux Longueuil, encore un village à cette époque, comme un trajet grandiose sous la « cathédrale » des poutres d’acier du pont. Sa conclusion : Ferron rejette la vie moderne. Sauf que le pont Jacques-Cartier est fait comme ça.
*
Un des mérites de ces Notes est que Marcotte n’a pas la langue dans sa poche. En fait, elle est un peu coincée dans celle de Paul Claudel, qui pour lui est le grand écrivain français du 20e siècle. Régis Debray a annoncé il y a deux semaines que le géant français, c’est Julien Gracq. Ces proclamations : des poignées de confettis lancées un lundi matin pendant que tout le monde est occupé.
*
Il nous donne quand même envie de lire le Journal de Claudel, dans lequel il était déjà plongé au début des années 80, selon les premières pages des Livres et les jours (1983-2001). Il n’explique nulle part cependant en quoi consisterait la grandeur de Claudel. Il cite quelques quelques réflexions remarquables, ne cesse de réaffirmer qu’il l’admire, mais en s’en tenant presque exclusivement à son Journal. Il parle à peine de son théâtre et de sa poésie.
*
Il fait passer un mauvais quart d’heure à beaucoup d’écrivains. Todorov n’est « pas très fort », son livre est « platement écrit ». Daniel Pennac est « plat ». Falardeau, c’est « la grossièreté à la puissance maximale ». Nelly Arcan frappe par « la pauvreté de sa phrase, de ses idées ». Il dit « la pauvre Marie Laberge ». Sans parler de VLB, « le Pistolois pas très intelligent », de Gaétan Soucy représentant le Québec à Paris « peu brillamment », de Georges Leroux respecté mais qui « écrit lourdement ». Entre deux messes dominicales, il juge aussi Saint-Saëns d’une vulgarité totale, Bernanos superficiel, Stéphane Baillargeon auteur d’articles stupides (« le Josée Blanchette des affaires religieuses »), Foglia parfois digne de Le Pen par sa grossièreté, Sartre cassant, querelleur et excessif, Atwood dépourvue de style, le rock une « saloperie ». On ne s’ennuie pas.
*
Quand il cite la journaliste Odile Tremblay puis ajoute : « Il y a beaucoup de neuf dans ces quelques lignes », l’euphémisme est savoureux. Il relève des perles dans Le Devoir, « cette feuille de chou », pour montrer « comment on écrit au Québec ». Il ne ménage pas l’animatrice de Plus on est de fous, tire à boulets rouges sur les émissions culturelles, La Culture pour les nuls (« Les nuls y étaient »), La Bande des six (« Aucun d’entre eux n’avaient la moindre idée de ce qu’est la critique »), les fameux Combats des livres (« J’ai rarement entendu autant de sottises en si peu de temps »).
*
Ses jugements sur la littérature québécoise sont cinglants. Il la trouve « engluée dans les bons sentiments communautaires », écrite « dans un français travaillé, on oserait dire torturé, qui n’a d’équivalent dans aucun autre pays connu ». En 2011, il la décrit comme « une extension assez maladroite de la littérature française ». Bilan étonnant de la part d’un des plus grands connaisseurs de la littérature québécoise – après toutes ces décennies, ces tonnes d’articles, toute sa vie plongé dans les œuvres québécoises.
*
Avec le temps, son attitude critique s’est transformée en impatience rageuse. Dans Les livres et les jours, il portait un jugement aussi sévère, mais technique. Charcutant phrase après phrase quelques paragraphes d’un supposé grand écrivain québécois qu’il ne nommait pas, il concluait : « Ce n’est pas le joual qui menace la langue française. C’est l’impropriété des termes, l’imprécision, la surcharge, la surabondance des clichés, la déglingue de la syntaxe. » Dans ses dernières Notes, il ne fait plus aucune concession.
*
Il envie les célibataires qui seuls d’après lui peuvent écrire un journal intime. Mais au fond c’est une question de tempérament, puisqu’il avoue qu’il ne pourrait même pas parler de ses amis. Il a dit ailleurs, naïvement, qu’écrire un journal intime, c’est « mettre ses tripes à nu ». Jean-Pierre Martin évoque cette fausse pudeur dans Le livre des hontes, en rappelant que la confidence la plus intime peut n’être qu’un paravent qui masque d’autres secrets inavouables.
*
Il déteste le journal de Léautaud, dont il trouve le style « mesquin ». La langue de Léautaud est pourtant lumineuse, page après page. Il faut dire que Léautaud, jeune ou vieux, est d’une franchise totale : sa vie sexuelle, ses rêves incestueux, ses portraits acides, sa condamnation de la littérature fabriquée. Marcotte trouvait sans doute le personnage scandaleux. Il vénère avec raison le journal de Green et aime celui de Gide, les deux pourtant arrangés avant publication.
*
Peut-être qu’il a la carapace trop dure pour donner dans l’intime. Il n’est pas l’homme de l’ivresse. Il reste un observateur terre à terre, distant, plus ou moins en harmonie avec son milieu. Deux fois, il dit être avant tout « un journaliste », et comme un journaliste les sujets qu’il aborde sont plus intéressants que le personnage lui-même.
*
On le voit quand il parle de musique. Les grands compositeurs, Bach, Beethoven, Schubert, Messiaen, reviennent toutes les deux pages. Mais il ne donne pas envie de les écouter, on ne sent pas son émotion, il a une manière froide, analytique de décrire ce qu’il entend. Dans un ancien article, pour exprimer l’émotion ressentie en écoutant le Quatuor no 13 de Beethoven (celui avec la Grande Fugue), il s’en remettait à ce qu’en avait dit Saint-Denys Garneau dans son Journal, tout en affirmant que « l’empathie parle plus justement que la petite science ». Mais lui-même en faisait une analyse cérébrale. Pas un mot sur la cavatine.
*
Il a ses admirations. Saint-Denys Garneau, Miron, Anne Hébert, Ducharme, André Langevin, Jacques Brault, Robert Melançon. La palette d’auteurs et de sujets était plus variée dans Les livres et les jours, maintenant elle est plus sélective, et en un sens plus riche. Autant il a examiné dans sa vie des milliers d’œuvres, autant ses lectures de vieillesse (en passant le cap des 80 ans) tournent autour d’une poignée d’écrivains qu’il relit sans cesse : Claudel, Jaccottet, Julien Green, Chateaubriand, Mauriac, T.S Eliot.
*
On pourrait dire de Marcotte ce qu’il dit lui-même du journal de Claudel : qu’il est parfois banal, peu intéressant, auteur de platitudes (« C’est métaphysique, un rhume »), et le lendemain incisif et profond (« La vie n’est pas qu’une entreprise. Il est très important, il est essentiel d’échouer. Que l’on me parle d’une vie pleine, d’une vie donnée, d’une vie déçue, je veux bien, mais une vie réussie, non, je ne veux pas, c’est d’une niaiserie totale »). Internet : « L’âge de l’information ne peut être que celui de l’anxiété. » Croyant pieux, rarement serein, il compare la fragilité de son sentiment religieux à une plume au vent, envie les athées qui l’ont facile, se voit, avec sa foi, comme « le plus démuni des hommes ». Parlant de la peur qui nous paralyse d’écrire certaines choses : « On ne voit que ses yeux méchants, brillant dans le noir. » Et cette idée intéressante que ce qu’on appelle le spirituel dans la vie serait tout simplement un point de surveillance excentré par rapport aux choses ordinaires. Avec lui, on reste en effet dans « la vie ordinaire ».
*
Personne n’a aussi bien décrit la manière Sollers. « Agile, agaçant. À la fin d’un paragraphe : « Passons. » À la fin d’un autre : « Voilà. » Et on passe en effet à autre chose, sans arrêt. L’apothéose de l’esquive. Aucun regret, jamais, aucun repentir, on passe à autre chose, toujours à autre chose. Le négatif est interdit. C’est terriblement lisse. … Je ne m’ennuie pas trop, cependant, j’avale, je continue. … Une question peut-être me retient : comment peut-on écrire comme ça, avec une telle désinvolture, sans que jamais se manifeste un désir plus fort, sinon celui d’écrire, d’écrire sans cesse, sur n’importe quoi ? »
*
Il aime la prose de Baudelaire, au point d’avoir lu deux fois ses œuvres complètes dans la Pléiade, mais trouve sa poésie « corsetée ». Il me semble que dans les Fleurs du mal s’il y a quelque chose qui vole en l’air, ce sont les corsets. Trop impudique pour lui.
*
Tout ce qui évoque le nationalisme québécois lui donne de l’urticaire. Il va jusqu’à récuser les interprétations nationalistes des Anciens Canadiens (le refus de Blanche d’épouser l’Écossais serait un pur artifice romanesque). Il a l’air d’y tenir un peu trop.
*
On compatit avec lui quand, à la fin, il nous cite au complet la lettre insignifiante que lui envoie la ministre Christine St-Pierre pour le féliciter d’un prix. Hashtag avant l’heure, il n’a que ce commentaire : Misère.