Le lire est un travail, presque de bénédictin. Ce serait amusant d’avoir une idée du nombre de phrases qu’on doit relire deux ou trois fois avant d’être sûr d’avoir tout saisi, ou ne serait-ce que pour bien en comprendre la structure. Du côté de chez Swann est quand même encadré à chaque bout par deux petites phrases toutes simples : le riche et légendaire incipit Longtemps, je me suis couché de bonne heure, et à la fin ce joyau : Le souvenir d’une certaine image n’est que le regret d’un certain instant. En dire autant en si peu de mots.
*
Proust est capable de parler d’absolument tout, de tout décrire, et en profondeur. Jusqu’à en donner des frissons au lecteur, bien que lui-même ne semble pas passionné. Mais on dirait que ses moyens n’ont pas de limites. Il suffit de penser à l’évolution de la relation entre Swann et Odette et à leurs caractères tels qu’il les dépeint, à la façon dont il montre comment Swann s’emprisonne petit à petit dans le noyau des Verdurin avant d’en être promptement éjecté. Il pénètre dans tous les recoins de l’âme de Swann, rien dans sa tête et son cœur ne lui échappe, c’est comme s’il l’avait étendu devant lui sur une table de dissection. Et quelle analyse de la jalousie. La seule œuvre qui en approche peut-être est le film El de Buñuel, que Lacan utilisait pour illustrer la paranoïa.
*
Swann, on finit par le trouver un peu niais, presque un reflet du clan des Verdurin. Bien sûr il ne l’est pas du tout. Il faut se mettre dans sa peau : il est en feu. Mais Proust analyse son comportement de façon si tranquille et si subtile qu’on finit par croire que son personnage est une constellation de nuances et de considérations. Cette autre facette de son caractère : son esprit s’obscurcit après un effort qui le mène trop loin, la paresse intellectuelle le rejoint. Comme tout le monde. C’est le narrateur qui est différent de tous.
*
On mentionne moins souvent à quel point Proust est drôle. On éclate de rire à tout bout de champ. Je pense aux bavardages des sœurs Céline et Flora. À la page où on comprend sur le tard pourquoi Françoise avait fait manger des asperges à toute la famille pendant tout un été. Au monocle du monsieur qui, dans le salon de la marquise de Saint-Euverte, « avec sa grosse tête de carpe … avait l’air de transporter un fragment accidentel du vitrage de son aquarium ». Sans parler de l’irrespirable clique des Verdurin. Et des portraits hilarants du baron de Charlus, Palamède de son prénom.
*
Ce qui frappe encore : l’harmonie du style, quel que soit le propos. Et la musique : rien, absolument rien qui choque l’oreille, une douceur constante malgré les vérités assénées page après page. Comme celle-ci : « Dans le commerce des personnes que nous avons d’abord trouvées désagréables, persiste toujours même au milieu du plaisir factice qu’on peut finir par goûter auprès d’elles, le goût frelaté des défauts qu’elles ont réussi à dissimuler. »
*
De la poésie sort de partout. Comme ce passage où il parle des fuchsias de Mme Loiseau, « dont les fleurs n’avaient rien de plus pressé, quand elles étaient assez ouvertes, que d’aller rafraîchir leurs joues violettes et congestionnées contre la sombre façade de l’église » (elle habite juste à côté de l’église). Dans Sodome et Gomohhre, la princesse de Guermantes près de l’entrée accueille l’un après l’autre les invités qui arrivent : « À certains même elle ne disait rien, se contentant de leur montrer ses admirables yeux d’onyx, comme si on était venu seulement à une exposition de pierres précieuses. »
*
« … ne demander en ces moments-là rien d’autre à la vie que de se composer toujours d’une suite d’heureux après-midi ». Fait penser au vers de Malherbe : « Tout le plaisir des jours est en leurs matinées. »
*
Dans le fameux passage de la madeleine, il est fascinant de voir que le souvenir qui fait sentir sa présence est si bien verrouillé dans le passé qu’il résiste à tous les efforts de la volonté. C’est une fois que le narrateur a abandonné la partie que le souvenir surgit tout d’un coup par pur enchantement. On dirait une façon de décrire l’inspiration littéraire. – Toujours dans l’épisode de la petite madeleine : le léger avantage des « odeurs » et des « saveurs » sur tout le reste ; la puissance de l’évanescent.
*
Cette remarque discrète, inattendue, faite de façon presque nonchalante, dans La prisonnière, que le voyage est source de déceptions, parce que contrairement au rêve on se transporte toujours soi-même en entier.
*
Il existe encore plein de bourgeois de ce genre, et ce genre d’aristocratie est encore possible : « … une certaine aristocratie … peut s’éviter, car ils ne lui ajouteraient rien, les efforts que sans résultat ultérieur appréciable, font tant de bourgeois, pour ne professer que des opinions bien portées et de ne fréquenter que des gens bien pensants ».
*
Si la Recherche comptait cent volumes au lieu de sept, je ne suis pas sûr que j’aurais envie de lire autre chose.
*
Selon Julien Gracq, si Proust n’a pas eu de descendance littéraire directe, ce n’est pas parce qu’il a créé un monde d’écrivain trop singulier, c’est que son invention capitale a été de doubler « le pouvoir séparateur de l’œil » : sens supérieur de l’observation et accès à des domaines neufs. Autrement dit, il a fait une conquête technique décisive que tous peuvent utiliser. Proust est partout. Soit. Mais quel écrivain a eu une descendance littéraire directe ?
*
Je feuillette un gros volume de sa correspondance. Je lis quelques lettres. Elles me semblent n’avoir rien à voir avec la Recherche. Un peu ennuyeuses même. Dans le roman, il voit à travers les gens, de part en part, ils n’ont plus de secrets pour lui. Le voici maintenant intéressé, tout en politesse avec tout le monde.
*
Un jour, j’écoute Proust en version audio dans la voiture. Le rythme et le ton ne correspondent pas à ce que j’entends quand je le lis. Le récitant met de la douceur là où je perçois un saisissement ou lit de façon lisse un passage qui me prend plus que d’autres, qui m’arrête. Ou le contraire, il se met à accélérer au milieu d’une longue phrase comme s’il craignait de manquer d’air avant la fin, là où j’éplucherais les mots. Plus loin, il termine à voix feutrée, dans un souffle à peine audible, comme si elle se terminait par des points de suspension, une phrase qui ressemble pour moi à la conclusion d’une démonstration, à quelque chose de complet qui est réglé et n’a pas besoin de répit avant de repartir dans la phrase suivante. Je ne vais quand même pas commencer à jouer avec les boutons reculer et avancer. Je ne sais pas si des lecteurs de Proust le lisent d’une façon aussi soutenue, si même c’est possible de le lire comme ça. On s’attarde, comme le lièvre de la fable, puis on repart, et on revient, on se délecte. La réputation surfaite des tortues.
*
Un traducteur du gouvernement m’a confié un jour que, jeune, il avait recopié à la mine de plomb le texte complet de la Recherche, et l’avait fait à nouveau deux autres fois. Puis il est devenu misanthrope. Proust suscite des passions extrêmes.

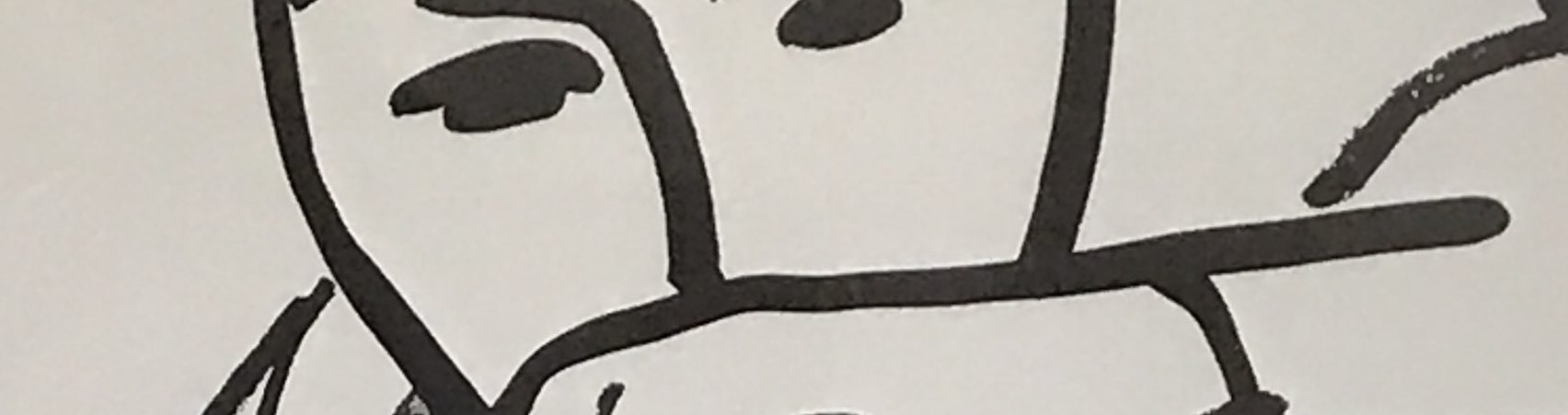
Bon, je vais cesser de vous lire, Jacques. C’en est trop. Vous allez finir par mettre en doute ma sincérité. Pour être cru, je serai cru. Je parlerai avec franchise. Mais plutôt que de dire des méchancetés, sans ambages, je dirai, au risque de me répéter, que je suis très content de fréquenter votre blog. Vous me croyez, j’espère. Venons-en maintenant aux choses sérieuses. Votre page, faites de fragments, est tout simplement excellente, stimulante, très bien écrite. Elle me donne envie de persévérer dans ma lecture de Gracq : il me perd un peu quand il parle de Proust : le « pouvoir séparateur de l’œil » m’aveugle, je devrai y revenir. Et aussi Malherbe. En effet, un très beau vers, comme l’est : « Et les fruits passeront la promesse des fleurs ». Mais coupons court et venons-en à Proust. Vous formulez dans votre bouquet de fragments des observations qui, je crois, ouvrent à la grande diversité de son œuvre, aux différentes directions dans lesquelles elle essaime. Je ne sais pas si je suis clair. Je veux ajouter qu’il n’est pas inutile de rappeler la richesse de la Recherche. Son réalisme (portraits d’individus, aspects psychologiques, mais également sociologiques …), sa poésie, sa drôlerie, etc. Il est vrai également, comme vous dites, que très souvent il faut relire deux ou trois fois les mêmes phrases. Or pourquoi persévère-t-on à lire cette Recherche, si difficile, alors qu’on peut facilement prétendre l’avoir lue, quand en réalité on ne l’a que parcourue, voire jamais lue ? Qui l’a lue ressemble un peu à qui ne l’a pas lue, du moins sur le point suivant : personne ne parvient à en fournir de mémoire un résumé vraiment satisfaisant. Pourquoi lire Proust ? Certainement pas par snobisme ou pour le simple plaisir de relever un défi, genre gravir l’Everest jusqu’à son sommet. Mais la comparaison ici n’est pas sans raison. Rarement auteur n’a pu s’élever aussi haut. Il faut du souffle pour suivre cet asthmatique jusqu’au sommet de sa Recherche.
J’aimeAimé par 1 personne