 Sauf erreur, les Quatre histoires de famille d’Émond n’ont pas fait grand bruit quand elles sont parues en 2022. Peut-être qu’on a regardé le cinéaste comme un intrus qui débarquait dans la cour des grands. Son attention au monde, à la nature, aux gens – bien connue parce qu’il a martelé son credo sur de nombreuses tribunes au fil des années – s’y exprime pourtant de façon aussi juste que dans ses films. Il est certain par contre qu’il en demande beaucoup moins à ses lecteurs, qu’il tient par la main, qu’aux spectateurs, qu’il laisse délibérément troublés. Ses nouvelles n’ont pas du tout l’audace formelle dont il fait preuve dans ses films : leur facture est classique avec de longs flashbacks explicatifs et elles ne cherchent pas l’originalité. Leur qualité est ailleurs.
Sauf erreur, les Quatre histoires de famille d’Émond n’ont pas fait grand bruit quand elles sont parues en 2022. Peut-être qu’on a regardé le cinéaste comme un intrus qui débarquait dans la cour des grands. Son attention au monde, à la nature, aux gens – bien connue parce qu’il a martelé son credo sur de nombreuses tribunes au fil des années – s’y exprime pourtant de façon aussi juste que dans ses films. Il est certain par contre qu’il en demande beaucoup moins à ses lecteurs, qu’il tient par la main, qu’aux spectateurs, qu’il laisse délibérément troublés. Ses nouvelles n’ont pas du tout l’audace formelle dont il fait preuve dans ses films : leur facture est classique avec de longs flashbacks explicatifs et elles ne cherchent pas l’originalité. Leur qualité est ailleurs.
Chacune de ces histoires veut montrer quelque chose, mais ce ne sont pas pour autant des nouvelles à thèse, il y a trop de non-dits derrière les gestes des personnages, à l’image des visages silencieux qu’Émond nous fait observer longuement à l’écran, comme celui grave et réservé de Rose Lemay  dans Une femme respectable, de Katia si malheureuse tout au long du Journal d’un vieil homme (adapté d’Une banale histoire de Tchekhov) ou de François le regard perdu derrière sa fenêtre à la fin de La neuvaine. Avec la même compassion tchékhovienne, il met ses personnages en mouvement autour d’un deuil ou d’une séparation, entre conjoints, parent et enfant, frère et sœur, et les amène tranquillement vers des retrouvailles qui seront lumineuses, difficiles ou impossibles. Elles leur donneront la chance de se réconcilier avec leur destin, et les histoires, toutes tristes qu’elles sont, se terminent assez bien.
dans Une femme respectable, de Katia si malheureuse tout au long du Journal d’un vieil homme (adapté d’Une banale histoire de Tchekhov) ou de François le regard perdu derrière sa fenêtre à la fin de La neuvaine. Avec la même compassion tchékhovienne, il met ses personnages en mouvement autour d’un deuil ou d’une séparation, entre conjoints, parent et enfant, frère et sœur, et les amène tranquillement vers des retrouvailles qui seront lumineuses, difficiles ou impossibles. Elles leur donneront la chance de se réconcilier avec leur destin, et les histoires, toutes tristes qu’elles sont, se terminent assez bien.
Deux d’entre elles racontent ce cheminement à travers des actes de bonté accomplis discrètement. La femme de Mathieu en donne un échantillon remarquable. Anne a planté Mathieu là avec leur fille de quatre ans, qu’il a élevée seul, puis est allée travailler comme infirmière au Nunavik et en Afrique. Mère absente donc, mais avec une telle feuille de route on a compris qu’elle a un bon fond et qu’Émond ne va pas la garder en quarantaine éternellement. Quand elle revient, vieille et gravement malade, pour mourir auprès de lui, Mathieu sera d’une générosité sans bornes, même si le grand amour de sa vie fut sa deuxième femme, une immigrante chilienne avec qui il a vécu pendant trente ans et qui a été fauchée à bicyclette par un chauffard (on voit ici passer le polémiste de Camarade, ferme ton poste). Émond n’étire pas la sauce jusqu’au mélodrame : ses personnages sont lucides, ils savent exactement où ils en sont dans la vie. Le récit est en fait réaliste, Anne par exemple a toujours su ce qu’elle voulait – comme Rose Lemay qui dans le film veut avoir et aura les enfants de son ex – et imposera sa volonté, fermement mais doucement, jusqu’à son dernier souffle.
L’histoire peut avoir l’air arrangée avec le gars des vues, et c’est vrai que le livre est rempli de bons sentiments. En plus, on est tombé sur du bon monde, comme Mathieu et sa fille. Mais c’est précisément le genre de personnes qui intéressent Émond (comme dans ses documentaires, voyez la famille de cultivateurs dans Le temps et le lieu). Ceux qui ont mal tourné, il les retourne petit à petit comme un doigt de gant – pas tous, pas les pères violents de l’ancienne génération par exemple. Mais « la littérature n’est pas une école de vertu », rappelait récemment l’écrivain Patrice Jean. Sauf qu’Émond ne prêche pas, il poursuit une quête humaniste, tournée vers le souci d’autrui, mais terre-à-terre. Les cinéphiles savent qu’il ne met jamais complètement les choses au clair : ses personnages gardent leurs secrets, il respecte leur intimité, n’arbitre pas leurs conflits intérieurs. Car ainsi va la vie. Ce sont des étrangers qu’il ne connait pas, et il cherche à nous faire sortir de nous-mêmes pour aller à leur rencontre (un principe de George Steiner qui lui est cher).
On le voit bien dans Le frère de Françoise, où Émond élève Paul, un junkie que sa sœur ne pouvait plus blairer et dont elle avait tellement honte que ses deux enfants ne sont même pas au courant de son existence. Émigrée aux États-Unis, elle revient au Québec s’occuper de ses funérailles et est stupéfaite de découvrir qu’au fil des ans, pour des raisons qu’elle n’élucidera jamais, Paul était devenu un dévoué bénévole communautaire. Naïf, exagéré ? De la mauvaise littérature faite avec de beaux sentiments ? Non, le récit n’a rien de farfelu, il se déroule dans un monde qu’Émond connait bien, le quartier Hochelaga à Montréal. On peut comparer avec ce que Claudel disait aimer chez Dostoïevski (lettre à Jacques Rivière, 17 février 1912) :
« Vous voyez une crapule, comme dans Crime et Châtiment… qui tout à coup devient une espèce d’ange… C’est cette imprévisibilité, cet inconnu de la nature humaine qui est le grand intérêt de Dostoïevski. L’homme est un inconnu pour lui-même et il ne sait jamais ce qu’il est capable de produire sous une provocation neuve. »
Paul n’a été ni une crapule ni un ange comme le montre la suite, mais les écarts sont toujours moins grands au Québec, où passer de junkie à bon gars est déjà quelque chose. Françoise elle-même retournera aux États-Unis pantoise. Elle aura des choses à raconter à ses enfants sur sa vie au temps du Québec – mais en anglais, parce que le français est du chinois pour eux.
*
La question de la langue, qui est absente à ma connaissance des films d’Émond et peu présente dans ses nombreux articles, colore le recueil. Au point qu’on peut se demander s’il n’est pas passé à l’écrit justement pour l’aborder. Dans trois des quatre histoires, plusieurs conversations se déroulent en anglais. Le livre s’ouvre sur une citation d’Hector Bianciotti qui songe qu’on peut vivre les émotions de façon différente d’une langue à l’autre. Et il se clôt sur l’histoire du nationaliste Charles qui attend à l’aéroport de Montréal sa petite-fille Zhu, adolescente sino-canadienne, qu’il va rencontrer pour la première fois et qui ne parle pas un mot de français. Le grand-père comprend qu’il va devoir faire d’énormes concessions, sinon comment vont-ils pourvoir se parler ? Zhu avec ses textos émaillés de « Grampa! » est remplie de joie à l’idée de le rencontrer, mais l’horizon linguistique l’est moins.
Cette nouvelle, Le grand-père de Zhu, détonne dans le recueil. Alors que les trois autres bouclent leur histoire, celle-ci a une fin ouverte : on ne sait pas ce qui va arriver. Elle est courte, le fossé des générations y est un abîme, l’intrigue un peu carrée, on ne sent pas la chair palpiter. C’est une nouvelle d’idées si l’on veut. Mais Émond, à bout de patience devant les assauts que subit le français, se défoule et passe un gros surligneur sur le fragile destin linguistique des Québécois. S’il a racheté le frère de Françoise et la femme de Mathieu, il est sans pitié pour le fils de Charles (et père de Zhu), dont il brosse un portrait décapant. Le jeune s’est tellement anglicisé à Toronto qu’il revient manifester dans les rues de Montréal pour le camp référendaire du NON en 1995, tout en parlant avec désinvolture un français intermittent. Mettons qu’il n’est pas particulièrement sympathique. Émond refuse toutefois de désespérer, d’où la fin ouverte, et semble se résigner à une sorte d’optimisme mélancolique – qui sait si l’enthousiasme de Zhu ne va pas brasser les cartes.
*
Le recueil est parsemé de repères locaux qui ajoutent une dose de lyrisme, tout en rendant hommage à la beauté de la nature, du fleuve, de la neige. Passent devant nos yeux le Saint-Laurent à des moments charnières du récit, la Gaspésie, les tempêtes de neige, l’Outaouais, Sudbury, l’île aux Coudres, Petite-Rivière-Saint-François (emblématique dans ses œuvres), sans oublier l’accent acadien, les tourtières et l’installation des pneus d’hiver. Ces repères servent à bien accrocher les histoires au territoire, au réel, et du même coup rappeler l’importance du lien avec le passé. L’évocation du Nord permet à Émond de souligner, encore une fois, la fragilité de la culture qu’il tient à appeler « canadienne-française », terme qui rend mieux compte selon lui de la diaspora des francophones d’Amérique.
Diaspora habilement mise en scène dans Le fils de Doria, jusqu’à Hearst dans le Grand Nord ontarien où il la voit en train de mourir. Je vous laisse en découvrir la trame, qui tourne cette fois autour d’un père absent. Deux passages méritent d’être signalés : la tempête de neige qui se lève pendant que son protagoniste, Paul, marche sur la voie ferrée qui longe le fleuve dans la région de Charlevoix, et son  voyage ensuite au fin fond de l’Ontario (comme dans son film Pour vivre ici, on couvre beaucoup de territoire), où il apprendra l’existence d’un demi-frère adopté dès l’enfance par un mennonite ukrainien – clin d’œil sans doute aux mennonites et doukhobors russes dont a parlé Gabrielle Roy. Sa façon toute simple de raconter les choses lui permet d’amener des passages touchants sans forcer la note. Paul est au chevet de Doria, mère de son demi-frère, qui ne reconnait plus personne. La fille de Doria, Brenda, demande à Paul de chanter, dans l’espoir d’éveiller son souvenir dans l’esprit de la vieille :
voyage ensuite au fin fond de l’Ontario (comme dans son film Pour vivre ici, on couvre beaucoup de territoire), où il apprendra l’existence d’un demi-frère adopté dès l’enfance par un mennonite ukrainien – clin d’œil sans doute aux mennonites et doukhobors russes dont a parlé Gabrielle Roy. Sa façon toute simple de raconter les choses lui permet d’amener des passages touchants sans forcer la note. Paul est au chevet de Doria, mère de son demi-frère, qui ne reconnait plus personne. La fille de Doria, Brenda, demande à Paul de chanter, dans l’espoir d’éveiller son souvenir dans l’esprit de la vieille :
« La première chose qui lui vint en tête fut À la claire fontaine. Paul se mit à chanter, très doucement. Au bout du deuxième couplet, il ne se rappelait plus les paroles, mais il continua à fredonner. Lorsqu’il s’arrêta, il se rendit compte que Doria avait repris la mélodie, comme dans un murmure. Cela dura quelques instants, puis elle se tut. Brenda hocha la tête et sourit. Doria ferma les yeux, retomba dans son absence. Il ne se passa plus rien. Ils restèrent jusqu’au carillon qui sonnait la fin de l’heure des visites, puis ils partirent… »
*
On voit que le style est tout en retenue. Jamais d’envolées ni de fioritures, et c’est un point commun avec ses films : ses phrases sont aussi dépouillées que ses images (phrases courtes, pas beaucoup d’adjectifs). Elles se déroulent comme une longue observation, qui nous montre par exemple Françoise découvrant la vie de son frère en même temps que nous. Émond avance en quelque sorte à côté de ses personnages, comme dans un travelling, en les observant chercher une paix intérieure à travers leurs souvenirs. À l’écran, il les prend de face parce qu’ils sont angoissés et nous laisse le temps de sentir leur tension vibrer en nous, sans nous bombarder d’images. Pas de papotage, peu d’images. Ces moments de silence sont puissants dans ses films : la caméra s’immobilise devant un personnage, et le scrute d’un œil aussi attentif qu’il est humainement possible de le faire sans prétendre pénétrer ses secrets. Comment faire quand on passe à la littérature ? Le silence de l’image, avec le recueillement intérieur qu’il exprime, est irremplaçable par des mots. La solution d’Émond a été de s’en tenir à la succession brute des faits, des actions, décisions, déplacements, conversations, courriels, qui vont toujours droit au but et font avancer le récit, comme il se doit, un peu à la manière de Hemingway :
« Je l’ai remerciée et je suis allée au village chercher quelques provisions. Du vin. Et une bouteille de scotch. Quand je suis redescendue à la cabine, le jour baissait déjà. J’ai allumé le chauffage, je me suis enroulée dans une couverture, je me suis assise sur le lit, et j’ai bu. Il faisait noir quand je me suis mise à pleurer. J’ai pleuré longtemps. J’ai pleuré mon père, j’ai pleuré ma mère, j’ai pleuré mon enfance. J’ai pleuré mon frère. J’ai pleuré tout ce qui était perdu. Puis j’ai continué à boire. Le vent s’est levé. La marée était haute et les vagues venaient mourir tout près de la cabine. Je suis sortie avec ma bouteille. Je me suis couchée sur le sable. J’ai bu. Il faisait froid. Le ciel était dégagé. Il y avait trop d’étoiles. J’ai eu un vertige. Derrière moi, la lune se levait. Je pense que j’ai vomi. J’ai dû m’évanouir.
C’est la femme d’Eddy qui m’a réveillée. C’était encore la nuit.
— Vous pouvez pas rester là, vous allez geler.
Elle m’a aidée à me lever et m’a ramenée dans la cabine. Elle m’a mise au lit. Je tremblais comme une feuille. Elle est allée chercher d’autres couvertures. Elle m’a passé une serviette humide sur le visage. Il me semble qu’elle m’a dit :
— C’est fini, là. C’est fini.
Mais c’était peut-être ma propre voix. »
L’erreur aurait été de passer le relais à un narrateur qui aurait philosophé sur les actions des personnages, ce qui serait allé à l’encontre de sa propre conception du rapport aux autres. La narration suit plutôt une ligne claire et ordonnée, elle a quelque chose d’austère qui ne génère pas de tension comme dans ses films, mais crée une lenteur qui n’est pas sans rappeler leur rythme. En refusant le zèle d’un narrateur bavard, Émond ne lâche pas ses personnages d’une semelle, ce qui leur donne de la présence sur la page. Cette lenteur est remarquable dans les derniers paragraphes de La femme de Mathieu, et dans la fin magnifique du Fils de Doria, où Paul vient de découvrir les restes d’un cimetière de ses ancêtres à plusieurs kilomètres de la route au fin fond d’un bois :
« Il s’assit sur le tronc d’un arbre mort. Il était loin de tout. Il se mit à penser à son enfance, à son père, à Doria. Il pensa au temps qui lui restait, au temps qu’il avait perdu. Il se rappela le Nord, qu’il avait tant aimé, le monde qu’il avait parcouru. C’était sa vie. Tant et si peu à la fois. Il resta longtemps immobile dans le silence. Une paix profonde l’envahit. Puis un petit vent agita les branches des arbres et il se mit à faire froid. Le jour commençait à baisser ; il était temps de partir.
Il faisait nuit lorsqu’il revint à Kapuskasing. Les fenêtres de la maison de son frère jetaient une lumière chaude. Paul eut l’impression de rentrer chez lui. »
J’ai l’impression qu’en écrivant ces nouvelles Émond lui-même est venu faire un tour chez lui. Ses films et sa pensée se sont en effet toujours alimentés à la littérature, que l’on pense à Pirandello, Tchekhov, Pasolini, au poète Stachura. Au fil des pages, j’aurais enlevé des redites : trois fois, Il faisait nuit noire quand je suis arrivée au viaduc… Il faisait nuit quand il arriva… Il faisait nuit lorsqu’il revint à Kapuskasing…, pattern trop voyant compte tenu du faible nombre de pages, sans parler des Paul et Paule des trois premières nouvelles, et des deux femmes qui finissent étendues sur la grève du fleuve dans deux nouvelles, l’une morte, l’autre ivre-morte ; j’aurais aussi retouché des maladresses comme « Il tombait une petite neige d’automne et Paul conduisit prudemment dans le jour qui tombait ». Malgré ce manque de fini, il se dégage beaucoup de charme de ce petit livre d’histoires banales, racontées sobrement.
♠
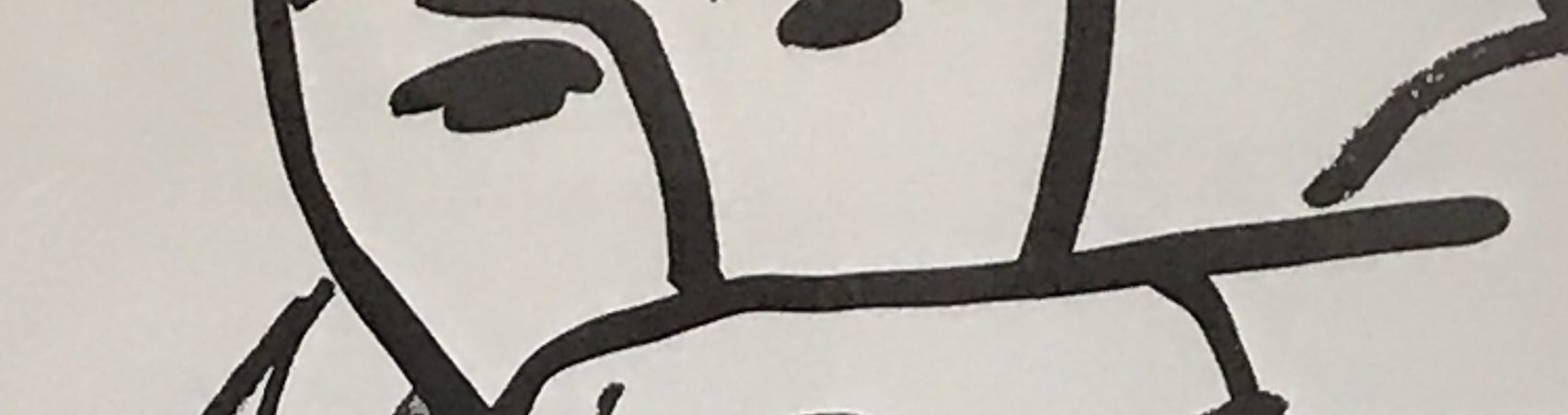
Excellente critique de ce livre,donne envie de le lire.
J’aimeAimé par 1 personne