C’était il y a trente ans, une petite maison d’un quartier paisible qu’on nous avait prêtée pour une semaine, entre deux déménagements. Sympathique, faite de petites pièces, avec des ventilateurs de plafond en bois qui lui donnaient un cachet rustique et de nombreuses places où s’asseoir malgré l’espace exigu. Rien que dans le salon et le boudoir attenant : un canapé, deux causeuses, trois fauteuils, une chaise berçante, un pouf. Des lampes lourdes et solides. Des arbres à travers chaque fenêtre. Quelques aquarelles sur les murs mêlaient des verts, des bleus et des roses qui jetaient une lumière douce sur le léger désordre qui régnait. Beaucoup de chaleur, d’intimité. Et des piles de livres un peu partout.
Elle appartenait à la vieille tante d’un ami partie en voyage. Dans un coffret de carton que j’ai eu la curiosité d’ouvrir, un carnet de chèques défraîchi : celui du mari de la madame, mort vingt ans plus tôt. Le premier matin, le téléphone a sonné. Sans s’identifier, la personne, comme une automate, a demandé la dame, puis son conjoint.
*
Nous couchions à l’étage, sous les combles, dans une chambre charmante dont le plafond faisait un « A » au-dessus de nos têtes, avec les deux pans de mur recouverts d’une tapisserie à fines rayures qui montait jusqu’au sommet. L’atmosphère d’une auberge. À côté du lit, une étagère de livres, où j’ai pris un Gabrielle Roy que j’ai passé un après-midi à lire, au soleil dans la cour arrière, installé dans un fauteuil comme elle faisait souvent elle-même pour écrire. C’était La route d’Altamont. La fameuse romancière se rappelait un vieux Français, solitaire, soigné, qui l’avait emmenée, enfant, par une journée de canicule, voir l’immense lac Winnipeg. En regardant à travers la vitre du wagon, elle demandait à son compagnon de voyage si le ciel a de la peine quand il est gris. Assise sur la plage à côté de lui devant le lac, les deux modestement coiffés d’un bicorne de papier-journal confectionné par le bonhomme, elle évoque le silence que l’eau fait entendre à travers son chuchotement constant, puis elle écoute le « chant profond du lac » plutôt que d’aller barboter dans l’eau comme l’invite à le faire le vieillard. Pendant qu’il commence à somnoler, à cailler, elle comprend que la joie pure qui parfois nous envahit vient de l’étonnement provoqué par la beauté qui se révèle devant nous. Elle semble avoir possédé dès cet âge-là, à huit ans, une force intérieure qui lui permettait de voir des choses que la plupart d’entre nous ne comprennent qu’au milieu de leur vie.
Le hasard a voulu que le lendemain je feuillette un gros ouvrage en papier glacé sur le Québec qui occupait une table basse dans le salon. Presque aussitôt m’est apparu en gros plan, sur une pleine page, le visage de mon écrivaine, vieillarde à son tour : tout ridé comme celui d’une vieille Autochtone, les yeux intenses, pénétrants, les traits droits, sa physionomie dégageant quelque chose de terrien, comme « la vieille terre fendillée » qu’elle avait observée autrefois dans le visage de son ami octogénaire. En la regardant, on est moins étonné qu’elle ait pu parsemer ses histoires de rêveries sans quitter de l’œil la réalité qui l’entourait. Dans l’histoire que j’ai lue, elle ne cache pas la répulsion que lui inspire la station balnéaire qu’elle traverse. Elle ne détourne pas les yeux quand elle voit « la vérité de la vieillesse » dans le visage de son compagnon qui somnole devant elle au restaurant, la bouche ouverte. Un autre récit du même livre raconte, comme pour faire exprès, un déménagement : la voici à l’âge de onze ans tout excitée d’accompagner dans sa charrette un déménageur et sa fille en route vers des quartiers lointains de la ville qui la font rêver autant que le lac Winnipeg – mais qui se révéleront sordides, habités par des gens miséreux, sales et peu aimables.

Sur une autre étagère j’ai repéré une antiquité centenaire : Vieilles choses, vieilles gens, de Georges Bouchard, livre joliment décoré de culs-de-lampe et de bois gravés, et que j’ai depuis toujours dans ma propre bibliothèque. C’était un exemplaire luxueux, dont l’ex-libris m’apprenait que l’auteur avait été député de Kamouraska. Un « bon livre », avait dit le critique Louis Dantin au moment de sa parution, décrivant l’œuvre comme les « Géorgiques de la terre canadienne », des géorgiques écrites avec une émotion contenue, mais auxquelles il reprochait d’être tournées vers un passé qui était « de plus en plus, le passé ». Le moderniste Dantin n’était pas insensible à la mélancolie qui se dégageait du livre, mais rappelait qu’« aucune force humaine ne peut ramener parmi nous ces vieilles gens, ces vieilles choses ». Bouchard y consacre des chapitres au bedeau, au forgeron, à la maîtresse d’école, aux foins, à la fileuse, au crieur public, aux funérailles, au semeur, un autre aux remmancheux des campagnes, des soigneux appelés rhabilleurs en France, qui, bien avant nos physiothérapeutes, prétendaient vous remettre en place la rotule après un accident, en complétant au besoin le traitement par des formules cabalistiques.
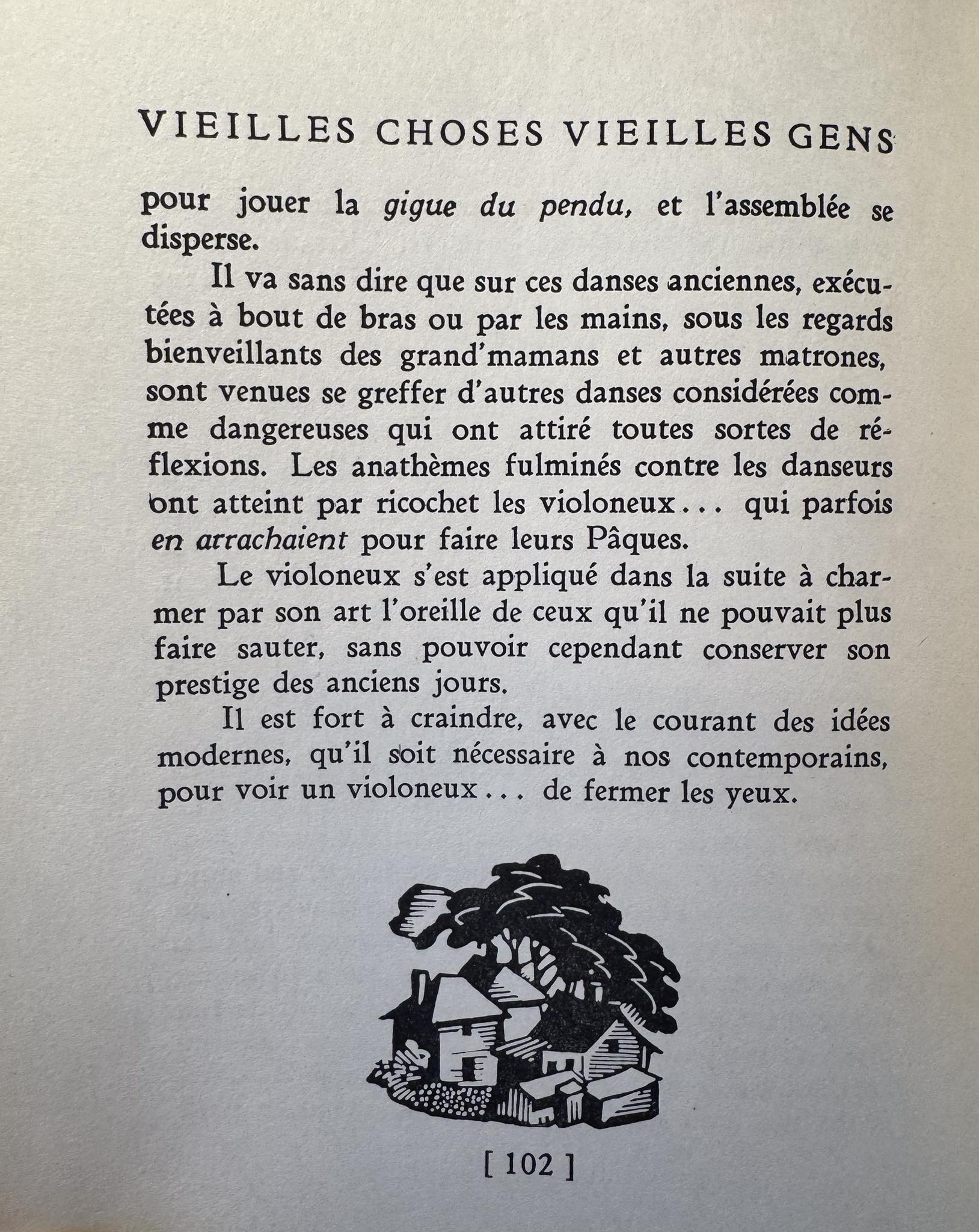
Un autre jour j’ai tiré d’une petite pile un recueil de l’abbé Lionel Groulx, Les rapaillages, tableaux de la vie rurale écrits en 1916, dix ans avant le livre de Bouchard. C’est en tombant sur ce livre récemment que la petite maison m’est revenue à la mémoire. Groulx aussi raconte à sa manière des histoires à vous remonter le vocabulaire. « L’herbe écartante » montre ce qui arrive quand on fait la gaffe de mettre le pied sur cette herbe : la victime sue à grosses gouttes, vomit, voit les arbres danser une ronde infernale autour d’elle, puis soudain se rend compte qu’elle est perdue au milieu d’un grand silence, bref qu’elle s’est écartée. Mais l’abbé n’est pas du genre à faire peur aux lecteurs longtemps. Le jeune entend au loin un sabbat de corbeaux, et comme il a eu l’idée de grimpigner au faîte d’un frêne, il peut contempler, depuis son juchois, un spectacle fascinateur. S’il est pris d’une subite endormitoire, à la maison on va commencer à s’inquiéter et envoyer quelqu’un le chercher, surtout que la grand-mère se doute bien qu’il y a de l’herbe écartante derrière tout ça.
Écarté de tout moi-même cette semaine-là, j’ai laissé au fond de mon sac à dos les nouveautés que j’avais apportées, pour ne lire que les vieux livres avec lesquels vivait la vieille madame.
♠
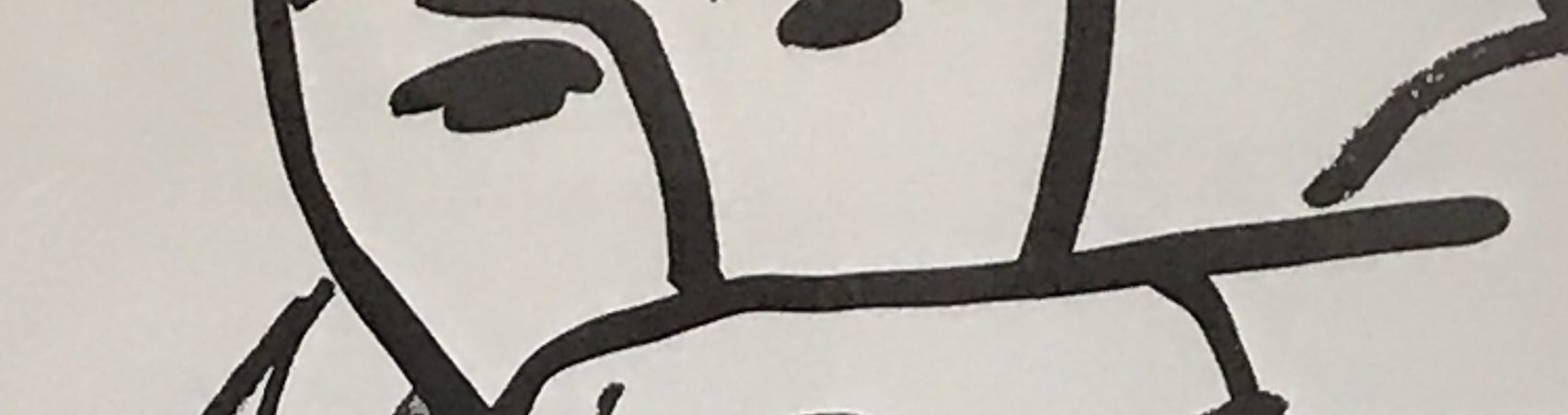
Votre publication, Jacques, n’apparaît pas clairement — je veux dire: après le pique sous le paragraphe « Écarté de tout moi-même », vient un long pan blanc puis une trentaine de lignes de codes de programmation… 🤔
J’aimeAimé par 1 personne
Merci beaucoup Geneviève, c’est très gentil. Je vais m’occuper de ça tantôt.
J’aimeJ’aime