J’ai rarement vu un écrivain défendre un genre littéraire avec autant de fougue et d’acharnement que le fait Étienne Beaulieu dans Un essaim de poussière, un livre — en fait un pamphlet — dans lequel il dénonce le sort réservé à l’essai dans l’espace public au Québec et examine la question sous toutes les coutures.
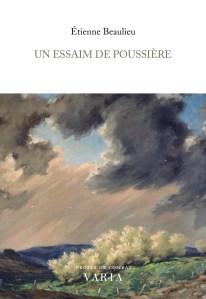
Son idée motrice est que nous vivons enfermés dans le monde de l’opinion, où chacun veut avoir raison sur tout. L’essai ouvre un espace où la méditation remplace l’opinion, où l’on peut cheminer avec une idée et son contraire sans paniquer. Il admet qu’il y a des choses autrement plus importantes que la distinction des genres littéraires, mais pour lui l’essai reste la voie royale pour s’affranchir du prêt-à-penser, sortir des « histoires », revenir au monde réel, se réveiller en quelque sorte, il dit même : pour mieux vivre.
Deux obstacles majeurs empêchent l’essai de prendre la place qui lui revient : 1) le monde universitaire où toute réflexion n’est recevable que si elle est argumentée dans le cadre fixe d’une thèse qui aboutit à une conclusion claire et nette ; 2) la popularité de la fiction avec ses « personnages », ces dédoublements dont Beaulieu a ras le bol et dont les essayistes, dit-il, se passent.
C’est un fait que bien des gens n’ont jamais lu d’essais. Récemment, dans la très respectable librairie d’une petite ville des Laurentides, il m’a fallu l’aide de la commis pour trouver l’étagère des essais, une seule rangée, cachée au fond, dans le coin le plus sombre du local. C’est donc en partie une affaire de visibilité. Beaulieu rappelle plusieurs fois dans son livre qu’il existe une riche tradition de l’essai au Québec, il remonte jusqu’aux Relations des jésuites du 17e siècle, et cite les œuvres marquantes de Pierre Vadeboncoeur et de beaucoup d’autres, sans parler des revues littéraires, si bien que par endroits on se demande où est le problème. Mais voilà : les médias autant que les librairies persistent à tenir les essais à l’écart.
Le problème ne touche pas « l’essai » en général. Les grandes œuvres françaises, comme celles de Camus qu’il chérit, n’ont jamais manqué de visibilité. C’est le sort de « l’essai québécois » qui révolte Beaulieu, et à l’intérieur de l’essai québécois, celui de « l’essai littéraire », et à l’intérieur de l’essai littéraire, non pas les essais qui portent sur tel ou tel sujet, mais ceux où l’essayiste invite le lecteur à cheminer avec lui, sans chercher à lui démontrer quoi que ce soit, ni même à l’instruire, encore moins à faire du matraquage idéologique. C’est un genre où la pensée ne s’éloigne jamais de l’expérience de vie. Beaulieu estime que ce genre d’écrit est en affinité avec la culture profonde du Québec, parce qu’il se tient à la fois loin des « penseurs patentés » et, souvent, près de la nature, par sa nord-américanité, à la manière de Thoreau ou d’Annie Dillard.
On pourrait présenter les choses ainsi : Ce qu’il y a de précieux, en théorie, dans ces essais, et qui est absent autant des thèses savantes que de beaucoup de fictions, est précisément ce qui nous empoigne quand on lit une grande œuvre littéraire : la présence de l’auteur, sa voix, unique, derrière chaque ligne du texte. C’est là que se noue une relation intime entre la personne qui écrit et la personne qui lit, fidèles l’une à l’autre de bout en bout. Rien de semblable dans le collage de phrases, de clichés, de métaphores, d’effets de manche ramassés à gauche et à droite, par des auteurs qui ne font sentir leur présence que par intermittence dans la tonne de « romans » que les éditeurs nous déversent sur la tête à longueur d’année, comme des bacs de recyclage. On comprend l’exaspération de Beaulieu. Quel essayiste osera rivaliser dans un salon du livre avec le nouveau roman d’une vedette de la télé ?
Inversement, sa croisade comporte le risque de donner une prime à tout essai, noblesse du genre oblige. Tout au long de son livre, il vante sans réserve les essayistes québécois. Mais le genre ne fait pas l’œuvre. Beaulieu porte aux nues, par exemple, les carnets de l’écrivain Robert Lalonde, qui me sont toujours tombés des mains après quelques paragraphes, tellement ils me semblent verbeux. Le roman est peut-être un genre usé (bien que je ne le croie pas), mais un essai timoré qui laisse le lecteur bien assis sur sa chaise, pour reprendre le vers de Saint-Denys Garneau, ne vaut pas mieux qu’un mauvais roman.
*
Contrairement à lui, je ne me scandaliserais pas que le métier d’essayiste ne soit pas offert aux élèves du secondaire comme choix de carrière. Sinon, tout l’esprit de l’essai, son élan de vie et sa quête d’intériorité, s’envolerait, et on se retrouverait vite avec des « essayistes patentés ». L’un des chapitres les plus intéressants du livre est d’ailleurs celui où il se demande brièvement si le genre d’essai qu’il admire – lent, méditatif, incertain, personnel, écrit d’une voix fraîche, non académique – n’est pas destiné à rester marginal. Qui sait en effet si ce genre d’écrit n’impose pas à l’essayiste de demeurer un électron libre, mais discret ?
J’ai de la difficulté avec la culture du paradoxe dont il fait souvent l’éloge. On ne peut garder les deux plateaux de la balance éternellement égaux. Sinon autant dire que n’importe quelle idée vaudra toujours moins qu’on pense, et on risque alors de glisser sur le pente d’un anti-intellectualisme nourri par la méfiance, très ancienne au Québec, à l’égard de la vie intellectuelle. Mais aucun doute qu’il vaut mieux avoir un esprit en mouvement qu’une tête carrée, désarmée devant l’incertitude.
L’essai est-il vraiment plus apte, comme le suggère Beaulieu, à s’approcher de la vérité, du réel que les autres genres littéraires ? Dans tous les cas, à quel point peut-on s’approcher du réel avec les mots ? Ce sont là des questions auxquelles se sont attaqués de grands poètes et qui donnent le vertige.
J’ai pensé plusieurs fois à Karl Ove Knausgaard en lisant Beaulieu. Aucun atome crochu entre les deux, mais le Norvégien aussi s’est impatienté, dans Mon combat, devant le nombre effarant de récits qui racontent des histoires toutes coulées dans le même moule – romans, bulletins d’information, chansons, séries télévisées : on vous présente les personnages, on met l’action en branle, on crée un suspense, puis on vous ramène au calme, si bien qu’à la fin, comme pour le sonnet figé dans ses quatorze vers, tous ces récits ne disent plus rien, ne racontent rien, ne font rien d’autre qu’exhiber leur forme : le néant. Paradoxalement, Knausgaard s’est trouvé à montrer la puissance que conserve encore le roman, en intégrant dans son livre un essai de plusieurs centaines de pages (sur le nazisme), sans prétendre aboutir à une conclusion tranchée. Il a nié aussi que toutes ces personnes qui apparaissent au fil des quatre mille pages de son œuvre soient des « personnages » : sa femme, Linda, « n’est pas un personnage. Elle est Linda ». Si bien que les critiques scandinaves n’ont jamais su dans quel genre classer son livre.
Est-ce si étonnant que le roman continue de dominer ? Le mot roman lui-même importe peu, sinon pour des raisons de marketing. On invente des histoires depuis toujours, ça ne va pas s’arrêter de sitôt. Est-il seulement possible d’écrire sans inventer ? Pensez aux trucages des autofictions, à tous ces auteurs qui mêlent le vrai et le faux en se cachant plus ou moins habilement derrière un narrateur. Norman Mailer disait : « There is no such thing as non-fiction. » On peut bien affirmer que les essais sont de la « création » sans être de la « fiction » comme le fait Beaulieu, mais il est difficile de penser qu’ils ne comportent pas une part de fiction. Voyez le « carnet de Frida Burns » de l’essayiste Frédérique Bernier. Est-ce avec une personne que la personne qui lit développe un lien en lisant un essai — ou avec un représentant littéraire de cette personne, un « personnage », un narrateur, un double, un je spécial, bref quelqu’un qui se met en scène ? La question à elle seule mérite un essai.
*
La figure emblématique de Montaigne, père de tous les essayistes et référence absolue d’Étienne Beaulieu, a de quoi clore le bec aux sceptiques. Il est la preuve que l’essai littéraire, si on peut continuer à l’appeler ainsi, par opposition notamment à certains grands essais de l’Antiquité, peut atteindre des sommets. Mais Montaigne était un costaud. Qui a cette sagacité, cette finesse d’esprit, la plume aussi habile, un bagage aussi vaste ?

♠
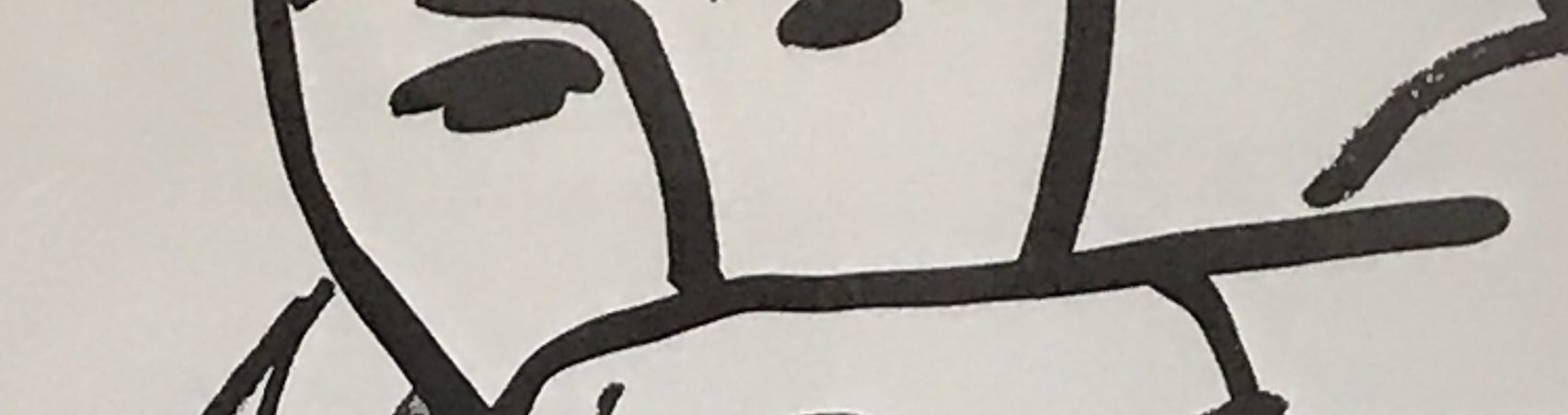
merci pour ce beau travail littéraire. Et merci pour l’abonnement
J’aimeJ’aime